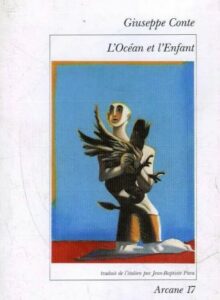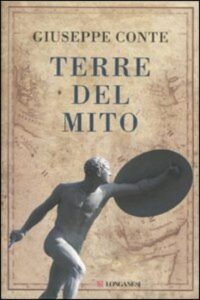« LE POÈTE EST UN HOMME
QUI VEUT FAIRE RENAÎTRE LE SENS DU LANGAGE »
Bernard Bretonnière : La poésie, en France, est certainement le genre littéraire le moins lu – et particulièrement en ce qui concerne les écrivains contemporains. N’êtes-vous pas étonné que votre premier livre traduit en français soit un recueil de poèmes ?
Giuseppe Conte : J’aurais déjà été étonné pour mes romans ! Alors oui, cela me surprend beaucoup. Aucun poète italien de ma génération n’a été traduit en français. C’est un pari pour l’éditeur. Aussi, je suis préoccupé parce que la possibilité d’être réellement diffusé en France m’apparaît bien faible. Disons que si mon livre a été vendu à quatre mille exemplaires en Italie**, j’espère en vendre ici quatre cents…
Traduttore, traditore est un aphorisme italien qui incite à vous demander plus qu’à tout autre : comment un écrivain étranger, et particulièrement un poète, peut juger la traduction qui est faite de ses textes ?
Je dois dire que j’ai eu la chance de trouver quelqu’un qui est non seulement un traducteur mais aussi un poète et un critique. Jean-Baptiste Paraa traduit mes poèmes de la meilleure façon : il en a transcrit la musique italienne en musique française. Dans ce passage, le sens n’a pas bougé : ce que je découvre, c’est une autre musique mais en retrouvant très exactement ce que je voulais dire. Aussi, ce qui est intéressant dans cette nouvelle lecture, c’est de se découvrir d’une autre façon et donc d’approfondir ce que l’on a mis dans le texte. Cela, je peux l’apprécier en français ou en anglais – que je parle – à défaut de pouvoir le faire en suédois ou en russe, langues dans lesquelles j’ai été traduit mais que j’ignore.
La description des objets frappe, dans votre poésie. Italo Calvino le remarquait lui-même. [Italo Calvino a souligné dans votre poésie l’importance de la description des objets.] Le langage de l’écrivain doit-il cerner l’objet ou doit-il le faire, plutôt, s’échapper de ce qu’il est ?
Si l’écrivain se contente de montrer, l’objet est mort. Une véritable description doit révéler la partie invisible de tout objet, la partie de mystère que le langage ordinaire et le langage de la science ignorent. Le langage de la poésie doit voir cela. La précision dans la versification amène à découvrir l’invisible.
Les autres poètes ligures ont plutôt choisi une expression dépouillée, voilée, aride.
Les poètes ligures des générations précédentes – Sbarbaro, Montale, Caproni – ont choisi un langage très dépouillé, très essentiel. Italo Calvino a cherché la liaison entre ma poésie et celle de ces anciens, pour découvrir que nous avons tous réfléchi sur le paysage en lui donnant une valeur symbolique et morale. « La sirène du monde a perdu sa voix » écrit Sbarbaro ; ça, je ne le crois pas puisqu’au contraire je recherche cette voix ; ne pouvant le faire par le dépouillement, j’utilise un langage métaphorique tendu vers les cycles du mythe.
« Le poète est peut-être un homme qui porte en lui / la cruelle pitié du printemps » avez-vous écrit. Comment comprendre ce curieux assemblage de mots donné comme définition ?
Le printemps, c’est quelque chose qui revient chaque année apporter une renaissance. Le poète est un homme qui veut faire renaître le sens du langage et la façon de regarder les choses. Mais pour renouveler, il faut par principe détruire et donc être cruel avec soi et avec ceux qui nous empêchent d’appeler ce printemps. La question que vous me posez m’oblige à ma poser à moi-même d’autres questions… Pourquoi la pitié ? Pitié et cruel sont deux mots contradictoires ; le printemps est au-delà du paradoxe et le poète au-delà de la cruauté et de la pitié : son regard sur les choses ne doit pas être lié à sa propre conscience mais – selon mon opinion – impersonnel ; c’est un regard mythique, lié à la conscience du monde. Il faut la cruauté pour détruire le vieil ego en soi et la pitié (qui est l’amour) pour construire le nouveau.
Vous parlez d’impersonnel… Votre poésie,dans son vocabulaire et ses images, est très universelle, peu située dans le temps, rarement dans l’espace et elle échappe toujours au moi. Vers quelles destinations emmenez-vous donc votre lecteur ?
Mes références géographiques sont toujours mythiques, situées au-delà de l’espace, comme la Grèce mycénienne, l’Irlande des Celtes, l’Amérique des Indiens. L’hégémonie de l’avant-garde a réduit la poésie au langage. La poésie en tant qu’expérimentation de cet ordre me paraît une voie mortelle. Ailleurs, il y a la poésie existentielle, la poésie qui pleure sur l’expérience personnelle. À mon sens, la poésie doit transfigurer l’expérience personnelle pour faire passer quelque chose sur le sens de la vie, l’âme du monde, la nature, le destin.
La nature – animaux, végétaux, minéraux, éléments – est constamment présente dans votre œuvre. Peut-on parler d’une conscience écologique ?
L’écologie est quelque chose de différent. Il n’est pas possible de dire Il faut sauver la nature si l’on ne change pas la perception même de la nature. J’ai redécouvert une certaine idée de la nature mais il m’a fallu, pour parler d’elle, redécouvrir une pensée et un mythe qui me permettent eux-mêmes d’établir un nouveau langage. On ne peut pas parler de la nature aujourd’hui en ignorant le fait qu’elle est menacée et qu’elle avait été sacrée.
Vous invoquez souvent les dieux. Est-ce la nature qui vous ramène aux mythes ?
Bien sûr. Il y a là une liaison très profonde. Pour parler de la nature, il faut retrouver les anciens dieux de la nature. La nature n’a pas de langage propre mais je pense qu’elle trouve un langage à travers nous. Ainsi, si je regarde la mer, je vois le dieu de la mer et l’on ne peut en parler sans voir la liaison avec le cosmos : la marée et la lune, la pierre et l’étoile. C’est cela qui a été perdu par notre civilisation. Le mythe, c’est la mémoire occultée de l’humanité. Mais il parle à travers cela même qui l’a occulté : l’histoire et la technologie, essentiellement. Pour parler du mythe aujourd’hui, il faut retrouver l’énergie de la vie, même dans la condition désolée du monde actuel !
Cela vous porte vers un certain optimisme ?
Cela me permet de croire que la vie, se transformant toujours, va continuer…
Pendant les tempêtes d’équinoxe, l’on a, presque chaque jour, vu votre silhouette arpenter, littéralement contre vents et marées, le front de mer de Saint-Nazaire. Comment, à travers des sensations aussi naturelles, sauvages, brutes, détachées du temps, peut-on atteindre une écriture contemporaine ? Rien n’est plus romantique que la mer, la tempête ; alors pourquoi n’écrit-on plus aujourd’hui comme au XIXe siècle ?
D’abord, je me promenais beaucoup le matin pour voir quelque chose qui m’étonnait : le jeu des marées que j’ignore sur la Méditerranée où je vis. La marée n’est pas seulement une transformation de la mer : c’est un symbole magique de métamorphoses lointaines, c’est une fascinante transformation continue du lieu. En se promenant pendant ces matins d’automne seul à mille kilomètres de sa maison, face à une autre mer, on peut sentir toute la solitude du monde – voire le désespoir – en même temps que la liberté.
Ensuite, je suis très proche du romantisme et, avec des amis de ma génération, nous travaillons, en Italie, sur l’interprétation nouvelle des romantismes anglais et allemand. Mon écriture n’est pas foncièrement contemporaine ; la poésie n’est jamais contemporaine, elle est hors du temps comme le désir ou le rêve, comme quelque chose qui arrive et change le temps. Être contemporain pour un poète, ce serait accepter la réalité présente en tant que telle. C’est impossible ! Le poète transforme la réalité. Il y a près de deux siècles entre Shelley et moi : je ne peux pas oublier les expériences culturelles qui nous séparent – de Marx à Freud. On ne peut écrire de la même façon mais on peut écrire sur le même sujet, et avec la même âme.
La vie sauvage vous tente-t-elle ? Est-ce un retour vers lequel vous voudriez tendre ? Est-ce le quotidien actuel qui vous pèse et qui nous emprisonne ?
J’aime, personnellement, vivre dans un cadre feutré, civilisé… La vie sauvage, c’est le symbole de ce qui a été perdu. Si l’on ne peut pas redécouvrir une nature sauvage qui n’existe plus, on peut chercher ce qui, à l’intérieur de soi, est emprisonné par la pensée technique, rationaliste. Le quotidien actuel ne m’empêche pas de retrouver le mythe et la puissance ; ce qui m’emprisonne, c’est l’idéologie, le pouvoir de la vision scientifique et utilitaire, la pensée analytique. Mais je ne peux pas être assez naïf pour croire que je vais retourner à Shelley ou à Mallarmé !
En quoi la mythologie celte intéresse-t-elle le Ligure que vous êtes ?
En Italie, personne ne connaît la mythologie celte. [En Italie, la mythologie celte est pratiquement ignorée.] Je l’ai découverte en Irlande. Ce qui m’a séduit, c’est sa perception musicale et magique de la nature, une perception qui lie le naturel et le surnaturel ; la mythologie celte donne à voir une nature en constante métamorphose, presque sans dieux.
Où les dieux seraient humains ?
Disons que ce sont des humains qui ont obtenu l’éternelle jeunesse.
L’homme, contrairement aux dieux que vous affectionnez, ne peut se métamorphoser. Si le choix d’une métempsycose vous était offert, qu’aimeriez-vous devenir ?
Je choisirais d’abord d’être un saumon puis un oiseau de mer. Le saumon parce qu’il vient de l’océan et remonte procréer vers la source du fleuve : cette idée a une force symbolique réconfortante car elle évoque la possibilité de se retrouver soi-même dans le chaos et la difficulté.
Et l’oiseau de mer ?
Parce qu’il va manger le saumon ! Il faut savoir être l’ennemi de ce que l’on a été.
Donnez-vous maintenant le don d’ubiquité. Où vous voyez-vous ?
J’aimerais vivre une vie sur la mer ligure et une vie dans le désert du Nouveau Mexique ; ce sont les lieux les plus forts, les plus essentiels que je connaisse. Le désert, c’est la mer loin de la mer.
Continuons le jeu : vous ne refuseriez pas le destin d’un dieu ! Mais quel dieu
Je ne voudrais pas être un Dieu de monothéisme. Dans la mythologie grecque, je me vois en Zeus parce qu’il s’est transformé de multiples façons pour assouvir sa puissance amoureuse… Ça, j’aimerais beaucoup… (rire.) Dans la mythologie aztèque, j’aimerais être Nanauatzin parce que j’aime cette idée qu’un dieu puisse être petit et malade… Car Nanauatzin, se sacrifiant dans le feu, devint le soleil.
Dans la nature que vous aimez, quel arbre seriez-vous ?
Un cerisier en fleurs parce qu’il est blanc et qu’on ne peut encore manger ses fruits.
Et quel minéral ?
Une pierre du chemin, la pierre qui, tournée vers le zénith, devient menhir. J’aimerais être un menhir !
Auriez-vous alors une époque de prédilection ?
Je voudrais en essayer plusieurs. Au moins deux : avant le déluge et pendant l’empire romain. Le déluge pour savoir ce que personne ne sait, c’est-à-dire s’il y eut avant des géants, des prophètes, des savants cosmiques – la légende dit que les druides ont un savoir hérité d’avant le déluge. L’empire romain parce que je n’aime pas les Romains.
En bon Ligure que vous êtes…
Oui, mais je voudrais être un Celte qui se rebelle contre l’Empire romain ! Et permettez-moi encore une autre époque : le XVIIe siècle, pour être navigateur et rencontrer Robinson Crusoë ou Gulliver.
Êtes-vous un nostalgique ?
Non, je ne me sens jamais nostalgique. Je pense que le mieux doit encore arriver. En réalité, j’aime beaucoup vivre dans mon temps, regarder vers notre futur commun et écrire (parce que je ne sais pas faire autre chose) non pour sauver le monde mais pour ajouter quelques petites images de beauté dans la bibliothèque de l’univers.
Le concept de beauté dans l’art ne vous intimide-t-il pas ?
Il ne me fait pas peur. J’emprunterai, pour répondre, l’idée de Yukio Mishima selon laquelle c’est en refusant la beauté que l’on a produit notre univers de violence et de frustration contemporaines.