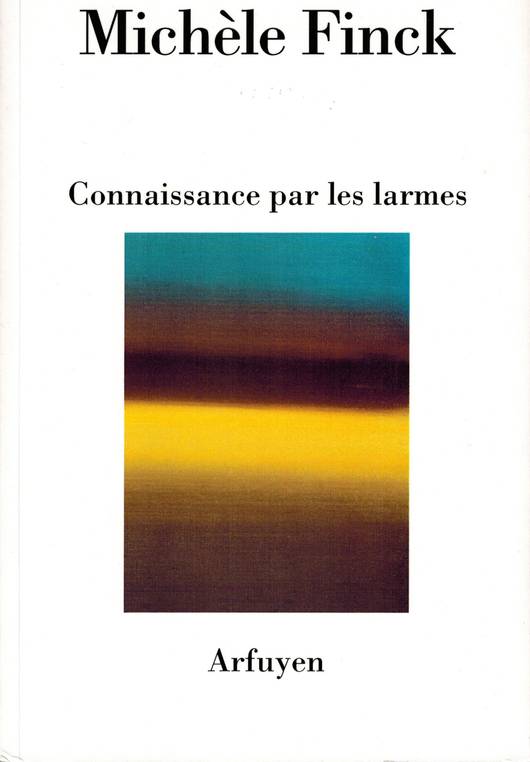Avec Balbuciendo, Michèle Finck, poète rare, signe chez Arfuyen son second recueil, après L’Ouïe éblouie paru en 2007 chez Voix d’encre. Une biographie minimale : Michèle Finck enseigne et apprend, écrit et déchire, joue et déjoue de la musique.
Michèle Finck défaille, mais elle signe ; assigne la vie à répondre d’une douleur intense, polymorphe ; adresse un signe aux chers disparus, aux amours regrettés ; désigne finalement de la pointe de la plume une vague direction à la vie future possible.
L’excipit nous dit :
Ciel silence cigale
J’écris
D’un seul coup tout autour des tortues sauvages.
Oui, grâce à l’aura de l’écriture qui n’a jamais cessé d’irradier la personne de Michèle Finck, finalement la vie a gardé un attrait. Le silence propre au deuil amorcé conduit Orfée par la main, invite à la contemplation dans le calme de la solitude. L’apparition soudaine des tortues sauvages sur la plage déserte où gît le corps l’atteste : le thauma, l’étonnant tour de magie de la création littéraire – évocateur, démiurgique, cathartique –, n’a pas quitté le poète. Les tortues sont venues pour souffrir, certes, mais aussi pour se consoler dans les larmes, et donner naissance à un espoir (un autre texte, une texture, peau neuve pour le corps exposé).
*
Mais revenons sur nos pas. Que s’est-il passé ? Quel vécu a criblé cette vie-là, ces dernières années depuis L’Ouïe éblouie ? C’est ce que Michèle Finck raconte dans Balbuciendo, ce chant élégiaque entre pudeur et licence, écriture et musique, adressé de la faille vers l’origine du langage et vers les êtres perdus.
Dans l’expérience de la souffrance, un être abattu ne reconnaît plus sa propre voix, car celle-ci est déchirée, « les mots titubent atterrés de mémoire ». Ainsi balbutiante, la langue pense mourir, mais c’est sur ce chemin descendant, cette chute, que, de manière inattendue, thaumaturgique, elle retrouve la piste de l’origine du sens. Il s’agit d’une lande nocturne qui n’est pas un pur néant, nihil, mais une gorge immémoriale hoquetant des sons dans un râle de tortue parturiente, des œufs de sons, d’absolus rythmes.
Mystérieuse découverte que Michèle Finck nous livre, tout en ne pouvant le faire clairement, puisque ce savoir appartient à la nuit. L’expérience de la souffrance se convertit, ou tout du moins s’accompagne d’une enquête sur l’indicible. À la lecture de ce texte, il me semble que c’est cette approche fortuite de la trame occulte du langage qui a finalement permis à l’auteur de redresser la plume et le corps. Car bien entendu, ce savoir n’a rien d’objectif : c’est l’acquisition d’un sens renforcé de la trame de silence à partir duquel émerge la possibilité du poème. Trame comme une peau de tambour. Et ce tambour résonne, avant même que les mots ne soient formés. Telle est le cœur de la découverte : le fond du langage est une toile de silence noire battant en rythme. Le rythme saccadé, mystérieux, de la musique primitive.
Être sous la peau du tambour, dans la caisse résonnante, soumis aux battements sauvages. Le crâne se fêle, le tympan saigne, mais un savoir occulte est lentement récolté dans le réceptacle du pavillon de l’oreille. Par le trajet que font les larmes, l’âme se déplace de l’œil à l’oreille.
*
Le poème que l’auteur a fini par délivrer se trouve ainsi marqué par des deuils terribles autant que par cette expérience « existentielle », archaïque, de l’indicible. Il ne peut y avoir de récit comme tel de la perte, mais plutôt une expression du sentiment de la perte ; expression tantôt métaphorique, tantôt concrète, implacable, prosaïque, apoétique – car souvent la métaphore même ne parvient pas à se hisser à hauteur de la douleur. Les récits de l’expérience de la perte paraissent étranges.
Œuvre au noir, conversion alchimique, le poème délivré présente un récit douloureux battant de plus en plus à la mesure du noir, se confondant progressivement avec lui.
Poème : scansion du noir, balbuciendo.
Les mots de « douleur », de « mort », de « mémoire », d’ « amour » et de « crâne », essentiellement, se retrouvent des dizaines de fois dans le recueil, parfois plusieurs fois par poème. Le rythme sauvage de la musique la plus nue, proche de la transe peut-être, s’est emparée de l’écriture. Les anaphores ne choquent pas, elles s’imposent, elles ne sont que le signe d’un signe sans gramme plus fort, car plus archaïque, qui emporte tout (peut-être cela constitue-t-il l’essence de la musique). La scansion du noir opère, s’empare du verbe, le trempe à l’encre noire comme la bile mauvaise.
Scansion : le mot est bien choisi pour dire le thauma devant le tour (de magie) du noir. La scansion dit le récit maîtrisé dans les règles de la versification, le poème formel parfait, mais il pourrait également dire le rythme sauvage amétrique, le pur battement.
*
Mais moi j’ai vu ma tête équarrie dans la vitrine du boucher
Insomniaque au milieu des groins d’animaux et sans langue.
Tel est le programme qui se propose, s’impose, presque dès l’incipit du recueil (dans un poème qui lui aussi porte bien son titre, « Présage »). Une femme est mise au supplice des amours perdus, de la nostalgie la plus cruelle – décès du père, séparation irrévocable avec l’amant. La douleur est telle que son esprit semble se tenir à distance du corps, qu’elle se sent distancié avec elle-même.
On s’observe souffrir derrière une barrière transparente qui sépare se soi. Insomniaque, on sait pourtant que l’on est encore en vie, mais est-ce encore notre vie, si elle ne nous appartient plus, si ce qui en faisait la substantifique valeur lui a été si cruellement arraché ? Mais un indice réside dans les images noires, dans les rêves confus, dans les visions prophétiques : les langues sont retirées aux bêtes, car le langage est le propre de l’homme, dit-on – à moins qu’il ne le soit parce que le fond commun de la toile vivante est intégralement inarticulée, balbutiante.
*
Brisée, la voix tâtonne dans le noir, elle est réduite à sa plus simple expression : balbutiements, pépiements, qui désignaient spécifiquement chez les anciens Grecs le « langage » non articulé des oiseaux, des bêtes en général, la pure phônè, par opposition à la langue articulée – scandée, pourrait-on dire – de la parole humaine, le logos. Au bout de cette réduction (phénoménologique), la voix retrouve la lisière obscure délimitant l’origine perdue :
« la langue la plus proche de la paille au moment où elle prend feu ».
Langue de l’homme de paille, souffle du vent au travers du fétu fendu, langue de paille ; donc une non-langue, une autre langue que celle de l’auteur, comme celle à laquelle appartient le mot « balbuciendo » ; le silence de la langue parmi les sons, la musique avant les doigts sur les touches du piano, avant l’accent, avant le jeu. Dans le poème « In memoriam » :
Mais nuit après nuit, dans les pluies battantes des cauchemars, continuer à essayer, encore et toujours, de mettre le feu à l’accent aigu comme si c’était essayer de mettre fin à la mort.
Le français « mémoire » n’est pas le latin « memoria ». Briser l’accent, le faire tomber de la lettre « e », c’est passer d’une langue à une autre, d’un temps à un autre, d’un sens duratif de la mémoire (les souvenirs terribles envahissants) à un sens révolu de la mémoire, comme lorsque l’on pose sur une stèle la mention « In memoriam », espérant que les êtres perdus nous libèrent de la souffrance que leur absence nous inflige, qu’ils soient apaisés là où désormais ils demeurent.
« Memoria », c’est l’accent funeste qui tombe, la musique du piano fermé, le calme du deuil ; c’est l’apaisement de la douleur (algos) de l’absence du retour (nostos) du perdu ; c’est la langue morte révérée, car on refuse encore la radicalité de la disparition, « comme si c’était essayer de mettre fin à la mort », et l’action de grâce plaît aux jeunes fantômes ; c’est le dernier ricochet – enfin ! – des souvenirs aux griffes acérées. Le poème « Ricochet » s’achève ainsi :
Ricanent les souvenirs. Ricochent dans le crâne.
Le lynx de la mémoire nous tuera tous les deux.
*
En écho à « Présage » du début, le milieu du recueil présente un poème intitulé « Prédiction », qui nous dit :
L’œiloreille se hisse hors du cri
Et ne cicatrise pas. Tympan au bord
Des larmes et enfoui sous la neige
Écoute une note âpre lapidée de noir.
Progressivement, le débat avec les fantômes se superpose avec les questionnements sur l’origine du langage et sur la musique. La musique comme telle, la Musique, sera comme l’axe d’une forme de salut, la crête sur laquelle le poème pourra encore cheminer, et la vie continuer. Celle-ci a toujours été une ressource dans la vie de Michèle Finck la musicienne, mais c’est par un biais tout à fait fondamental (au sens strict du fondement) qu’elle jouera pendant cette époque chaotique un étonnant rôle de viatique.
« L’œiloreille » : progressivement à nouveau, l’œil s’arrache à la vue de son propre supplice, à la vitrine du boucher, à la vue et aux images en général. L’image recule, s’écroule, le son avance, monte. Je parlais d’une conversion : oui, une forme de transition s’opère de l’œil à l’oreille – œil, « œiloreille », puis oreille à la fin du livre, une transition qui est une transmutation des sens profonds donnant accès au réel. Ce mouvement constitue une dynamique archipoétique : celle de la pénétration du cœur prélinguistique du poème, en amont du langage, de la métaphore elle-même.
*
Le poème « Séparation sidérale » s’ouvre ainsi :
Nous : obstinément. Un seul corps ailé d’étoiles : nous.
Non : un hibou mort nous hulule. Son sexe saigne.
Tranchée au couteau la tresse de nos corps.
La fusion est au-delà des forces du corps. Mais l’obstination totale de l’amour engendre un paradoxe : « un seul corps », une « tresse » unique, mais une « Séparation » et un « sexe [qui] saigne », humilié par un hibou plus avisé, plus savant dans les choses de l’origine, même s’il est mort et qu’il se rappelle au plus profond de nous comme l’animalité se rappelle à nous de (trop) loin… Bien sûr, le sexe de l’autre saigne, puisque c’est celui de l’autre. Sexus signifie « séparation », comme l’inscrit le titre. La différence sexuelle peut être cruelle, et cruellement accentuée par la distance avec l’aimé.
Les scènes de torture – chairs déchirées et d’os broyés par l’étau de la souffrance – lapident les poèmes de Michèle Finck.
Ouvrir de nouvelles portes de douleur à l’intérieur de soi.
Les souffrances mettent le corps en demeure, le contraignent à l’hystérisation la plus violente. Les nombreuses images sont cruelles, saisissantes, sans pitié – pour un temps. Car la plongée dans la nuit va apporter cette forme de mélancolie qui est peut-être l’amorce du deuil ou le deuil lui-même. La cruauté finit par retenir un peu son bras, ses coups ; la mélancolie supplante la rage blessée (quelque chose comme la dépression ?).
Peut-être alors, en retour, la musique sera elle aussi vécue de manière plus authentique, après avoir été saccagée par la colère.
J’ai longtemps hiberné dans mon oreille.
Mais vint un soir où je n’ai plus cru
À la musique. Des transes me tordaient
D’orgasmes sonores morts.
*
Celan, Rilke, Goethe, Apollinaire, et Trakl et Novalis peut-être, d’autres encore, poètes ou musiciens, ils sont là quelque part, à l’orée du champ de douleur. Que peuvent-ils pour nous ?
Michèle Finck cite Celan en épigraphe : « Nous nous séparons enlacés ». Sexus, mais ensemble, comme nous le disions. Comme Zweig se donnant la mort avec son épouse, dans les bras l’un de l’autre, loin des siens.
Enlacés. Une tresse. Un poème :
Poème :
Fil de funambule tendu entre pierre tombale
Et perce-neige.
Le poème est défini dans le lien, la tension d’un lien entre la mort et la douceur, la sensibilité fragile de l’intime. Le risque de chute est élevé – on le sait, on a fait l’expérience de la chute dans le tambour. Le poème naissant sort de son « trou », de son « terrier », il n’est que le « reste chantable », dirait encore Celan, de la difficulté à exister.
Le poème relie mort et douceur, noir et blanc, encre et neige. Il n’est ni l’un ni l’autre, mais le lien les surplombant, n’échappant que dans le grand danger à la radicalité de chacun. Le pénultième poème dit :
Tremblement
Sur le piano noir
D’un flocon de neige.
Les voies du deuil sont impénétrables. Il s’avère qu’il a tout de même été mené, dans l’extrême solitude et la douleur. Un travail (de survie ?) a été accompli, synthétisant d’apparentes antinomies. Finalement elles se rejoignent, se côtoient dans le champ musical qui a su rester ouvert, bien que la douleur ne se soit pas dissipée. Le fil du funambule tremble toujours, mais les cris se sont étouffés.
*
Ce peu de buée de sons qui tremble
Sur la page déchirée me suffit.
Ainsi, musique et écriture se confondent. Il le faut bien, car pour vivre, il faut « continuer d’œuvrer », disait Goethe, poursuivre sa propre partition, dont les portées suivantes, non inscrites, nous restent cachées.
Comprendre que peu importe qui l’emporte du doute ou de l’espoir, si nous « continuons d’œuvrer ».
Nous remercions Michèle Finck pour le courage de son poème, celui de la tresse impossible.
Nous remercions notre cousine alsacienne, aux racines dans le Sungau au carrefour de la Suisse, de l’Allemagne et de la France, poète-musicienne funambule sur le fil de la portée et de la frontière, dont le parent est mort comme le nôtre en tombant d’un de ses arbres sur sa terre aimée.
Nous aussi scandons. Nous la remercions d’avoir trouvé le courage de continuer d’œuvrer.