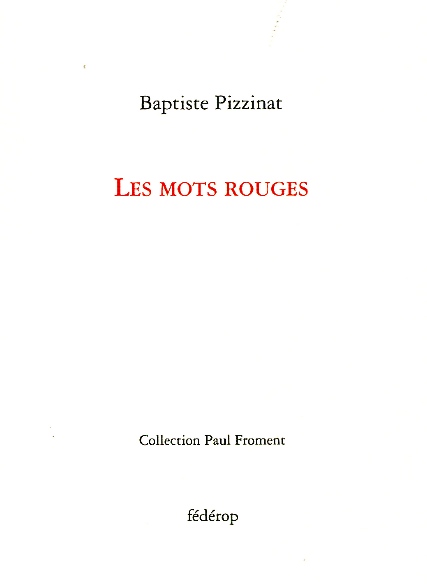Il faut qu’un recueil reste longtemps posé sur le bureau, près de soi. Il s’y installe dans l’immobilité confortable de sa couverture, de sa typographie, du grammage de papier, du nom de son auteur, de son titre. En attente.
Un jour, il nous sollicite : « Allez, vas‑y, ouvre-moi donc» ! Un défi ? A ce moment-là, je me décide. Je l’ouvre comme un paquet cadeau ou une pochette surprise. Le livre prend alors la parole. Il offre ses mille « mots » (ici dans tous les sens de ce son !). A nous de les écouter et — parfois — de les entendre.
L’opuscule de Baptiste Pizzinat n’a pas échappé à cette règle redoutable qui fait qu’une lectrice ne peut ni tout voir, ni tout regarder. Alors ces « mots rouges » emprisonnés dans le titre, que sont-ils ? Ils sont des mots « qui déjà contiennent leurs propres cendres », « pareils aux coquelicots » sur le bord du chemin. Une émotion à la Mouloudji s’esquisse. Elle renvoie à ces « trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur », sur le corsage blanc d’une femme aimée et tuée par amour. Des mots de mort. Le poète s’émeut de sa longue quête à travers le langage :
Il faut creuser les heures
Ecrire beaucoup
pour dire si peu
être avec toi.
Or les mots des poèmes sont porteurs de leur propre limite : ils cherchent ici à cerner la mort d’un être cher, sa sœur, survenue dans l’enfance du poète, mais ils n’accèdent pas au « rendez-vous » de l’absence.
Après la mort, plus rien.
Le poète ne sait rien de la morte : ni signe, ni trace, ni pas. Juste des « apparitions ». Elle s’est transformée en « étoile filante ». Il ne sait rien non plus de la mort. Que faire ? Quel exutoire ? Quel antidote ? Il s’invente alors un avenir :
Demain
j’apprendrai le langage des morts
et parlerai aux vivants de ta présence aimée.
Il créé un être sororal — « Jessica » — qui resurgirait à sa façon :
Pour te voir, j’apprends à voir plus loin. Au-delà de la sœur. Et du nom. Au-delà de tout.
Il comprend alors que « nous sommes des fantômes. Des spectres sans famille. Pendus d’un bout à l’autre de l’espace et du temps ». Que dire d’autre si ce n’est «adieu au langage » ? Je ne peux que me taire.
- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 6 juillet 2023
- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 5 septembre 2022
- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 juillet 2022
- La revue Florilèges n°187 - 28 juin 2022
- Armand Dupuy, Selfie lent - 28 décembre 2021
- Gilbert Lascault, Petite tétralogie du fallacieux - 6 octobre 2021
- Marie Etienne, Antoine Vitez et la poésie, La part cachée - 6 mai 2021
- L’Intranquille 19, revue de littérature - 21 février 2021
- Florilège, revue trimestrielle, n°174 - 6 février 2021
- DISSONANCES, Feux, n°38 - 5 janvier 2021
- Barry Wallenstein, Tony’s blues - 5 janvier 2021
- Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, Avec Lucian Blaga, Poète de l’autre mémoire, Fileuse de l’invisible, Marina Tsvetaeva - 6 octobre 2020
- Verso n°179, Ici & ailleurs - 6 septembre 2020
- Aragon, La grande Gaîté suivi de Tout ne finit pas par des chansons - 6 mai 2020
- Albertine Benedetto, Vider les lieux - 21 avril 2020
- Clara Régy, Ourlets II - 5 février 2020
- Christine Durif-Bruckert, Le corps des pierres - 20 décembre 2019
- Louise de Coligny-Châtillon dite Lou, Lettres à Guillaume Apollinaire - 19 novembre 2019
- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 novembre 2019
- Cairns 25, Murs, portes ou ponts - 6 novembre 2019
- Estelle Fenzy, La Minute bleue de l’aube - 14 octobre 2019
- Philippe Jaffeux, 26 tours - 25 septembre 2019
- Patrick Pécherot, Lettre à B - 1 septembre 2019
- Wislawa Szymborska, de la mort sans exagérer - 4 juin 2019
- Fil autour de Catherine Gil Alcala, Serge Pey, Olivier Domerg - 4 mai 2019
- Christine Durif-Bruckert , Arbre au vent, Joseph Thermac, Du sublime moderne - 3 février 2019
- Jean-Claude Pirotte et Didier Cros, les livres bilingues pour la jeunesse : Maya Angelou, Carson McCullers - 4 janvier 2019
- Xhevahir Spahiu, Urgences — Urgjenca - 5 novembre 2018
- Constance Chlore, L’Alphabet plutôt que rien - 4 septembre 2018
- Patrick Chamoiseau, L’Empreinte à Crusoé, La Matière de l’absence - 6 juillet 2018
- Jean Fanchette, L’île équinoxe - 5 juillet 2018
- Revue TXT 32 : le retour - 3 juin 2018
- Roland Dubillard : Je dirai que je suis tombé, suivi de La boîte à outils - 5 mai 2018
- Christian Bobin, L’homme-joie - 5 mai 2018
- Écritures féminines : découvertes de Claire Dumay, Doina Ioanid, Marcelline Roux - 6 avril 2018
- André Velter, N’importe où - 1 mars 2018
- Ecritures féminines : découvertes - 1 mars 2018
- Carole Carcillo Mesrobian et Jean Attali, Le sursis en conséquence - 26 janvier 2018
- Les carnets d’Eucharis, La Traverse du tigre, hors série - 26 janvier 2018
- Baptiste Pizzinat, Les mots rouges - 26 janvier 2018
- Bernard Fournier, Lire les rivières, précédé de La rivière des parfums - 22 novembre 2017
- Robert Desnos, Nouvelles Hébrides suivi de Dada-surréalisme 1927 - 22 novembre 2017
- Jacques Demarcq, Suite Apollinaire - 22 novembre 2017
- Jacques Demarcq, d’ubu fait dure loupe - 22 novembre 2017
- Les cahiers du sens, 2017, n° 27 - 11 octobre 2017
- Le Journal des poètes 2, 2017, 86e année - 11 octobre 2017
- Dissonances – Le Nu - 30 septembre 2017
- Fil de lecture autour de Marilyne Bertoncini, Denis Emorine et Jasna Samic - 29 mai 2017