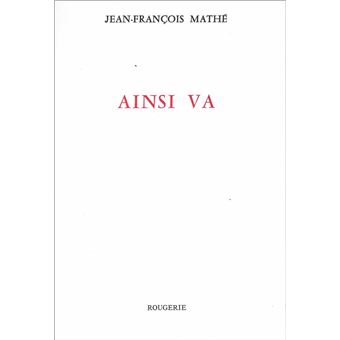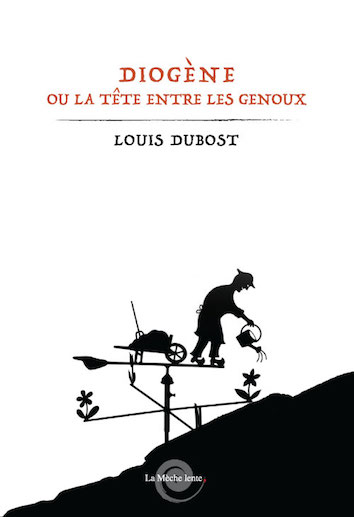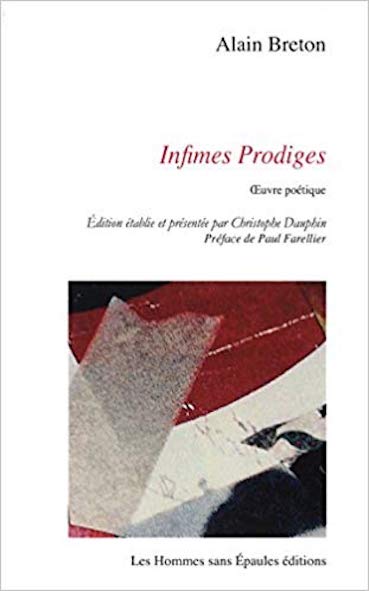Les éditions Rougerie, basées à Mortemart, en Haute-Vienne, ont publié en avril 2018 deux ouvrages de poètes figurant de longue date à leur catalogue : Jean-François Mathé (Prendre et perdre), et Olivier Deschizeaux (Ours).

Il s’agit de deux volumes sobres où se reconnait la facture de la maison Rougerie : couverture blanche, impression du titre en rouge, livres non massicotés nécessitant une intervention physique du lecteur : ces livres, il faut décider de les lire, et, pour ce faire, s’emparer d’un bon couteau qui évitera d’endommager les pages. Notons toutefois qu’Olivier Rougerie n’a pas imprimé les livres « à la maison » mais chez un imprimeur local.
∗∗∗
Jean-François Mathé, Prendre et perdre
Le recueil de Jean-François Mathé, où l’on reconnaîtra la manière de l’auteur, en particulier un art de filer la métaphore, rarement démenti d’une publication à l’autre, semble parcouru par de grandes ombres noires. En effet, le décor évoqué par les poèmes, parfois un peu parnassien (arbres, oiseau, ciel, étoiles, nuages, fleurs), sans qu’il y ait ici la moindre nuance péjorative, mais plutôt l’intention de signaler que l’auteur s’appuie sur une longue tradition poétique, se trouve peu à peu rongé par une inquiétude, vague d’abord, puis de plus en plus prégnante au fur et à mesure que l’on progresse dans la lecture. En vers tantôt libres, tantôt mesurés et rimés, l’auteur exprime nombre de pensées délicates et ingénieuses. Trois parties distinctes scandent cette progression des ténèbres, ou vers les ténèbres : Vivre au bord ; Passage entre chien et loup, Débuts de dénouements. Quelque chose de grave se joue dans cette poésie. On passe insidieusement d’une vie en limite à un épisode crépusculaire, avant que s’amorce, sous la forme d’une hantise lourde, l’idée d’un glissement vers un ailleurs, ou un au-delà.
Revenons-en à la question de l’écriture. J‑F Mathé déploie souvent la comparaison ou bien file la métaphore : « J’ai vu passer,/comme des fourgons lourds et clos, / les nuits les plus noires, / maculées de la boue de nos rêves / qu’elles écrasaient. // Mais quand au matin / on dételait les chevaux / qui les avaient tirées / eux étaient toujours / blancs et sans taches. // Où est le vrai de la vie ? » (p.22). Il y a là, dans une vision presque baudelairienne (pensons à « Spleen »), un souci de cohérence, de densité, de construction, voire de démonstration, dans lequel l’image perd peut-être en surprise ce qu’elle gagne en cohérence. Le choix du « nous » (nos rêves) confère volontiers à ces textes une dimension moraliste : J.-F. Mathé donne le sentiment de vouloir, tout en les exprimant, dépasser des inquiétudes personnelles, interroger notre condition, créer une connivence avec le lecteur, à qui on laisse entendre que les expériences vécues sont aussi les siennes. Autre exemple : « Vieux voyageur devant l’éternel / tu avais fait de nous tes auditeurs / pour que les innombrables feuilles / qui bruissaient en toi /et que l’âge allait bientôt dessécher / se greffent et revivent / aux branches nues encore de notre jeunesse. // […] quand tu te taisais, nous étions devenus / des oiseaux perchés à la cime d’un rêve / et dont le cœur battrait bientôt / plus vite que les ailes, après l’envol / vers les étonnements que tu disais plus nombreux / dans la vie que la foule d’étoiles dans ta fenêtre » (p.12).

Jean-François Mathé, Prendre et perdre,
Editions Rougerie, 2018.
J.-F. Mathé mêle ici l’anecdote au symbolique : l’arbre « réel », dont la figure, personnifiée, ramifie dans tout le poème, appelle l’oiseau, l’envol, les « étonnements », les « étoiles ». Le « nous » inclut de nouveau le poète dans une communauté, réelle ou symbolique, restreinte ou universelle, c’est selon.
On en vient parfois à se poser la question du « poétique » et de « l’image » (comparaison, métaphore…), singulier rapport au monde, à soi, au mot, qui devrait, selon nous, excéder l’idée d’un simple enjolivement : « J’ai regardé le ciel / soulever des oiseaux blancs / […] // Et qu’ils volent ou se posent, / le monde reste / un arbre multicolore / aux fruits ronds et pleins » (p.10). Vision rassurante, évoquant plénitude et permanence, « vision de poète », pourrait-on dire, en contradiction flagrante avec la représentation contemporaine d’un monde et d’une nature humiliés, moribonds et menacés à brève échéance par la dégradation, l’anéantissement. J.-F. Mathé délivre ainsi la vision d’un paysage intérieur fait d’harmonie, que l’on craint de quitter : en effet, c’est, dans un univers presque virgilien, la disparition du sujet qui semble au cœur du recueil que nous sommes en train de lire. Rappelons à ce propos la définition que donnait Casanova de la mort : « La mort est un monstre qui chasse du grand théâtre un spectateur attentif avant qu’une pièce qui l’intéresse infiniment finisse » (éd. pléiade, p.12). J.-F. Mathé, toujours sensible au spectacle du monde, interroge notre disparition, en tant que personne, et le fait avec émotion. Sans doute la conscience de cette disparition conduit-elle à magnifier le réel. Le poète est en outre bien présent dans le tableau qu’il compose : « On avait versé le café dans les tasses / et dans chacune maintenant / tremblait un îlot de nuit / que tu regardais / comme quand tu attends les étoiles / dans tes ciels nocturnes. / Les autres riaient haut, / forts de la force de midi / et de l’immortalité qu’ils croyaient y puiser. / Ils buvaient d’un trait / et toi si lentement que tu semblais retarder / le moment où le vide de la tasse / s’emplirait du vide de ta vie » (p.61). L’image finale, paradoxale, appelle le néant. Fin de partie ? La vie comme une tasse de café, bien noire et bien amère à la fin, que l’on ne se hâte pas de terminer. L’image, polyvalente, apparaissait dans un recueil précédent, à propos d’un couple d’amoureux, au matin, face à une tasse de café (La Vie atteinte, Rougerie, 2014, p.15).
La mort encore : « Une fois le vent tombé, / me reste un arbre nu en travers du regard. / Je cherche ses feuilles / comme si elles avaient emporté / les battements de mon cœur. Mais la porte est ouverte / et m’appelle, nu, à étreindre l’arbre nu, à accepter en moi comme lui les a acceptées / les racines par où / naissent mêlées la vie et la mort » (p.67). L’arbre, finalement, figure poétique majeure du recueil, donne une leçon de sagesse : accepter notre condition, la mort notamment, cette grande force noire surgie de l’obscur de la terre.
Prendre et perdre. En fin de compte, c’est de notre vie qu’il s’agit : nous prenons : jouissons des dons de la vie et de la terre ; puis nous perdons : ce lieu, il faut songer à le quitter. Rien que nous ne sachions déjà, en somme, mais J.-F. Mathé nous propose une forme de méditation personnelle nourrie d’expériences sensibles, où la nature, les anecdotes du quotidien, les insuffisances du corps, du souffle, la beauté du monde sensible, dans ses aspects parfois les plus traditionnels, « poétiques » pourrait-on dire, apparaissent comme autant de célébrations mélancoliques d’un plaisir de vivre. En témoignent les nombreuses dédicaces placées en épigraphe, lesquelles célèbrent l’amitié, on l’imagine volontiers.
∗∗∗
Olivier Deschizeaux, Ours
Le ton change avec Olivier Deschizeaux qui, d’emblée, dans son recueil sobrement nommé Ours, évoque des racines espagnoles : « Gloire à l’ombre qui plonge dans la rivière noire de peine et sombre en ses flots, le ciel est notre territoire de déraison, notre hiver. // Le négoce du duende se fait dans le sang. // Une neige brune, poisseuse grignote mes yeux de mauvaise vie et mes lits d’inconstance » (p.7). Le poète se réfère à une notion, le « duende », à laquelle, par le passé, Federico Garcia Lorca avait consacré une réflexion développée dans une conférence de 1930 : « Jeu et théorie du duende ». La « mauvaise vie » et « les lits d’inconstance » évoquent l’image d’un « picaro » de la poésie.
De fait, l’image du picaro, ce personnage truculent et vivant d’expédients, issu de la littérature espagnole, apparaît explicitement à la page 36 du recueil, comme pour confirmer cette intuition initiale : « Sans doute ai-je plus à gagner au cœur picaresque qu’à la valise amputée ». O. Deschizeaux tient manifestement à donner une vie poétique à des racines espagnoles, ne serait-ce qu’incidemment : « sur l’autel au cœur de braise le fou respire ce qui reste d’adn à notre saint curé, d’el paso à séville c’est toujours le même aigle qui s’envole » (p.10). Notons, au passage que tout est nom commun dans les poèmes en prose constituant Ours : lyon, séville, gargantua, xanadou, le rhône, le jourdain, etc., sont dépourvus de majuscules. Cette poésie récuse le nom propre : tout y est donc commun.
La nature ursine du recueil attendra la page 51 pour connaître un semblant de dévoilement : « Je suis un ours à l’âme orpheline depuis que tu n’es plus là, alors merci pour les souvenirs, les soleils de juillet com[m]e ceux d’octobre, merci pour la mort et l’amour, merci pour les larmes » (p.51).

Olivier Deschizeaux, Ours,
Editions Rougerie, 2018.
Le poète que l’on a fait coïncider avec la figure d’un imprécateur révèle tout d’un coup une nature humaine, l’empreinte d’un chagrin. On comprend plus loin qu’il s’agit de la figure de la mère, disparue, réellement ou en idée, qui peu à peu s’impose comme la destinataire du recueil : « Maman n’est plus là, la mort peut-être, l’amour sans doute, elle n’est plus ni dedans ni dehors, brisée par la démence, elle nous a quittés en claquant la porte d’un revers de la raison, elle est loin maintenant, assise en pleurant quelque part dans une grande maison aux murs blancs » (p.59). La dernière prose confirme l’hommage et le chagrin : « Je dépose une gerbe de flammes sur l’herbe de ton âme, ô maman qu’ai-je oublié de toi en cette grande nuit » (p.61). L’image de l’ « ours à l’âme orpheline » s’explique alors aisément.
Le recueil surprend en effet par sa véhémence. Il est constitué de proses assénées au lecteur, de phrases gnomiques, ou sentences souvent paradoxales : « Nous engloutissons des oranges laissées par des livres trop absurdes, la surréalité des voyants n’a nul besoin de boule de cristal » (p.23) ; « La poésie est ma phobie la plus vaste » (p.32) ; « […] je n’oublie pas que l’enfance est ce qui peut arriver de pire à un homme » (p.44). Tout cela évoque quelque peu les mânes de René Char, voire des surréalistes.
On a parfois l’impression que le texte est habité par l’âme de Lautréamont : « Dans ma cage fleurissent les ménageries humaines » (p.23) ; « je suis un cadavre prématuré, ouvert aux quatre vents, fermé à ce ventre de crinoline, ma cellule se couvre d’une crinière, mon pays est léonin » (p.15) ; ou encore, ces deux extraits évoquant pour le lecteur de poésie ce passage des Chants de Maldoror : « Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux quand ils me regardent vomissent » (op.cit., chant IV) : « J’étais sauvage, blême, ta peau incandescente ruisselait sur ma chair brûlée, tes pierres de carême dégoulinantes de chants obscènes ressemblaient à un fruit d’orage, comme une croix de feu pendue au soleil des nuits » (p.38) ; « Je suis un arbre sale, seul sur le seuil de ses silences, je n’ai pour son cœur que battements de porte et raison morte, il est des villes plus périphériques que les siennes mais les cloportes ne colportent plus d’amour en mon corps, c’est ainsi » (p.39). Mêmes images de corps, de cœur et de raison ravagés, même goût du « sale », du « dégoulinant ».
Ours, paradoxalement, est un ouvrage cultivé. Les références y abondent. Nous évoquions à l’instant les surréalistes, qui vénéraient Lautréamont. Il se trouve qu’ils avaient également de l’intérêt pour le marquis de Sade, dont la présence nous semble perceptible dans cet extrait des proses d’O. Deschizeaux : « Les chambres de mon âme sont occupées par les égéries du vice érigées là par des marquis de dux, vieillissant comme des venises perdues en eau de bohême avec pour seule bohème la terreur d’un sexe aux obsèques frelatées. » Il s’agit-là d’une évocation complexe : Dux et Venise rappellent Casanova, né à Venise, mort à Dux, en Bohême, où il écrivit Histoire de ma vie. Mais Casanova n’a jamais été marquis, à peine chevalier de Seingalt, ce qui n’est pas le cas de Sade. Sans doute y‑a-t-il ici association de ces deux figures subversives, chacune à leur façon. Le rapprochement « égéries / érigées » vient nous rappeler en outre, mais nous y reviendrons qu’O. Deschizeaux travaille la matière sonore des mots.
Pour en finir avec les références, disons qu’O. Deschizeaux évoque vraisemblablement les figures qui lui tiennent à cœur et structurent sa poésie : on reconnait la figure de Rimbaud, plusieurs fois : « zutique » (p.52), « argenterie rimbaldienne » (p.36), celle de Kerouac, avec les « rouleaux de big sur » (p.48), voire celle de Louis-Ferdinand Céline, avec « Bardamu », autre héros picaresque (p.54), ou encore de Rabelais, avec « Gargantua » (p.44). Le « duende » n’est pas étranger à Lorca et le ton général oscille entre la Saison en Enfer et Les Chants de Maldoror.
Du point de vue de l’écriture, l’auteur joue beaucoup avec la matière sonore du langage, qu’il s’agisse des « égéries / érigées », des « cloportes / qui ne colportent plus d’amour », déjà cités, mais encore : « je les nomme de mon faix assombri » (p.9), où l’on reconnait l’expression toute faite de « fait accompli ». Les exemples en sont assez nombreux pour que nous nous contentions d’attirer l’attention du lecteur sur un fait qu’il constatera de lui-même.
Comme Apollinaire, en 1913, introduisait en poésie « avion », « automobile » et « sténo-dactylographe », O. Deschizeaux utilise « adn », « azerty », « drone », « boycotter », « cowboy », etc. Cela donne à ce recueil l’allure d’une fête langagière.
Parfois, même, on devine la tentation, diabolique, de subvertir les textes religieux : « Je ne suis riche d’aucune misère. // Toute misère est pauvreté. // Du père du fils comme de l’esprit saint je suis le défunt et le craquement sain, amen // Festin des gisants, hosanna, hosanna. // Nationale vallée, visions saturniennes, des sept églises » (p.20).
Alors, poésie d’énergumène, au sens étymologique, sans doute, et c’est bien ainsi. Espérons que le poète ne soit pas un vrai prophète et se trompe sur ce point : « Plus personne ne te lit, poète, ta lyre est un lit de mort » (p.29).
À noter toutefois : la présence de quelques coquilles dans un ouvrage à l’impression soignée, ce qui démontre que la relecture reste un art difficile : « come » (p.51) ; « que nous seront » (p.19), « à l’aunedes reflets » (p.49), etc.
∗∗∗
Olivier Rougerie a ainsi, sans doute est-ce une coïncidence, publié simultanément deux ouvrages différant par la forme ; le contenu épousant, semble-t-il, la grande variété des souffrances humaines. C’est le mérite d’une maison d’édition, nous semble-t-il, de rester ouverte à la diversité des talents, des voix poétiques, de ne pas s’enfermer dans une « ligne éditoriale » trop restrictive, d’accueillir la poésie quelle que soit la forme dont elle se revêt, à partir du moment où elle s’appuie sur une expérience que l’on peut qualifier d’authentique.
- Daniel Brochard, 13 - 6 octobre 2021
- Russie. L’Immense et l’intime - 20 avril 2021
- Mathias Lair, Écrire avec Thelonious - 5 janvier 2021
- Laurent Faugeras, Les Joues mordues - 21 mars 2020
- Joëlle Pétillot, Le Bal des choses immobiles - 26 février 2020
- Autour des éditions Rougerie - 6 novembre 2019