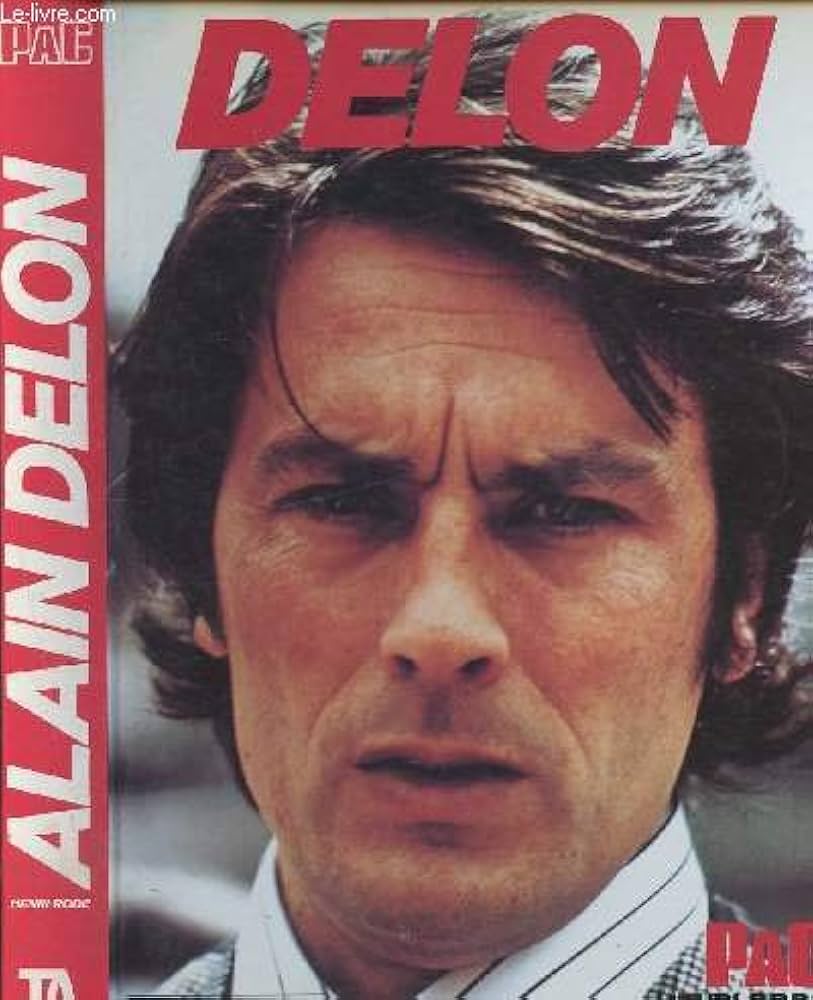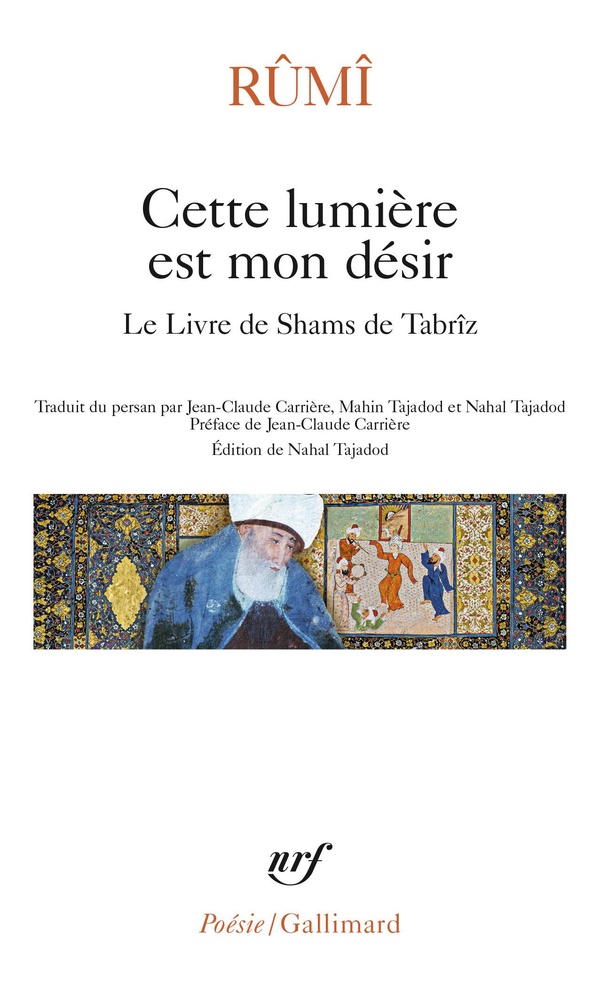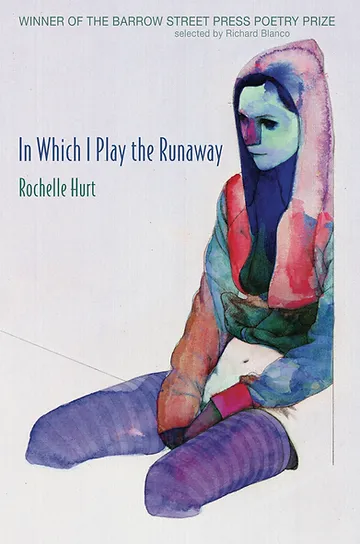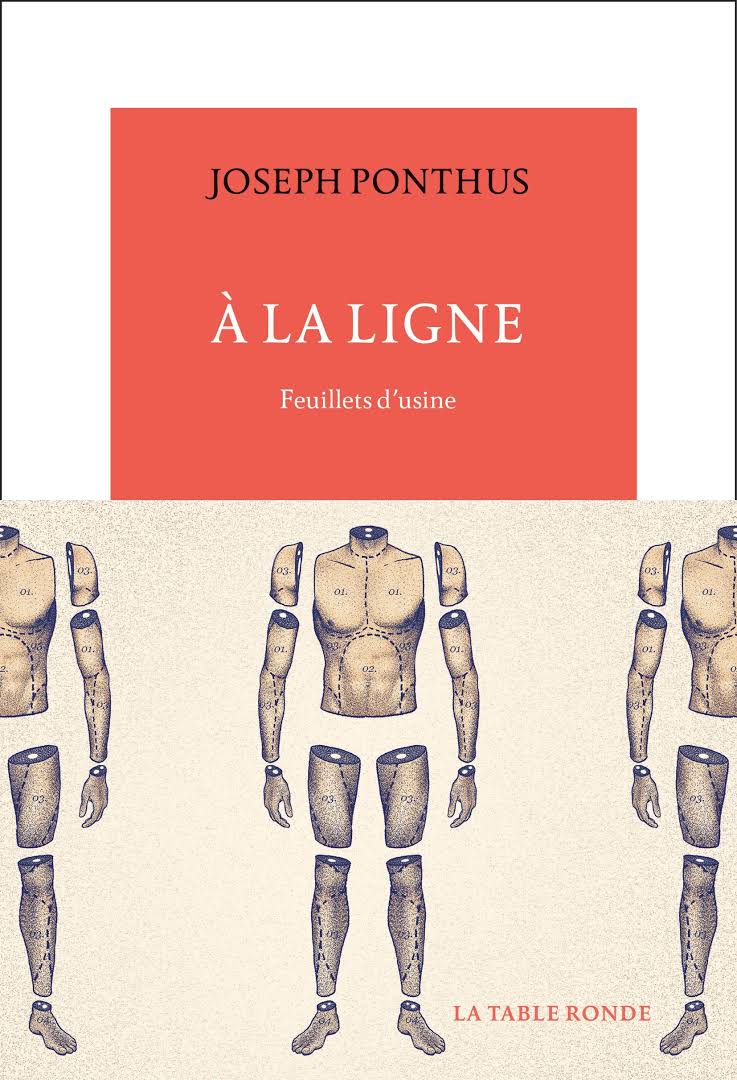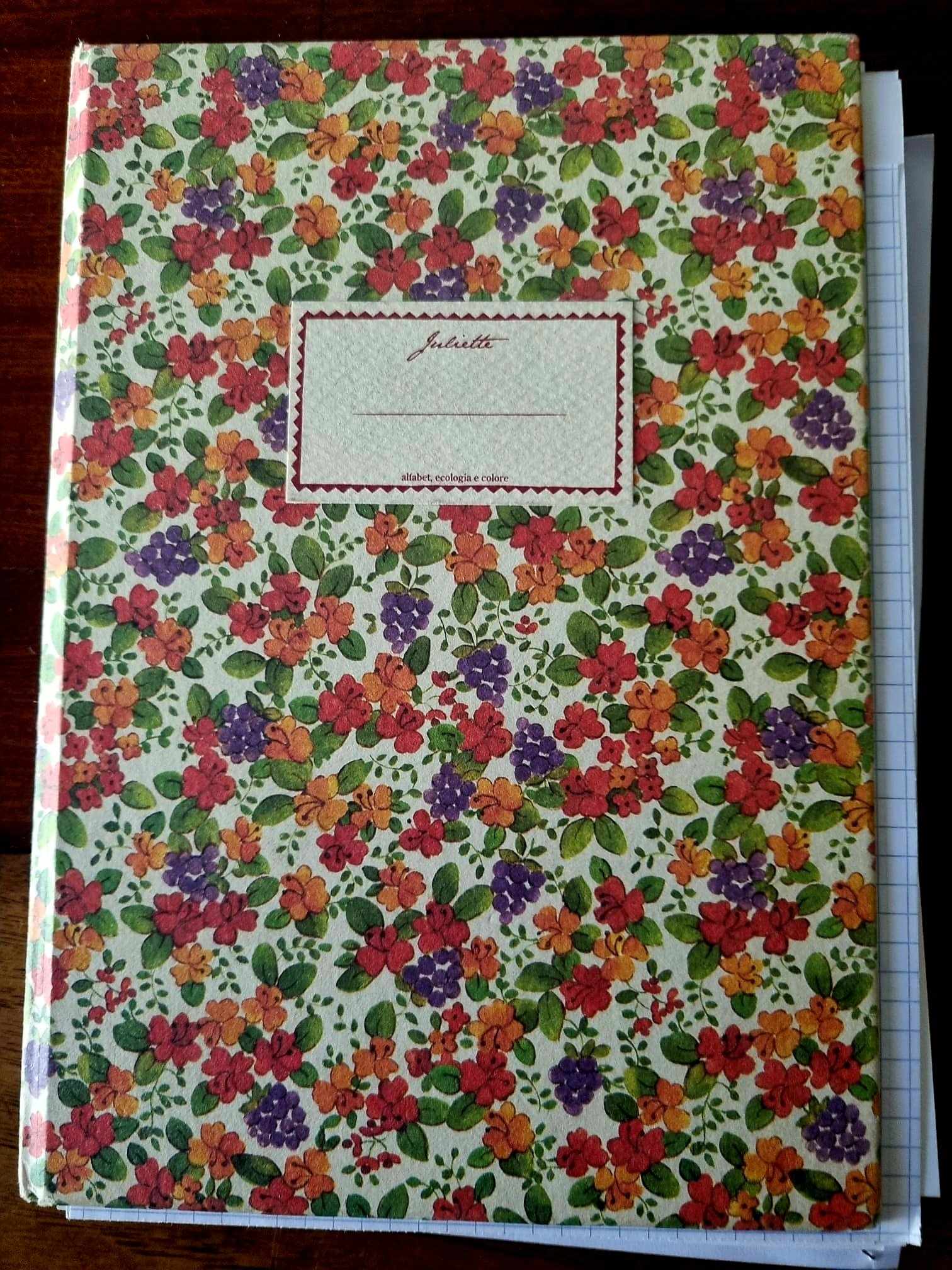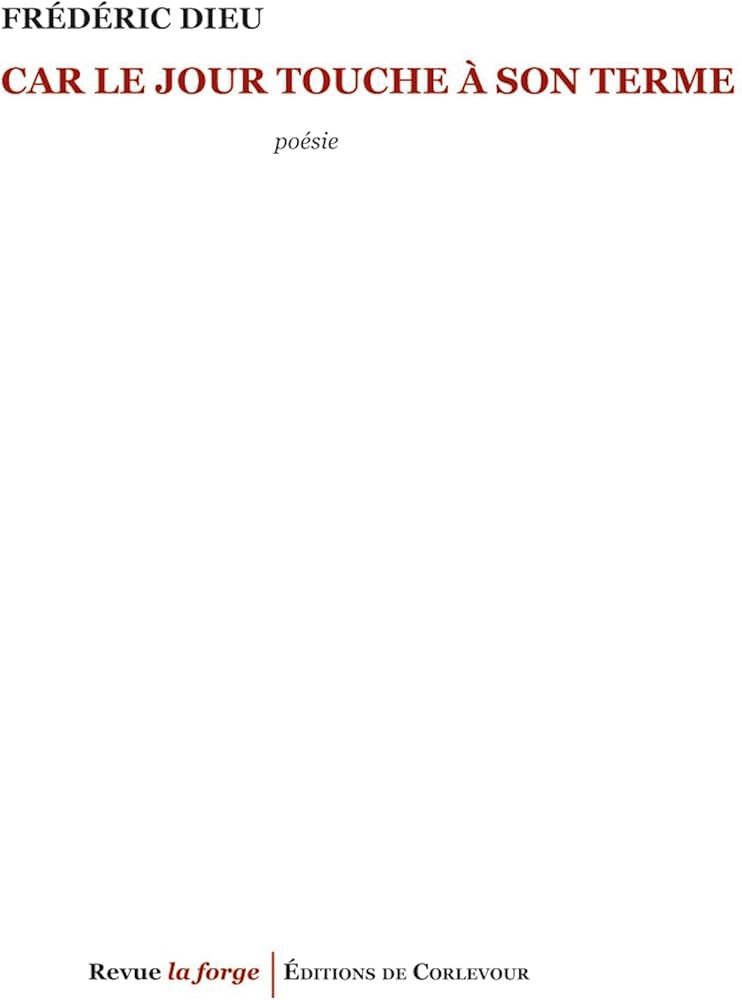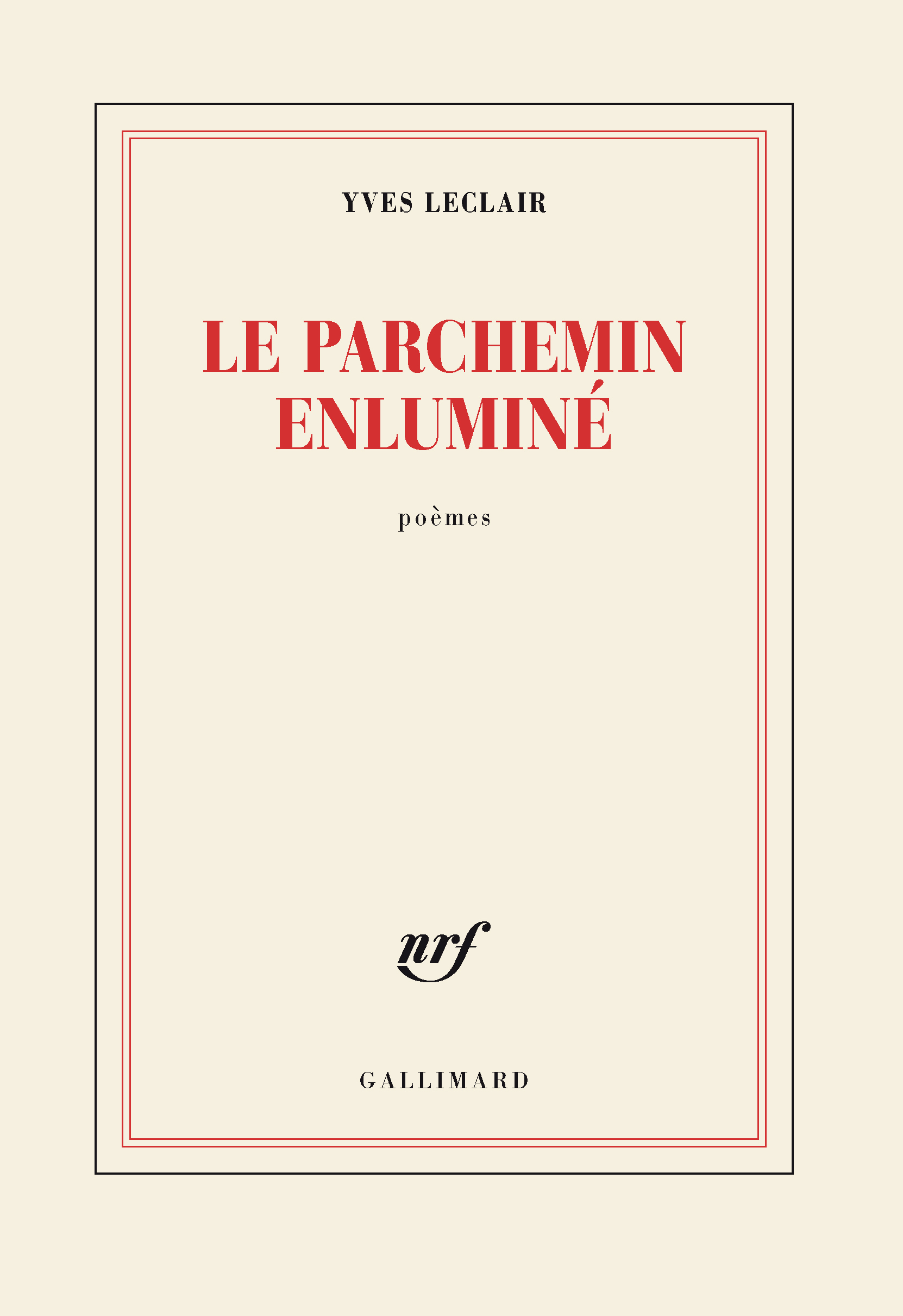Je ne sais pas quelles facultés on prête encore aux poètes. Depuis deux cent ans, mon poète intérieur (j’imagine que nous avons tous un peu le même) a du mal à supporter sa propre image, et maintenant, c’est l’évidence, personne n’oserait revendiquer (à haute voix) les pouvoirs qui en faisaient autrefois un être magique, voyant.
Les romanciers sont plus facilement en accord avec leur ascendance, surtout quand ils réveillent Don Quichotte, sans doute parce que Don Quichotte ne représente aucune autorité dont on pourrait se réclamer, sinon justement celle de son déclin, de sa caricature, alors que les poètes ont besoin encore (on en reviendra peut-être un jour) de se cacher l’auréole, comme si une image leur collait à la peau dans laquelle ils ne veulent pas, ne peuvent pas se reconnaître. Des exemples ? Pourquoi pas le poème d’un poète assumé, un géant discret, Pierre Morency :
Pierre Morency, à la Nuit de la poésie, en 1970.
Je n’ai jamais non jamais
Marché d’ahan
Jusqu’à ton ciel
Mais voudrais bien le voudrai toujours
Pisser debout
Jusqu’au bout
De mes jours.1
J’y lis une déclaration d’amour à la pesanteur, l’orgueil assez rare d’être un simple Terrien, qui choisit d’être mortel (et de pisser fièrement) comme certains héros de l’ancien temps préféraient un repas chaud à une promotion chez les dieux.
Ce vieux serment, la conversion des mages à la mortalité, l’engagement à ne pas nier la condition terrestre, j’ai cru le retrouver chez Michaël Trahan, quelque part dans La raison des fleurs : « je n’appelle pas l’énigme ou la figuration d’un monde obscur », ainsi commence une sorte de déclaration d’humilité, un parti pris pour le multiple, les choses périssables que personne ne remarque : « un train, un morceau de vitre ramassé par terre, une feuille, un bloc d’émeraude ou de lumière, un regard, une rencontre, un désir inassouvi », et l’inventaire continue, il pourrait continuer sans fin. Mais voilà une fleur dans laquelle tout cela se résume :
La blessure jetée au feu, jetée
dans la terre – la fleur,
l’histoire d’une fleur,
l’histoire d’une fleur qui dort
l’histoire d’une fleur dans le miroir,
l’histoire d’une fleur morte
et enterrée.2
UN POÈME POUR TA VOIX est constitué d’une série de sept capsules vidéos mettant en vedette huit jeunes du Collège Jean-Eudes en concentration théâtre au 3e secondaire. Ces huit jeunes ont prêté leur voix et leur talent au choix de poèmes de l’écrivaine Annie Lafleur, avec la complicité de leur professeur et metteur en scène, Hugo Turgeon. Les capsules vidéos ont été filmées par le photographe et vidéaste Alain Lefort au Parc du Portugal et à la Librairie Paulines à l’hiver 2017. Ici Guillaume Legault lit un extrait de Nœud coulant de Michaël Trahan.
Rien qu’une fleur, mais en même temps une histoire qui cherche un dénouement, le symbole d’une blessure prête à retrouver la terre. Je me souviens que, quand Geneviève Amyot lisait ses poèmes, sa voix nous creusait jusqu’à la blessure première, on devenait automatiquement plus vrais d’entendre une aussi grande faiblesse en partage, et je ressens cela maintenant dans cette fleur qui désarçonne. Qui me dit : je suis la beauté mortelle, la beauté jetable, et toi aussi.
Oui, mais remarquons aussi à quel point le poème est en contradiction avec lui-même. Alors qu’il renonce dès le début à nommer l’énigme et le monde obscur, il nous laisse au bout du compte avec un secret dans la main, un élément qui détient tout, dirait-on, sans qu’on puisse dire ce qui fait justement la raison des fleurs, ce monde ou cette logique obscure dont la fleur est le fruit. Alors qu’il semble opposer l’énigme et la blessure, renoncer à l’une pour mieux épouser l’autre, j’ai impression qu’il m’invite ensuite à les voir l’une dans l’autre, pas seulement parce que la blessure est elle aussi une énigme qui nous attire dans l’obscurité, mais parce qu’elle ne peut qu’être liée à la perte. La perte de quoi ? Mystère. Quand le regard se tourne vers la blessure (car nous sommes des êtres blessés), on dirait qu’on s’enfonce et c’est vrai, mais on est aussi en train de remonter le courant. Trahan écrit d’ailleurs, un peu en amont : « La raison des fleurs est leur secret. Le secret est lié aux pierres. C’est le blanc du cœur.3 » Plus on descend dans le multiple, dans une fleur, plus on remonte à la raison des fleurs, plus on creuse l’énigme, la source (il faudrait ici un adjectif, mais c’est une sorte de Protée qui m’échappe) du réel. La légende veut qu’on s’apprête ainsi à voir d’où sortent les atomes de fleurs et de montres brisées. C’est cela qui peut, qui veut devenir conscient.
Ce n’est qu’un exemple, un beau. Il est clair que la poésie contemporaine peut descendre encore plus bas. Je ne dis pas cela péjorativement. Je pense que personne ne prétendra le contraire : depuis quelques années (ou depuis Baudelaire, William Carlos Williams, Francis Ponge, Patrice Desbiens…) le bas a un coefficient poétique nettement plus élevé que le haut. La poésie se donne probablement l’impression d’être plus véridique en tournant le dos aux alibis, à la grandeur illusoire, aux refuges. Le dernier rôle qu’elle voudrait incarner est le corbeau Moïse, dans La ferme des animaux, qui croasse l’oubli de nos malheurs en faisant miroiter un endroit magique au-delà des nuées, Sucrecandi.
Et pourtant, je ne sais pas pour la résolution de tous les conflits sur Terre, mais la paix, la joie existent, et ne sont pas moins illusoires ou passagères que les tourments. En réalité, ce n’est ni la joie ni les tourments qui nous attirent par en bas – peut-être simplement qu’on nous a menti sur le haut, qu’il nous a déçu, qu’il ne reste plus maintenant que la direction inverse, l’entrée volontaire dans le dépérissement qu’on redoutait. C’est une citation que j’ai égarée (j’ai même lancé un appel sur Facebook…) mais je me souviens d’une jeune poète qui parlait d’un ciel qui n’a pas à descendre dans la main, qui peut bien rester là-haut. Elle n’est pas la première à tourner le dos au ciel, même les mystiques ont souvent trouvé plus sage, pour monter au ciel, de renoncer à son idée, à son fantasme. À même son incertitude, le bas semble en effet plus sûr, c’est la voie du concret, le refus des mirages, ce n’est pas un endroit où partir, c’est l’endroit où l’on est. La poésie, du moins celle qui s’écrit vers le bas, ne veut pas foncièrement être heureuse. Elle veut ne pas mentir. Elle veut vivre, et vivre d’abord par le sentir. Elle veut toucher quelque chose dans un grand flou.
Je crois qu’elle aspire au fond à cette chose proche et imprenable : la vie tout court. On peut imaginer l’aventure de l’imaginaire québécois comme la concrétisation inachevée d’un esprit dans le temps, une très lente entrée dans la matière. Il fut un temps, à la fin des années 1950, où le journal Le Devoir invitait les écrivains à se prononcer sur des questions essentielles, et chaque fois on revenait au diagnostic d’Anne Hébert : « Quand il est question de nommer la vie tout court, nous ne pouvons que balbutier.4 » C’est un vieux thème, au Québec et en Occident, l’irréalité. Ce qui m’étonne, dans cette tradition que Pierre Vadeboncœur appellait « le lieu de notre irréalisme5 », c’est qu’elle a concerné d’abord les choses ordinaires. Les vieux monseigneurs n’étaient peut-être pas les plus dégelés de la boîte, mais eux aussi avaient remarqué un décalage au premier degré. Au début du 20e siècle, Camille Roy lui-même partageait déjà l’impression d’Hébert : « Le poète et le romancier restent trop souvent à la surface des choses ; ils ne savent peut-être pas assez voir avec leurs propres yeux ; ils ne touchent et ne palpent pas assez eux-mêmes les êtres et la nature qui les entourent.6 » Évidemment, le régionalisme ne fera pas mieux qu’Émile Nelligan, l’aîné tragique, il fera pire, et toute une tradition de lecture s’efforcera ensuite de découvrir le vrai visage de cette ascendance glorieuse et/ou fantomatique. Dans Il fait un temps de bête bridée, Mathieu Simoneau revient sur cette lignée silencieuse et tristement bouffonne :
le silence est un vieux hit
que nos ancêtres
dansaient jusqu’à la mort7
Queen Ka lit un extrait de Là où fuit la lumière du jour de Rose Eliceiry.
L’image fait sourire, mais ici, le sarcasme est attendrissant. Il nous rattache à « l’héritage de la tristesse » dont parlait Miron, la « tristesse atavique8 » dira Hugo Beauchemin-Lachapelle. Visiblement, nous sommes toujours équipés pour la ressentir. On la découvre encore en soi, comme Rose Eliceiry :
nous sommes d’une race sans figure
n’avons pour héritage que la fuite du monde
peu importe maintenant si nous ne bougeons plus
si nous ne pleurons plus
nous avons rattrapé le silence des ancêtres9
Ces quelques lignes n’ont pas d’époque, pas de nationalité, elles auraient pu être écrites dans les années 1960 ou en 2012, à Montréal ou Wapekeka. Mais comment ne pas y reconnaître aussi l’âge du silence canadien-français, l’héritage de la fuite, de l’illusion grandiose et de l’immobilisme ? Ce n’est pas pour rien si la modernité québécoise se fondera sur la nécessité de percer à jour les subterfuges, de rejoindre la réalité concrète, de prendre voix. Car Hébert, avant d’inviter ses contemporains au Réel absolu, parlait simplement d’ouvrir une porte, de nommer la honte, l’hiver, la vie qui va là… Poète mystique, Fernand Ouellette disait un peu la même chose : « N’étions-nous pas que des ombres ayant perdu tout contact avec le réel ?10 » En fait, sans refuser l’énigme et les mondes obscurs, ces écrivains pensaient que la recherche des fondements exigeait de se détourner du haut, de consentir au poids du corps et au multiple, de passer par les chemins qui mènent au parc, à l’ouvrage. Toutes les quêtes d’absolu des personnages de roman d’Après-guerre étaient là pour en témoigner : le risque était de se désengager plus encore de soi-même et du monde.
C’était du moins le pari des modernes, leur promesse : affronter délibérément l’irréalité finirait par nous réaliser, nous mettre au monde. La question n’est pas de voir si la promesse a été tenue (je ne pense pas qu’elle finira jamais de l’être), mais simplement de nous demander si nous y croyons encore. Je doute que nos contemporains soient engagés avec autant de ferveur sur une voie libératrice, ça dépend des démarches, mais il est absolument certain que la poésie s’écrit plus que jamais dans la direction du moindre. Au début du siècle, un poète sur le motif, Albert Lozeau, appelait ça « une prédilection pour le fini11 ».
C’est pourquoi cette poésie demeure très désinvolte (parfois un peu ostensiblement) avec les images de la consécration – la pureté, le sublime, l’éternité… – comme si on risquait encore de sombrer dans le séraphisme. Les immortels comme Villon ou Rimbaud, on les invite à prendre un drink, on imagine Nelligan dans son premier char (en général, les poètes d’aujourd’hui préfèrent René Char à Vincent Voiture…), on avoue sans problème que « chaque matin prend une éternité / à s’écrire / comme du monde12», qu’on a « jamais su écrire comme il faut13 », qu’on fait « semblant d’écrire un bon livre14 », qu’il vaudrait peut-être mieux « scrapper tous [s]es poèmes15 » au lieu de publier des inepties : « si tous mes poèmes ressemblent à des statuts facebook / c’est sûrement parce que c’est tout ce que je fais de mes journées16 ». Difficile de critiquer une poésie qui n’a aucun mal à se ridiculiser elle-même. Ça se veut évidemment tout sauf une convention socialement acceptable, mais ça représente assez bien ce qu’on aime entendre dans les soirées de lecture depuis quelques années. Et quand je lis : « oh non / j’ai écrit estie / je n’aurai pas le prix émile-nelligan17 », je souris, la provocation sonne plutôt bien. Ce serait déjà une bonne raison de rêver à un prix, si (comme je le répétais aux étudiants en création littéraire, pour ne pas les décourager) les prix servent à récompenser les œuvres qui correspondent puissamment au goût de l’époque. Moi qui observe le regain d’engouement pour la poésie, de mon village dévitalisé des Appalaches (on a les poses qu’on peut), je me dis que l’institution se porte bien, si elle engendre des effets de mode à contre-courant, une mondanité off. Les normes ont bien changé… « Il est fini le temps des poèmes étincelants18 », écrit Simoneau, ce « beau poème blanc / pacifié de nos déchirures19 » que l’on récitait à voix profonde.
Gaston Miron, Le Temps de toi.
Or, même avec toute l’autodérision, tout le détachement du monde, la poésie répond d’une vieille exigence. Elle est plus que jamais soumise à un principe d’authenticité. Elle doit s’enraciner dans son contraire, aller vers ce qui la tue. Simoneau évoque d’ailleurs le « non-poème20 » de Miron, qui désignait ainsi les conditions de l’inachèvement collectif, tout ce qui avait fait de nous (je parle du Québec, mais c’est aussi l’humanité qui parle) des spectres agités :
Le non-poème
c’est ma langue que je ne sais plus reconnaître
des marécages de mon esprit brumeux
à ceux des signes aliénés de mon irréalité21
L’errance, le mal parler, l’incoïncidence à soi, au monde, la confusion, je nous reconnais là encore, je n’ai pas de mal à sentir la fatigue du « non-poème » un peu partout. On dirait même que les forces négatrices se sont multipliées ; elles viennent de plus loin que l’horizon du pays. Mais là où Miron se braque, clamant que « le poème ne peut se faire que contre le non-poème », je nous trouve moins dans l’insurrection. La poésie guerrière n’est pas morte, elle rebondit chez François Guerette, Daria Colonna ou Annie Lafleur, mais dans bien des cas, je ne sens pas qu’on pourrait dire : « Le poème ne peut se faire qu’en dehors du non-poème.22 » En fait, on nous propose exactement le contraire – écrire à partir du non-poème, peut-être même le fertiliser. On se croirait installé dans le désoeuvrement, la prose des jours. La voie mironnienne était une voie héroïque, elle plongeait dans l’abîme pour nous en déprendre ; la voie prosaïque est moins une voie qu’un aménagement, une manière assumée d’habiter dans la brume. L’humiliation est revendiquée avec une sorte d’indolence, comme une chose assez normalisée, dilatée dans le temps :
J’oublie
ma tête
j’oublie
de grandes choses
ma tête est encore en vacances sur une plage
je ne la trouve plus
je suis revenu
mais je ne la trouve plus
mourir demande du temps
je déboule les escaliers
depuis mes 12 ans23
Gaston Miron, Les Années de déréliction.
Jean-Christophe Réhel a inauguré pour moi une nouvelle catégorie d’écrivains, les rois de rien, les chiens dans les jeux de quilles, j’ai même lu, dans une critique : on a juste envie de le prendre dans nos bras. Pas de doute, c’est bien l’autodénigrement mironnien, la tête de vie qui fait défaut, mais un humour pathétique aussi généralisé est beaucoup plus proche de L’hiver de force de Réjean Ducharme : « la moindre des choses est de m’engager dans la fatigue24», écrit Réhel. On retrouve le même détachement chez Frédéric Dumont :
cette journée est beaucoup trop universelle pour moi
cette histoire de nuage me rend modeste
je ne peux pas sortir du lit dans ces conditions25
Frédéric Dumont, Volière (Hochelag).
Et le même empêtrement qui ne finit plus, le même refus ou l’incapacité de participer aux soulèvements, la même dérision généralisée, la même tendresse. L’irréalité a ici quelque chose de réalisée, c’est un habitat naturel, on l’épouse comme on prend un logement dans le gris, là où la beauté est plus rare, moins reconnue, moins vendable.
Écrire vers le bas, avec le sentiment subtil de ne pas exister vraiment, avec un pied dans les limbes, une moitié de soi qui n’est pas matérialisée, restée dans une abstraction normalisée, dans une présence absente ordinaire, réduite à la simple expression… J’allais faire un lien avec le Mauvais pauvre de Saint-Denys Garneau, mais ces poètes-là sont plus risibles, plus proches du narrateur du poème « Un bon coup de guillotine » (le dernier de Garneau) avec sa « tête de fou » posée sur le rebord de la cheminée. Non pas une colonne dépouillée, irréductible, plutôt un être nébuleux, désaxé, un nuage rempli d’écairs de chaleurs, coupé de son propre corps : « je me plie tout croche / dans n’importe quel tiroir26 », écrit Mathieu K. Blais. Il passe devant le miroir pour s’assurer d’être là. Même les repères les plus sûrs (ceux qu’on voit dans le miroir) ne tiennent pas le coup : c’est « comme si nous étions des fantômes / au milieu de cet espace vidé de nous27 », écrit Beauchemin-Lachapelle, et Geneviève Boutin : « Serais-je / un fantôme / une fixité ?28 » L’irréalité frappe les plus expérimentés d’entre nous, toujours au premier pas de la grande inconnaissance : « Je ne sais plus ce que signifie avoir un visage, avoir une histoire, et je me penche vers l’herbe glacée pour y chercher mon ombre.29» C’est presque la voix (pourtant très personnifiée) d’une absence au monde. Et aussi l’expression d’un désir d’être, qui n’est pas nécessairement en contradiction avec cette absence, qui s’écrit à partir d’elle.
Car il ne s’agit pas d’être plus, d’accumuler de la puissance, mais d’être enfin là où l’on est. L’existence devient alors une aventure assez discrète, la recherche quotidienne de points de contact :
j’aimerais écrire doucement
avoir du vocabulaire sans me sentir traître
m’incarner
le plus que je peux donner
ici
je veux trouver le réel30
Maud Veilleux, This is the present in drag.
Mais voilà : quelque chose dans cet acheminement vers le réel nous porte instinctivement vers un saisissement limite, la rencontre avec une « altérité totale31 », comme l’appelle Maude Veilleux. Elle parle ici d’une flaque de sang sur le plancher d’une usine, elle voudrait se télécharger dans la tête de l’employé qui doit nettoyer les restes après un accident. Et l’on s’aperçoit des avantages de n’être pas grand chose, de pouvoir se glisser comme un fantôme dans les consciences et les situations, un peu comme Mathieu Arsenault accoudé au bar avec son téléphone, dans Le guide des bars et pubs de Saguenay. Là encore, on sent l’attrait d’une altérité totale, l’attrait des bords du représentable, et c’est justement là (dans une sorte de virginité brutale) que l’art au sens large cherche à « entrer en relation avec le réel ordinaire.32 » Le téléphone portable devient la nouvelle technologie de la poésie directe, rendrait possible une captation pure. La difficulté est bien sûr d’observer les formes de la beauté locale dans leur habitat naturel, autrement dit de laisser le monde à son être. Artiste in situ dans un bar de Chicoutimi, créature dissonnante, Arsenault sait très bien qu’il va devoir passer inaperçu, et l’écriture téléphonique apparaît comme un moyen idéal pour voir sans être vu, pour entrer dans la vie sans soi.
« Pour entrer dans l’intimité des choses, écrivait Roland Giguère, se faire infiniment petit.33 » Je reconnais la même humilité chez Réhel, dans sa volonté de s’enfouir dans le moins du monde. C’est comme si le retour à la vie n’était possible que par un exercice de miniaturisation :
je veux vivre dans le bruit des feuilles
vivre dans tes courbes
vivre dans les reflets
vivre dans chaque reflet34
Jean-Christophe Réhel, extrait tiré du recueil La Douleur du verre d’eau.
La contradiction est de parler sans cesse de soi-même (ce que je veux, moi, pour vivre) tout en voulant réduire ses propres dimensions. Et c’est pourquoi l’autodérision est si précieuse. Plus l’image de soi rapetisse en effet, plus la réalité se met à exister plus fort, plus on est confronté à des banalités qui en mènent large, les « petites choses mondiales35 » dont parle Handke. Et comme elles n’ont rien de trop sublime, on peut s’étendre dans cette intimité des choses, la déplier dans toutes les directions, la développer comme une journée très longue. Alors, c’est presque le temps du roman, le temps de la prose. Le temps qui ne finit pas des canicules :
j’aime la peau visqueuse cette langueur c’est
comme vivre dans un hammam ou
se trouver tout entier dans un vagin qui t’aime36
C’est beau, ça frôle le ridicule, mais les gens ridicules (et qui le montrent) nous libèrent de nous-mêmes souvent plus en profondeur que ceux qui ont le couteau entre les dents. Il y a des moments où, comme au temps de Lozeau, on peut dire simplement j’aime sans chercher à vendre, sans vraiment croire à la force d’une image, et dans ce détachement donner la sensation du monde et d’en être.
Nous touchons là au moment où la perspective « hyperréaliste37 » se fait prendre en délit d’enchantement. C’était sans doute inévitable ; le mouvement ne s’est jamais contredit ; il s’agissait encore de descendre, de s’amoindrir, et la saleté s’est mise à briller. Même dans l’existence ultraprogrammée du narrateur « propre et fatigué38 » de La main invisible, l’ébahissement d’une certaine lumière est un accident possible :
j’attends l’autobus la lumière
est d’une beauté bouleversante le savent-ils
voient-ils sont-ils capables de mesurer leur chance
le monde est un spectacle gratuit et éternel39
On n’est pas loin de l’effet haïku. Mais les haïku apparaissent ici dans une trame prosaïque distendue, nonchalente, et haletante à la fois. Ils marquent un temps mort dans une anxiété générale, un point d’eau, le déclic de la réalité touchante, le croisement parfait du déclin vers le sol (ou le sofa, ou la mort) et d’un influx de grâce.
Il n’y a donc pas de contradiction entre une invocation très humble, du genre : « je ne demande presque rien / un chat éternel / une journée, bb » et, dans le vers suivant : « l’infini / tout40 ». Mais chez Veilleux, ces moments-là sont presque inexistants, et cette anémie est créatrice, elle enchaîne les « petits poèmes sur mon incapacité / à entrer en relation avec le monde41 ». L’explication pourrait tenir en deux lignes : « hier, j’ai trouvé un bout de papier collant dans mon vagin / le flow est un état mental que les anxieux ne vivent pas full42 ». Voilà un beau détail troublant, une sorte d’écharde oubliée, une poussière dans l’œil, un corps étranger qui me fait étranger à moi-même. On est ici dans le solipsisme, on s’épuise à répondre aux besoins d’une instance intérieure qui veut sans cesse, on aboutit toujours au même tête-à-tête étouffant entre soi-même et soi. On comprend le désir d’une altérité totale.
Comment sortir du rabattement quotidien, ce fond normalisé de désespoir, assez répandu ? J’ignore comment on peut nous en divertir aussi efficacement par tous ces dispositifs, tous ces rituels qui n’apportent finalement que du confort et l’illusion momentanée d’offrir une maison à son âme. Heureusement, la poésie qui s’écrit vers le bas est attirée par l’absence éclatante de la poésie. Charles Dionne la rencontre dans les appartements sécurisés, les sites de rencontre, une anxiété de l’ordre et de la propreté, Judy Quinn dans les banlieues américaines du Québec moderne retro :
Ce que nous appelons la matière morte
est aussi doué
de représentation soutenait Leibniz
qui pourtant n’est jamais allé
au 626 rue Hector-Fabre
pour coller des fausses feuilles
sur des couronnes de plastique43
Tombeaux pour les lieux, Rémy Bélanger de Beauport, violoncelle, Judy Quinn, textes.
La couronne de plastique est sans doute moins percutante qu’une flaque de sang dans une usine, mais on saisit bien la même altérité, le monde vide de sens, la déréalisation banale, en même temps qu’une intrusion de la matérialité du monde dans le poème. Une sorte de fausseté ou de mirage civilisationnel apparaît d’un coup, mais cette reconnaissance a quelque chose de lucide, de libérateur, elle nous fait un peu plus conscients de l’irréalité ambiante. C’est bien la solastalgie dont parle Antoine Boisclair, le sentiment que « tout se transforme, s’uniformise, s’appauvrit », cette « conscience malheureuse » que les lieux nous imposent tranquillement, et qui rend les Starbuck si mélancoliques :
C’était potentiellement partout simultanément
quelque part dans l’univers interconnecté.
Des êtres sans visage accoudés au comptoir
consultaient leur écran avec un air de qui sait tout.Dans quel Starbuck de quelle ville a lieu cette scène ?44
Comme chez Quinn, on est frappé ici par un décalage entre les premiers vers et les suivants, entre une perspective élargie, fondamentale, et l’abstraction du réel immédiat. Et toujours cette routine étrangement mêlée d’indifférence et de petites obsessions qu’on reconnaît un peu partout dans les recueils et autour de nous. Elle n’est pas sans évoquer la répétition soporifique du Samsara, ou carrément l’Enfer, qui veut simplement dire « en dessous » :
l’enfer
en quelques motsy
vendent
des
bagues
de
mariage
chez Costco45
Comment nier, d’un poème à l’autre, le constat d’une forme de désacralisation ? La poésie doit aller là aussi, c’est clair. Dans la conformité ambiante, elle ne peut faire autrement que pratiquer ces « trous de voyeurs pour regarder l’enfer » dont parlait Josée Yvon – qui ne pensait sûrement pas devenir la « grand-mère poétique46 » d’une trâlée aussi vaillante –, ces trous qui permettent à « la défection du minuscule quotidien47 », au « beau désespoir étalé presque correct », à la « commotion monstrueuse des franges de l’intimité » d’être vues, peut-être même aimées. Quand ces écrivaines-là parlent de ce qu’on trouve dans leur vagin, de la grâce des garces, de « l’art de boire sans soif », d’une « quenouille qui s’agite habituée d’écrire à la noirceur », de « l’eau bénite moisie », j’ai l’impression d’entendre un jardinier présenter amoureusement ses fleurs toxiques. Dans La dévoration des fées de Catherine Lalonde, après avoir quitté sa famille pour vivre la grande vie à Montréal, la « petite » retrouve Ginette et les autres ( les filles-missiles d’Yvon, devenues ici des « princesses métal » accotées avec des Black, des crackés, tout un « bataillon mirifique de caboches de kids et de chaos ») dans un éloge absolument lyrique de la parenté profonde qui relie tous les inadaptés du système d’exploitation : « car nous sommes tous splendeur dans le silence soudain, dans le taire de cette chorale à mille bouches nous sommes splendeur […], dans le silence avalant nous sommes une asonie rare.48 »
Rendu au tréfond du manque et de la défonce, il est quand même étonnant de rencontrer cette ouverture sans condition. On croit redécouvrir que l’amour peut vraiment tout inclure. Est-on si loin de la grande étendue qu’on l’imagine ? N’oublions pas qu’au fond de l’Enfer de Dante, pour remonter en surface, inutile de remontrer les cercles un après l’autre : c’était sans doute plus commode du point de vue narratif, mais entre les jambes de Satan, une petite porte est découpée, qui mène directement sous les étoiles. Patrice Desbiens en parle dans un poème d’En temps et lieux :
On l’a trouvée
étendue
sur la frontière
entre le Ciel
et l’Enfer.On n’a jamais su
si elle essayait
d’entrer
ou de
sortir.49
Patrice Desbiens, Casse tête, extrait de Sudbury.
Cette ombre à la fin inexpliquée, elle me fait penser aux ombres de Josée Yvon, de Denis Vanier. Ce qu’il y a de beau dans leurs poèmes, c’est précisément cette frontière à laquelle on est sans cesse ramené, le point d’indistinction du haut et du bas, l’envie soudaine « d’embrasser les bouches haineuses de la quiétude », de s’enfermer « dans la grande poubelle qui mène au ciel50 ». On est constamment devant une ambivalence oxymorique, on se demande s’il faut échapper au Ciel ou à l’Enfer, on arrive à « la plus pure horreur zen51 », à « l’illumination par déchéance52 ». L’abjection apparaît comme une aumône, la commotion réveille.
Dans une entrevue avec Dominic Tardif, Jean-Sébastien Larouche, l’éditeur de l’Écrou (depuis quelques années délégué aux cercles du sous-sol), a parlé aussi du fond lumineux du baril : « Il y a quand même une lumière quand t’es au fond, tu la vois tout le temps, c’est juste que t’as aucune idée comment faire pour réussir à grimper pis à sortir.53 » C’est presque trop beau, n’est-ce pas, c’est comme ouvrir son cœur ou lâcher prise, mais avec les années, les oiseaux de malheur ont le don de nous humilier, on devient soudain moins arrogant avec les pensées du jour, on découvre que les moins que rien (que nous sommes) sont aussi des êtres de légende. Ce ne sont pas seulement des clichés, ce sont des implants mythiques, et la beauté de celui-ci est de reposer sur une proposition apparemment illogique, inversionniste. Elle nous dit que la lumière vient d’en dessous : « Elle est là, hypercachée en dessous d’un paquet d’affaires.54 » C’est donc l’Enfer qui est continuellement au-dessus, dans l’anxiété qui nous agite, désynchronisés du flow qui correspond au premier étage de l’existence.
J’imagine que tous les êtres humains ressentent un jour ou l’autre l’appel du plancher, l’abandon total aux forces du sol. Les premières pages, on les noircit au sol, couchés n’importe où. L’avantage de la désillusion, de ne plus savoir où aller, c’est qu’elle nous force à toucher terre. Ce n’est pas très divertissant, on se divertit pour ne pas se retrouver là, mais l’écriture vers le bas semble nous inviter à fixer le mur. Elle n’entrevoit pas d’allègement autrement qu’au milieu du séisme et de la platitude, elle nous libère dans le noir et non du noir. C’est à « Sainte-Amère-de-Laurentie, au cœur même de la hargne familiale et de ce qui l’a faite » que la petite effrontée retrouve une félicité ancienne : « Elle retombe en cet état où l’air et tous les tissus étaient mains caressantes et où tout autour était aimant ; l’autour de soie, simplement d’être, d’être en vie.55 » Elle « retombe », oui. Elle touche au fond du moi, au fond du réel. Le réalisme a débouché sur un idéal immanent, la réactivation d’une confluence.
Même dans l’urgence, dans la plus complète absurdité, même si tout est mis en œuvre pour nous déconnecter du Grand Tout, l’erreur serait de penser que l’insignifiance doit être comblée par du sens. Non, lisez Desbiens, vous verrez qu’elle a sa propre façon de rayonner :
Parfois on regarde
personneon regarde dans
le videle vide nous
regardeet
soudainement
un camion de
Hector Larivée
traverse notre
regard.56
C’est bien cela, le flow, n’est-ce pas, c’est comme une entrée dans l’atmosphère… Pas vraiment d’abjection ici (à moins de considérer le camion du spécialiste des fruits et légumes comme une abjection), la bassesse est ailleurs, on a l’impression que les portes de l’ascenseur viennent de s’ouvrir au degré zéro de la réalité. Nous voilà dans une épiphanie courante, on aurait envie de dire un bref moment de plénitude, mais non, c’est l’inverse, c’est la sensation intime que tout survient en pleine éternité.
Jacques Brault, Patience.
Mais que vient faire le camion d’Hector Larivée là-dedans ? Scrapper le poème ? Je n’ai pourtant pas l’impression d’une brisure irrévocable. Rien là de tragique, c’est même un peu drôle, c’est même l’élément qui vient nous éveiller au monde comme il va. L’altérité refait surface dans mon regard, la vue d’ensemble est focalisée soudainement sur un détail à contre-courant, l’asonie, un papier collant qui n’aurait pas dû être là, une couronne de plastique, mais l’espace du monde est toujours celui du regard, toujours un espace intérieur qui me regarde.
À ce niveau-là, c’est la « présence sûre57 » dont parle Pierre Nepveu, le point mort étrangement vivant, le dénominateur commun, le plancher universel. Je ne pense pas qu’on puisse descendre plus bas.
On pourrait l’oublier : Miron opposait au non-poème le poème comme « unité refaite du dedans et du dehors58 ». Il ne formulait pas autrement la fin de l’irréalité traditionnelle, le retour en soi du sentiment d’être « flush avec la réalité ». À le relire, cependant, j’ai l’impression de pousser avec lui la pierre qui me rendra libre, j’ai envie de lutter aussi contre l’isolement de tout un chacun, mais j’hésite à mettre des conditions aussi lourdes (l’indépendance du Québec, la fin du capitalisme, etc.) à la liberté conquise. Je vois là une contradiction, je refuse de refuser à la liberté son autonomie première. Si la liberté existe, elle ne peut que résister à tous les conditionnements, le nombre et la profondeur des blessures n’y changent rien. Ce qu’elle nous découvre est latent, inconscient, mais toujours déjà-là, comme tous les coups de fusils, toutes les télévisions allumées en même temps laissent quand même, à la fin, le silence intact. Elle invite à ne pas chercher de réalisation plus haut que le niveau des pieds, dans cela même dont on voudrait se libérer. « Je préfère que la liberté nous vienne d’en bas59 », écrivait Brault, et Miron encore, dans une lettre à Claude Haeffely : « Je crois que nous commençons à être une réalité et une présence. Et ça vient des pieds.60 » Une fois que le flow commence à monter des pieds à la tête, j’imagine qu’il est difficile de faire la différence entre les deux : la présence du réel est ma présence. Je suis là où je suis. Flush.
Ce n’est pas rien que « simplement d’être, d’être en vie », c’est fade au début, peut-être même insoutenable. Pascal aussi est passé par là : « Mais, ôtez leur divertissement, vous les verrez se sécher d’ennui ; ils sentent alors leur néant sans le connaître ; car c’est bien être malheureux que d’être dans une tristesse insupportable aussitôt qu’on est réduit à se considérer et à n’être point diverti.61 » Quand je relaxe un peu avec mes collégiens avant les cours, je les oblige à se sentir exister, à regarder dehors sans vouloir quoi que ce soit, je leur donne, comme instruction au tableau, deux vers de Louis-Jean Thibault :
Le seul feu à maintenir
Est celui de ton attention62
et beaucoup trouvent ça lourd. Je leur dis : oui, c’est drôle, nous avons du mal à supporter longtemps le fait d’être là, nous ressentons d’abord de l’insipidité, nous sentons notre néant sans le connaître, nous touchons probablement à cette blessure première qui nous donne envie de mourir, dans le poème de Trahan. Je ne parle pas du désarroi d’être au monde, mais de sembler coupé de lui, dès qu’on descend à son niveau, englué dans les états mentaux. Mais regardons la blessures, disent les poèmes, regardons la distance. Restons encore au premier étage, dans la bassesse originelle de la présence (j’imagine que nous avons tous un peu la même). Ce n’est pas comme si nous avions le choix. C’est forcément là que tout se fait, que tout arrive en même temps, la source des fleurs et des camions de légumes. Je ne sais pas dans quelle autre direction nous pourrions regarder si nous voulons voir dans quelle merveille nous sommes tombés.
∗∗∗∗∗∗
Illustration : Le Devoir — Y a‑t-il un reboom de la poésie québécoise.
∗∗∗∗∗∗
Notes
[1] Pierre Morency, Grand fanal, Montréal, Boréal, 2018, p. 59.
[2] Michaël Trahan, La raison des fleurs, Montréal, Le Quartanier, 2017, p. 194.
[3] Ibid., p. 149.
[4] Anne Hébert, « Quand il est question de nommer la vie tout court, nous ne pouvons que balbutier », Le Devoir, 22 octobre 1960, p. 9.
[5] Pierre Vadeboncœur, « L’irréalisme de notre culture » [1951], dans Une tradition d’emportement. Écrits (1945–1965), choix des textes et présentations d’Yvan Lamonde et Jonathan Livernois, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. «Cultures québécoises», 2007, p. 41.
[6] Camille Roy, Essais sur la littérature canadienne, Québec, Librairie Garneau, 1907, p. 368.
[7] Mathieu Simoneau, Il fait un temps de bête bridée, Montréal, Le Noroît, 2016, p. 45.
[8] Hugo Beauchemin-Lachapelle, Stainless, Montréal, l’Hexagone, 2017, p. 70.
[9] Rose Eliceiry, Là où fuit le monde en lumière, Montréal, l’Écrou, 201
[10] Fernand Ouellette, Journal dénoué, Montréal, Typo, 1988, p. 34.
[11] Albert Lozeau, « Les Poésies d’Alfred Garneau », La Revue canadienne, vol. 53, no 1, 1er fév. 1907, p. 174.
[12] Mathieu K. Blais, Tabloïd, Montréal, Le Quartanier, 2015, p. 54.
[13] Charles Quimper, Tout explose, Montréal, Le Lézard amoureux, 2018, p. 75.
[14] Jean-Christophe Réhel, La douleur du verre d’eau, Montréal, l’Écrou, 2018, p. 11.
[15] Maude Veilleux, Last call les murènes, Montréal, l’Écrou, 2016, p. 68.
[16] Ibid., p. 54.
[17] Jean-Christophe Réhel, op. cit., p. 73.
[18] Mathieu Simoneau, op. cit., p. 39.
[19] Ibid., p. 49.
[20] Ibid., p. 43.
[21] Gaston Miron, L’homme rapaillé, préface de Pierre Nepveu, Montréal, Typo, 1996, p. 126.
[22] Ibid., p. 136.
[23] Jean-Christophe Réhel, op. cit., p. 102.
[24] Jean-Christophe Réhel, op. cit., p. 57.
[25] Frédéric Dumont, Je suis célèbre dans le noir, Montréal, l’Écrou, 2018, p. 58.
[26] Mathieu K. Blais, op. cit., p. 34. Chez Réhel, je note la même image : « je range mon âme / dans le premier tiroir ».
[27] Hugo Beauchemin-Lachapelle, op. cit., p. 33.
[28] Geneviève Boutin, Figures restantes, Montréal, Le Noroît, 2018, p. 14.
[29] Pierre Nepveu, La dureté des matières et de l’eau, Montréal, Le Noroît, 2015, p. 31.
[30] Maude Veilleux, Une sorte de lumière spéciale, Montréal, l’Écrou, 2019, p. 21.
[31] Ibid., p. 46.
[32] Mathieu Arsenault, Le guide des bars et pubs de Saguenay, Montréal, Le Quartanier, 2018, p. 26.
[33] Roland Giguère, Forêt vierge folle, Montréal, l’Hexagone, 1978, p. 80.
[34] Jean-Christophe Réhel, op. cit., p. 74.
[35] Dans Encore une fois pour Thucydide, je crois.
[36] François Rioux, L’Empire familier, Montréal, Le Quartanier, 2017, p. 58.
[37] Charles Dionne, La main invisible, Montréal, Le Quartanier, 2016, p. 26.
[38] Ibid., p. 33.
[39] Ibid., p. 88.
[40] Maude Veilleux, op. cit, p. 80.
[41] Ibid., p. 31.
[42] Maude Veilleux, Last call les murènes, p. 51.
[43] Judy Quinn, Pas de tombeau pour les lieux, Montréal, Le Noroît, 2017, p. 19. La rue Hector-Fabre du poème, ce n’est pas celle de Montréal, mais d’un secteur de Lévis, l’Auberivière (à côté de la Golden Eagle…).
[44] Antoine Boisclair, Solastalgie, Montréal, Le Noroît, 2019, p. 47.
[45] Charlotte Aubin, Paquet de trouble, Montréal, Del Busso, 2018, p. 36.
[46] Catherine Lalonde, « Mission impossible », Liberté, no 303, printemps 2014, p. 79. Josée Yvon fait des apparitions dans les derniers livres de Chloé Savoie-Bernard, Frédéric Dumont, Catherine Lalonde, Maggie Roussel, Émilie Turmel, Daria Colonna…
[47] Les citations qui suivent sont tirées d’un rassemblement de recueils de Josée Yvon, Pages intimes de ma peau, Trois-Rivières, Écrits des Forges, 2017.
[48] Catherine Lalonde, La dévoration des fées, Montréal, Le Quartanier, 2017, p. 100.
[49] Patrice Desbiens, En temps et lieux. Les cahiers complets, Montréal, l’Oie de Cravan, 2017, p. 34.
[50] Ces passages sont tirés d’un film sur Denis Vanier, Le fond du désir, extraits et autres textes, Espace Global Galerie, 1994.
[51] Denis Vanier, La castration d’Elvis, Montréal, Les Herbes rouges, 1997, p. 23.
[52] Merci à Mélissa Charron de m’avoir signalé le bel oxymore. Bien hâte de lire son portrait de Vanier en mystique de fond de ruelle…
[53] Dominic Tardif, « Des longueurs dans le Styx. La noyade chaque jour évitée », Le Devoir, 24 nov. 2018, consulté en ligne.
[54] Ibid.
[55] Catherine Lalonde, op. cit., p. 112.
[56] Patrice Desbiens, op. cit., p. 116.
[57] Ibid., p. 45.
[58] Gaston Miron, op. cit., p. 127.
[59] Jacques Brault, « Un pays à mettre au monde », Parti pris, vol. 2, nos 10–11, 1965, p. 22.
[60] Gaston Miron, Lettres, 1949–1965, Montréal, l’Hexagone, 2016, p. 165.
[61] Pascal, cité par Guillaume Corbeil, Le meilleur des mondes, d’après Aldous Huxley, Montréal, Le Quartanier, 2019, p. 7.
[62] Louis-Jean Thibault, Le cœur prend lentement mesure du soleil, Montréal, Le Noroît, 2017, p. 40.
∗∗∗∗∗∗
Recours au poème a publié des poètes québécois pendant une année, dans sa chronique Poésie du Québec. Les poèmes confiés par nos amis québécois ont été regroupés dans l’anthologie publiée par notre revue et les éditions PVST. Pour accéder au bon de commande ⇒ Chant de plein ciel – Voix du Québec