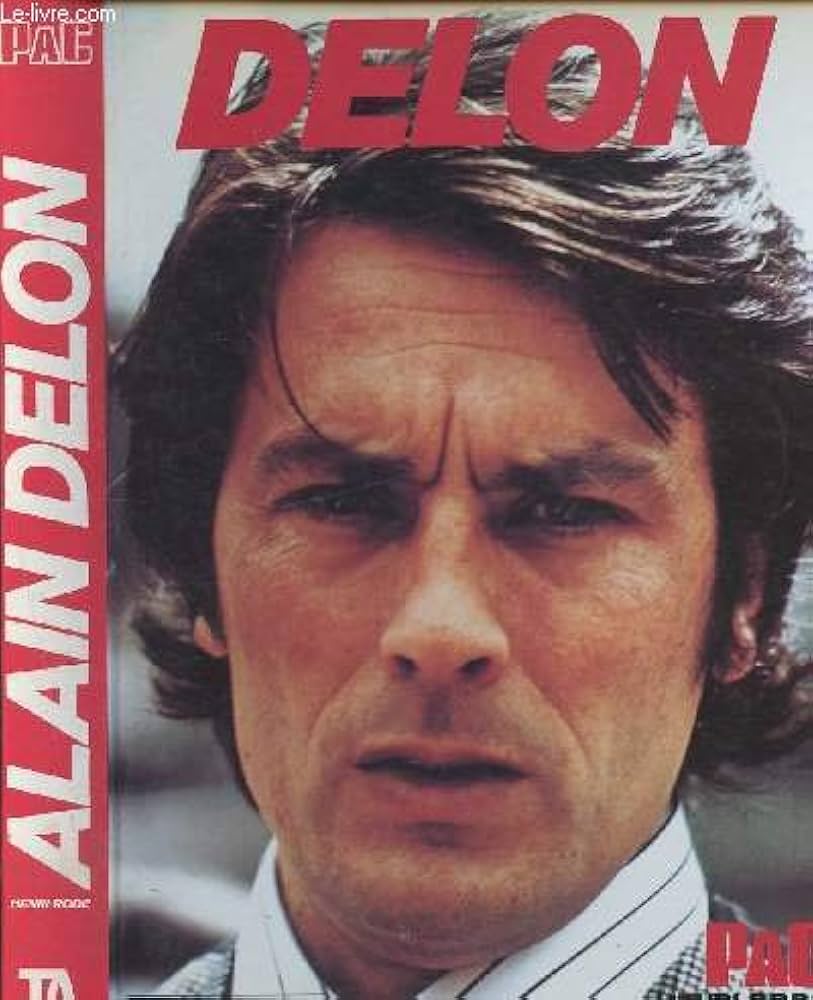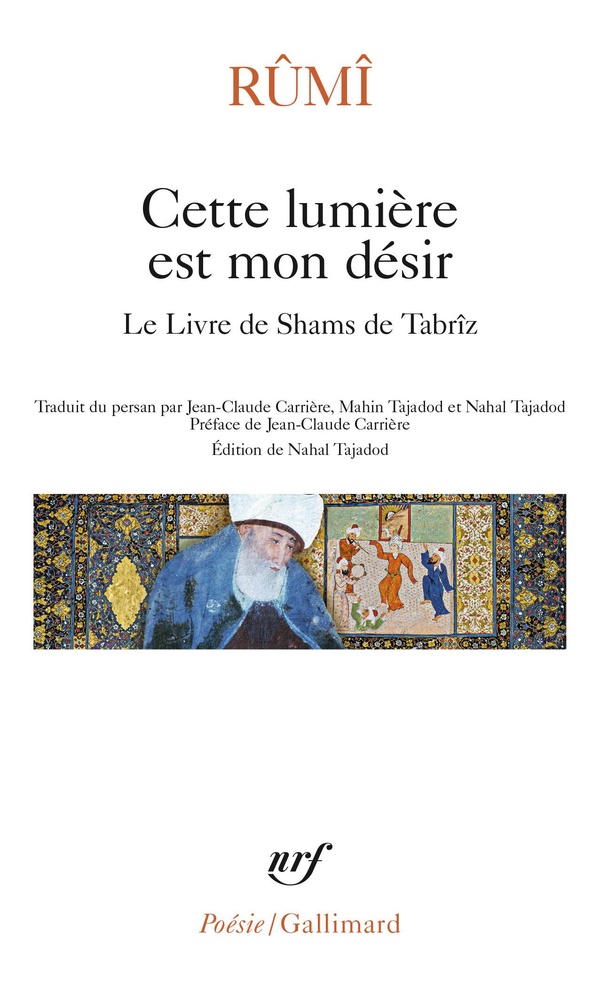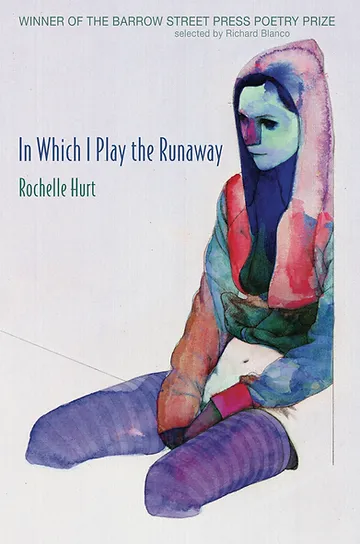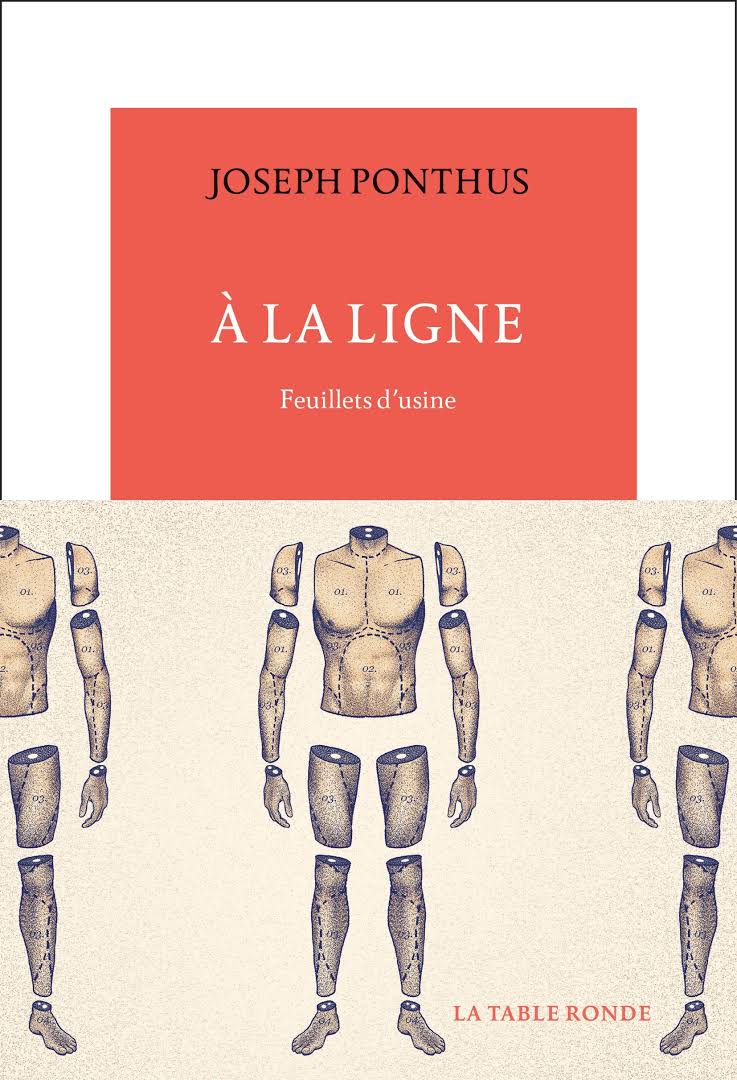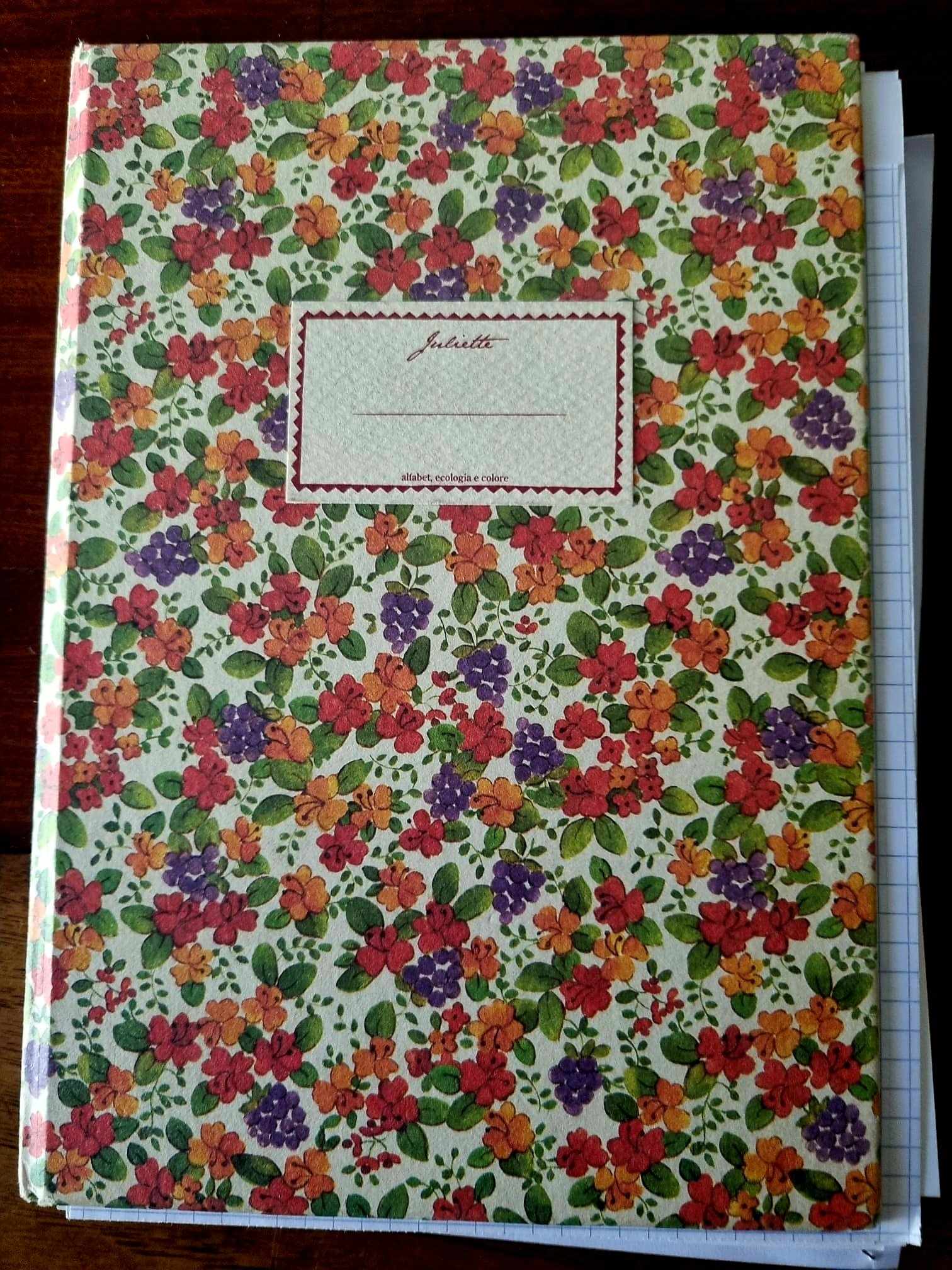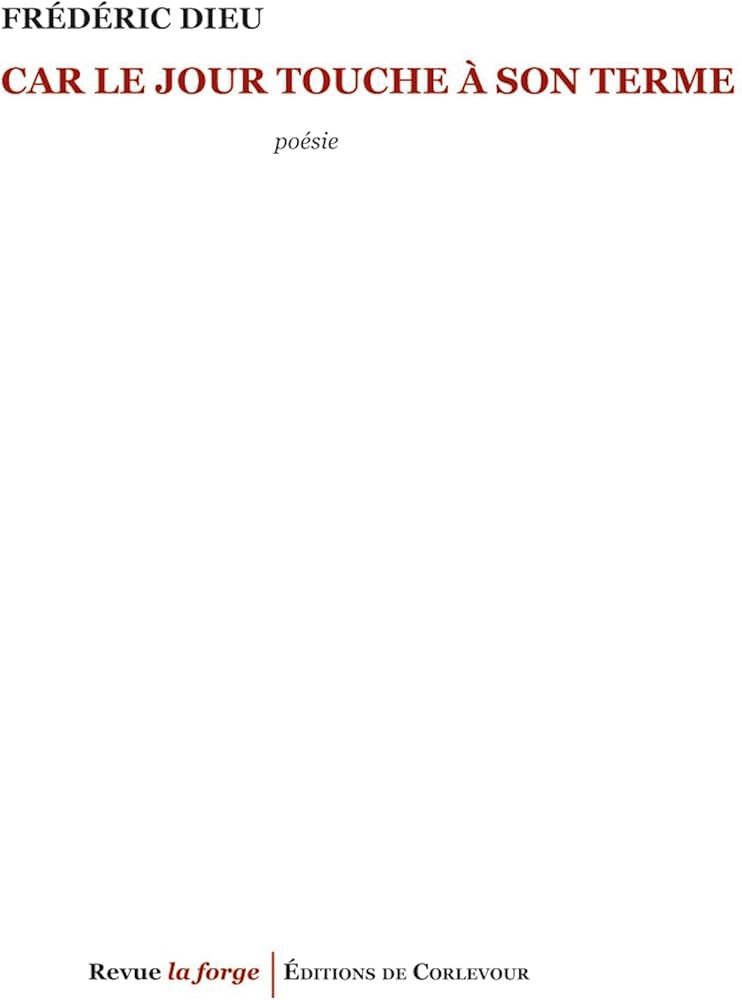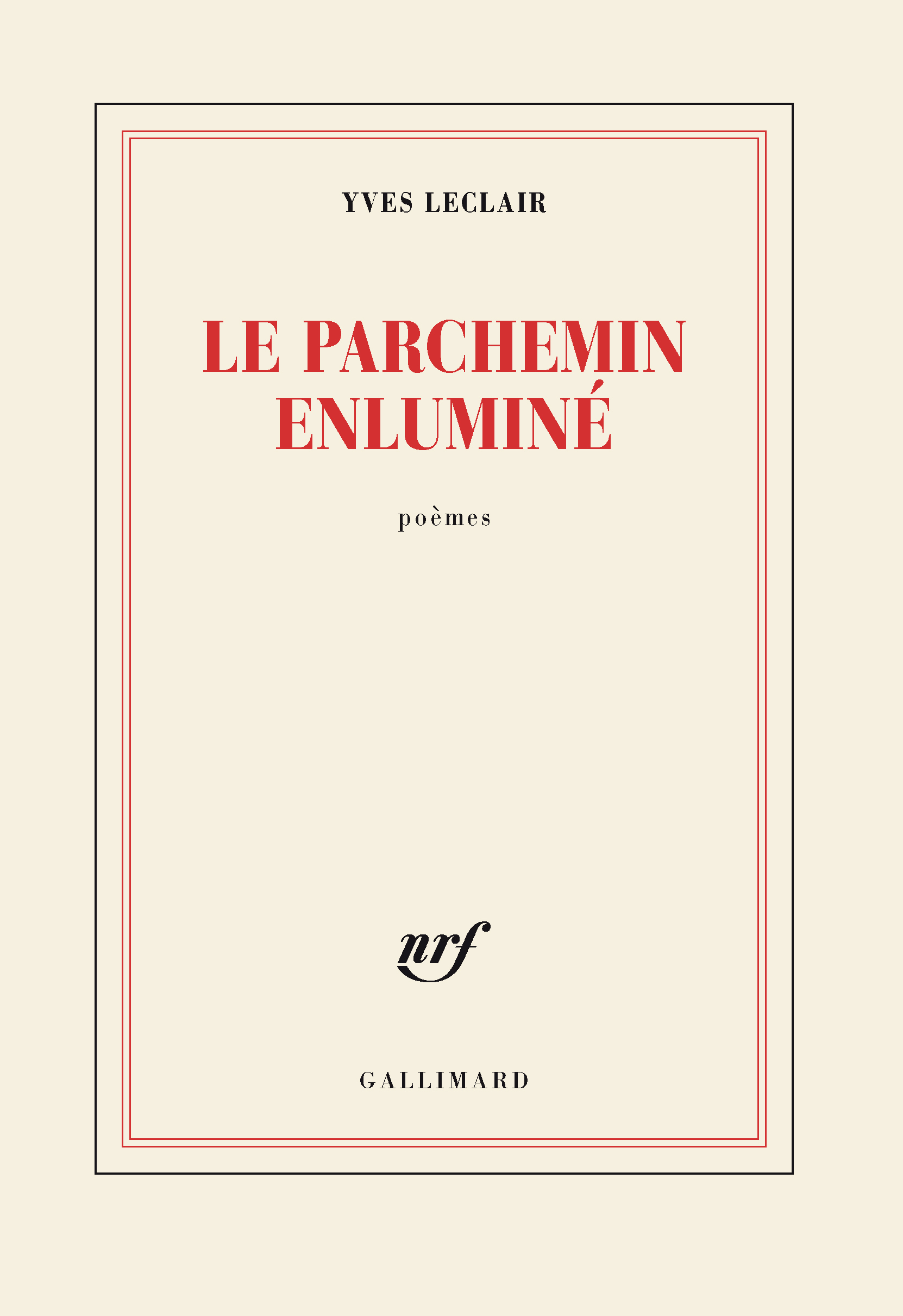Dans mon demi-sommeil, les phrases glissent. Des panneaux métalliques gris acier dur coulissent. Les gonds grincent. S’immobilisent dans le silence. Un mur lisse noir uni ferme le ciel. L’espace sombre dans le corridor étroit d’une rue sans âme. Les phrases trébuchent. Elles se refusent à l’emprise des mots. Les images s’effacent. Chassées par l’émergence du jour. L’usine est retombée dans sa rumeur ordinaire. Machines-outils bruits de tôles et de chaînes, va-et-vient sonore de roulements à billes, marteaux piqueurs et tenailles rythment des rituels inconnus. Le mur oppose son obstination monochrome, son gris aveugle indifférent à la lumière. Murs-pignons percés de baies aveugles, métal plein cintre et noir absolu. Mur très XIXe de l’usine Peugeot-Citroën de Saint-Ouen.
Peut-être mon attirance pour les usines désaffectées me vient-elle de mon enfance où hangars, docks, entrepôts de Marseille, tous patinés d’un halo de mystère, exerçaient sur moi une véritable fascination. Ranimée aujourd’hui par l’engouement des architectes pour les friches industrielles, dont certaines d’entre elles sont reconverties en salles de concert ou en espaces muséaux.
Ainsi en est-il, à Rome, de la Centrale Montemartini ? Qui pourrait imaginer qu’une ancienne centrale thermoélectrique puisse abriter, en même temps que d’énormes machines mises en service au début du XXe siècle, autant de trésors de l’Antiquité ? Restaurée, entièrement rénovée, reconvertie en musée permanent, la Centrale Montemartini — du nom de son propriétaire et inventeur —, inaugurée en 1912, est devenue, depuis l’exposition de 1997, une annexe des musées Capitolins. Chaudières, turbines à vapeurs de 3000 kW — datant de 1917, turboalternateurs, condensateurs, tous engins rutilants, alternent avec des chefs d’œuvre de la sculpture antique.
Je déambule souvent, subjuguée, dans ce monde étrange où l’archéologie gréco-romaine défie les alternateurs, où les bustes de dieux, leurs corps vigoureux et athlétiques, les drapés nobles des femmes, leurs visages éternisés dans le marbre, s’immiscent dans des espaces où règnent en maîtres les tubes d’acier et les pistons, les bielles les manivelles et les corps de chauffe, les moteurs diesel et le labyrinthe des tubulures.
Des machines et des dieux. Qui triomphe sur l’autre ? Happé par le gigantisme et la complexité de cette métropolis, le regard hésite. Il cherche son chemin le long des coursives, emprunte les échelles métalliques, s’arrime aux rampes qui grimpent, se faufile entre pilastres et colonnes. Les engins occupent l’espace, imposantes structures qui semblent intimer le silence aux dieux figés sur leurs socles. Les dieux sont là, pourtant. Souverains. Innombrables. Et pensifs. Athéna et Dionysos. Asclépios et Artémis. Apollon, la tête ceinte d’une couronne de laurier. Pothos, frère d’Eros et comme lui, fils d’Aphrodite. Émouvant Pothos, absorbé dans sa contemplation des chaudières ou peut-être abîmé dans la nostalgie d’un amour lointain, à jamais inaccessible. Étrange Pothos dans sa beauté androgyne. Vu de dos, son corps mince aux formes presque féminines, révèle, vu de face, une nudité d’éphèbe.
Avec les dieux, la cohorte des faunes, des ménades et des satyres, des nymphes et des amazones. Des muses et des héros. Tous plus beaux les uns que les autres. Persée, Diomède et Héraclès. Et Thésée. Parmi la foule des anonymes, stratèges et tribuns, lutteurs et esclaves, surgissent les portraits connus. Cléopâtre, représentée sous les traits de la déesse Isis, voisine avec Antinoüs, représenté en Apollon ; Icare est là, lui aussi. Un enfant encore. Visage tendre et triste incliné sur la poitrine ceinturée de lanières de cuir. Et dans le dos, des ailes, brisées. Caton et Auguste. Septime Sévère. Caracalla, au regard dur. Et Lucilla, la fille de Marc-Aurèle et de Faustina. Absorbés en eux-mêmes, le regard empreint d’une gravité intérieure, tous veillent sur un univers d’au-delà des machines, elles-mêmes figées, carcasses mortes, abolies d’inanité muette.
Dans la Salle des Machines, devant une armée de compteurs, se dresse, majestueuse et décapitée, une statue vêtue d’un péplum. Il ne lui manque pas seulement la tête, mais aussi les bras. N’empêche, elle avance un pied décidé hors de l’espace qui lui a été assigné. Je cherche parmi les têtes qui trônent sur leur socle celle qui pourrait lui convenir. Aucune ? Peut-être alors, choisir parmi les visiteurs silencieux, le visage de cette jeune fille. Belle, mais d’un autre siècle. Assise sur les marches de l’esplanade, la tête penchée sur sa planche à dessin, sa longue chevelure répandue sur les épaules, elle croque des esquisses de silhouettes, de ports de tête, de corps nus et élancés. Je m’approche d’elle. Elle est absorbée dans son travail de jeune élève des Beaux-Arts de la Ville de Rome. Elle ne soupçonne rien de ma présence. De l’endroit où elle se trouve, elle embrasse le vaste ensemble de la Salle des Machines. De là, elle peut voir la victoire ailée de l’Atena Lemnia, décapitée elle aussi, mais dont la complexité et le volume des plis de la toge semblent la préparer à un envol prochain, entraînant dans son sillage la mise en rotation de l’énorme roue métallique qu’elle devance. Plus loin montent la garde devant le tableau de bord du moteur diesel les statues d’Hestia et d’Igea. Mais ni l’une ni l’autre ne pourra dire dans quelles circonstances violentes sa tête lui a été arrachée, à jamais séparée du corps. Un corps pourtant si délié et si gracieux…
L’une des rares statues féminines à n’avoir pas été décapitée est la statue d’Agrippine Mineure. Représentée en orante, la statue monumentale d’Agrippine m’impressionne. Enroulée dans ses voiles — le corps majestueux ceint dans son drapé noir de basanite —, Agrippine règne, noble et austère, recueillie, sur l’ensemble de ses compagnes. Et s’harmonise à merveille, par le poli de son vêtement et sa couleur volcanique, à la brillance rutilante mais sombre des machines.
Dans la salle des chaudières, deux statues retiennent longuement mon attention. Celle de la muse Polymnie et celle d’une toute jeune fille. Délicate et songeuse, Polymnie est abîmée dans ses rêves. Élégamment enroulée dans ses voiles, le corps en appui contre une colonne, elle contemple, bouche légèrement entrouverte, un horizon lointain. Elle rêve. De poésie, peut-être. D’un monde autre, hors de la trivialité du monde. La jeune fille, elle, est assise, jambes croisées. Buste incliné vers l’avant, le pied droit posé sur une sorte de rehaut, elle semble se balancer. Le coude gauche est replié sur son genou, la main droite appuyée sur le rebord de son siège. Elle rêve, elle aussi, absorbée tout entière en elle-même. Souple et élégant est le drapé de son vêtement ; relevés en chignon, ses cheveux dégagent la noblesse de sa nuque. Le profil est fin. La tête inclinée souligne la méditation. Tout dans la composition du corps, dans le port de tête, dans la fragilité des traits et dans l’intensité du recueillement trahit l’instabilité des certitudes.
Lumière naturelle et lumière artificielle marient leurs reflets sur les machines et les sculptures. Derrière les immenses baies vitrées, haut perchées au-dessus des solives, se devinent les formes et bâtisses du monde extérieur. Derrière le tremblé des feuillages, les structures cylindriques du Gazomètre, les bâtiments d’usine désaffectés, les hauts lampadaires et les grues immobiles, témoignent d’un passé disparu. Les ouvriers en bleu de chauffe ont depuis longtemps quitté la place. La centrale s’est installée, vaisseau fantôme, dans le silence. Elle abrite désormais un passé défunt plus ancien encore où frises et bas-reliefs, trophées et sarcophages, bustes et statues, s’animent avec le lever du jour. Tandis que les mosaïques déploient à même le sol le mouvement coloré d’une scène de chasse. Éternelle est l’énergie qui unit le temps d’une lutte à mort les hommes et les bêtes. Éternel aussi le regard intérieur qui anime les âmes. Par-delà le temps.
Dehors, une petite fontaine moussue gargouille. Elle veille, humble et modeste, sur la paix éphémère du lieu.
Adresse : Via Ostiense, 106, 00154 Roma, Italie
+39 06 574 8042
- Éliane Catoni, dans l’ombre d’Yves Bonnefoy - 6 juillet 2023
- Apporte-moi tes chants, Ô mer… : notes sur l’oeuvre romanesque de Giuseppe Conte - 5 mars 2021
- Éliane Catoni, dans l’ombre d’Yves Bonnefoy - 6 mars 2020
- Angèle PAOLI : Le Chevalier à la barrette & La Vénus aux euphorbes - 23 octobre 2016
- Esther Tellermann : Une odeur humaine ou l’impossible autobiographie. - 22 décembre 2015
- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (4) - 23 avril 2014
- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (3) - 14 février 2014
- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (2) - 18 juillet 2013
- Les chemins de traverse d’Angèle Paoli (1) - 30 mai 2013