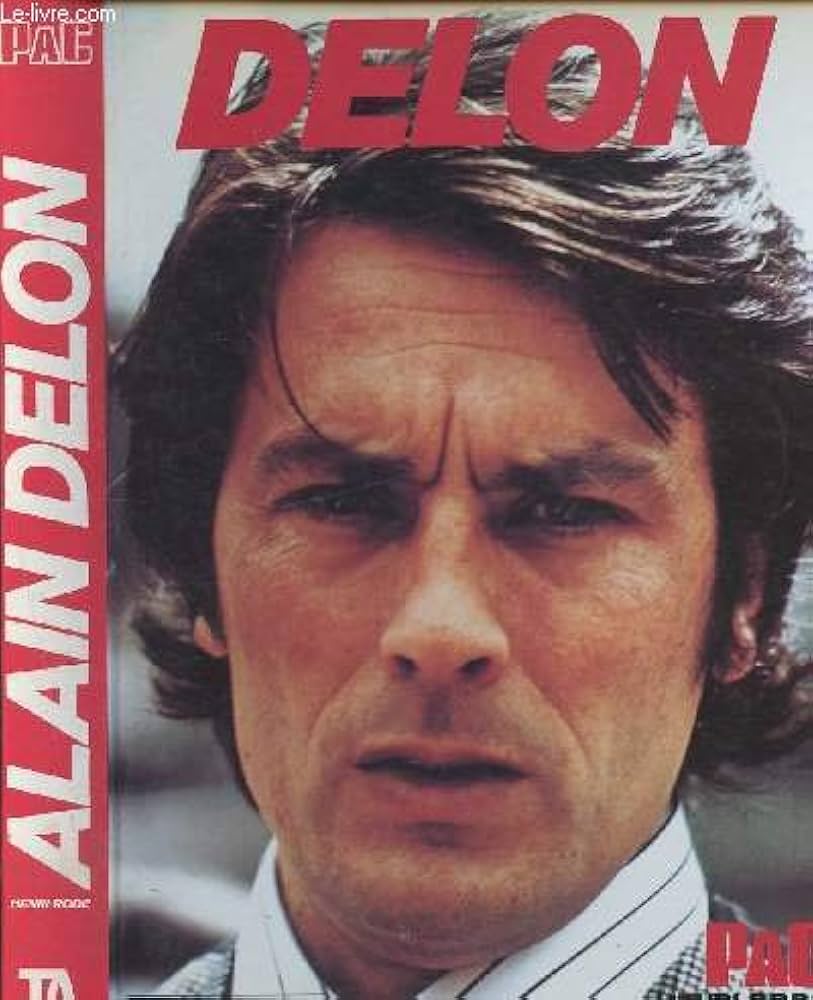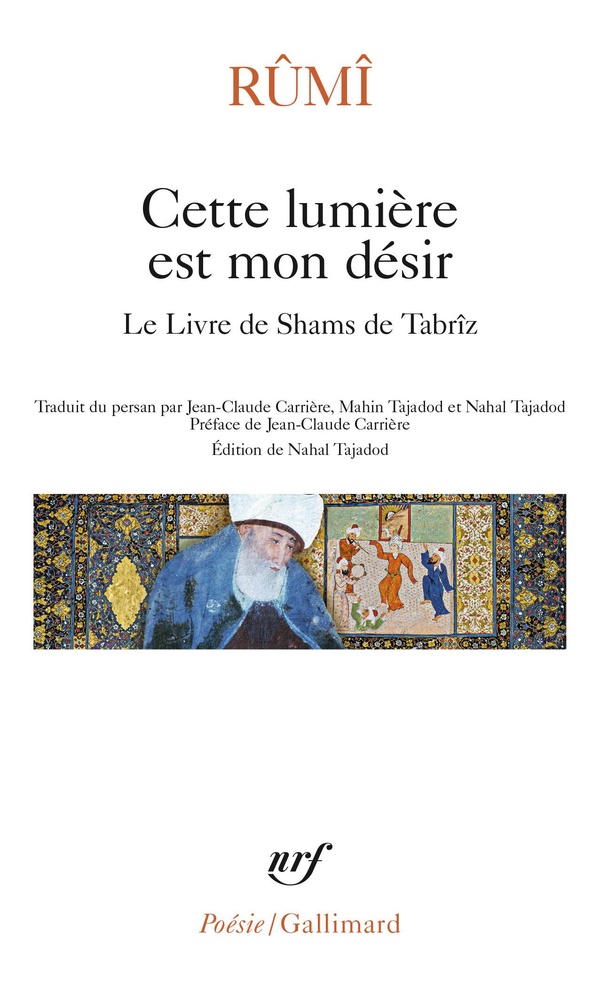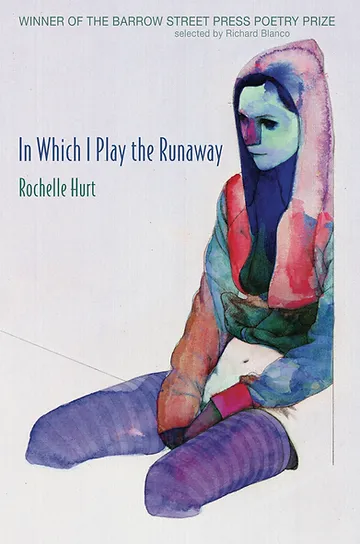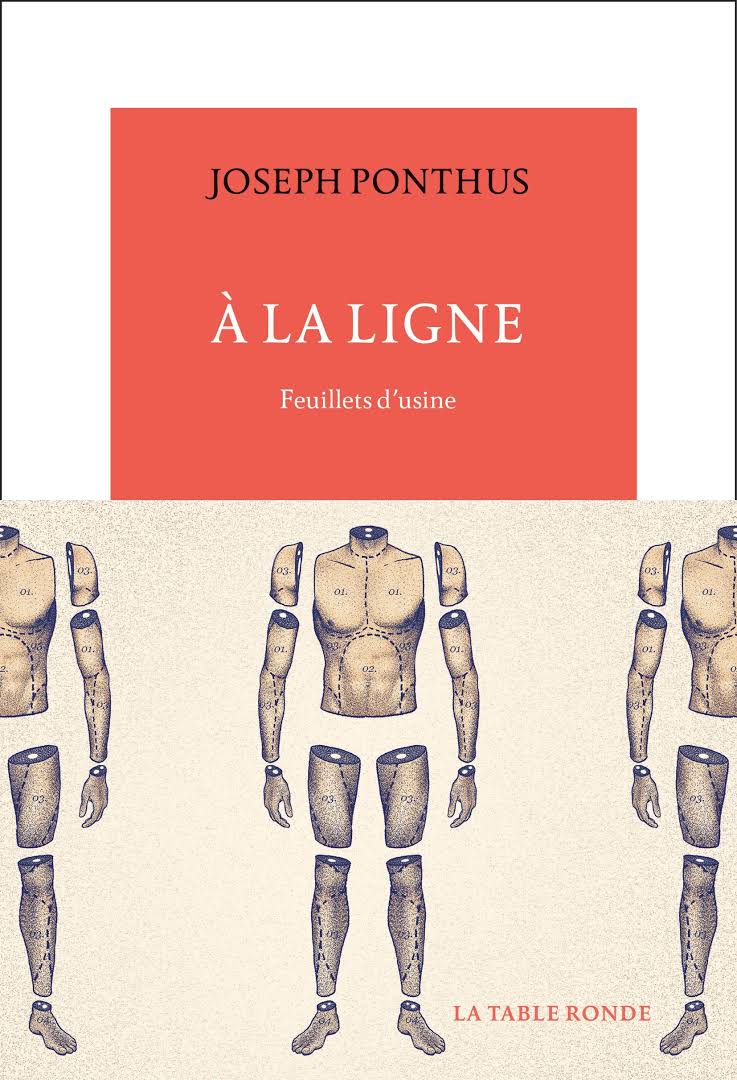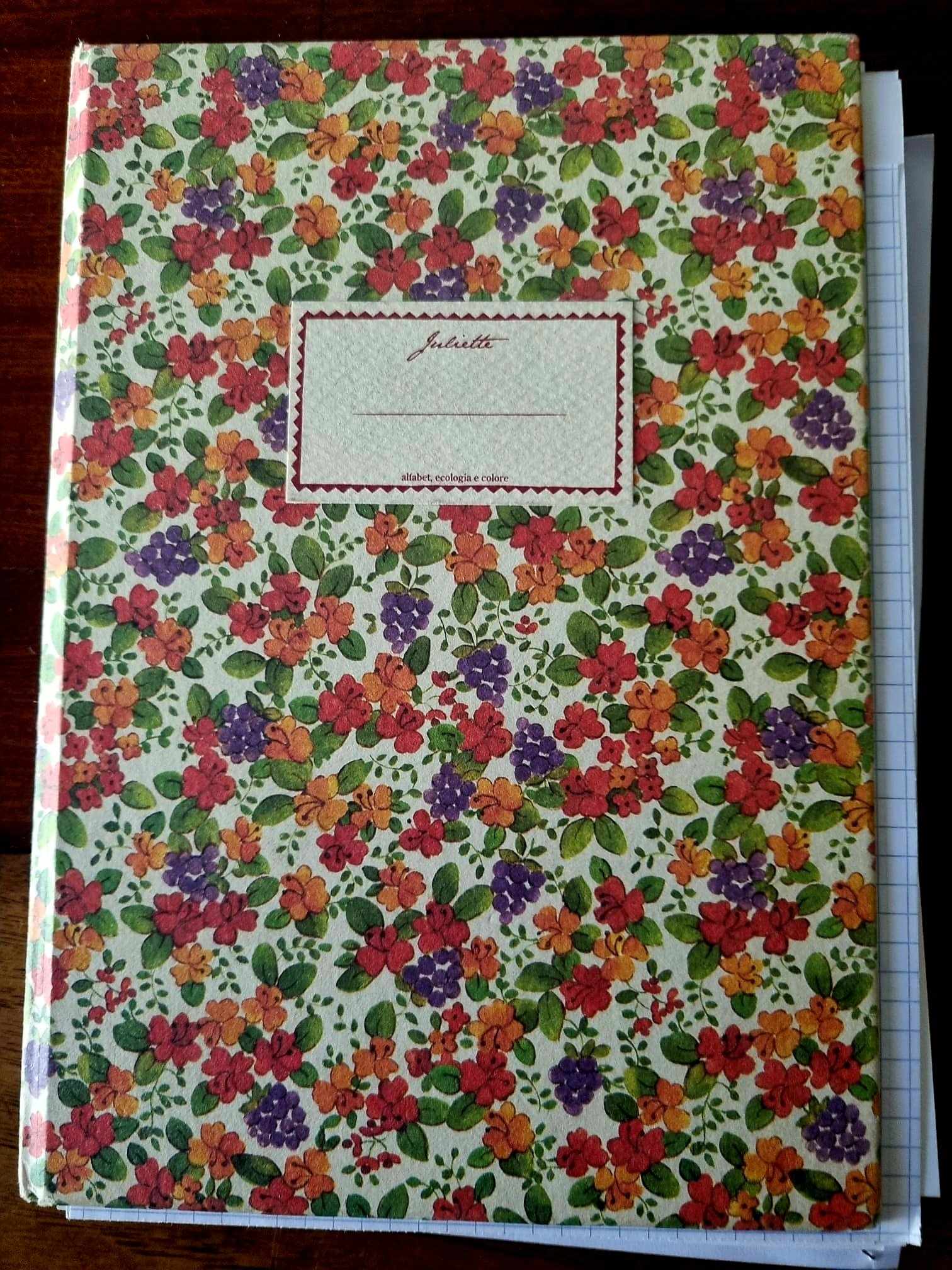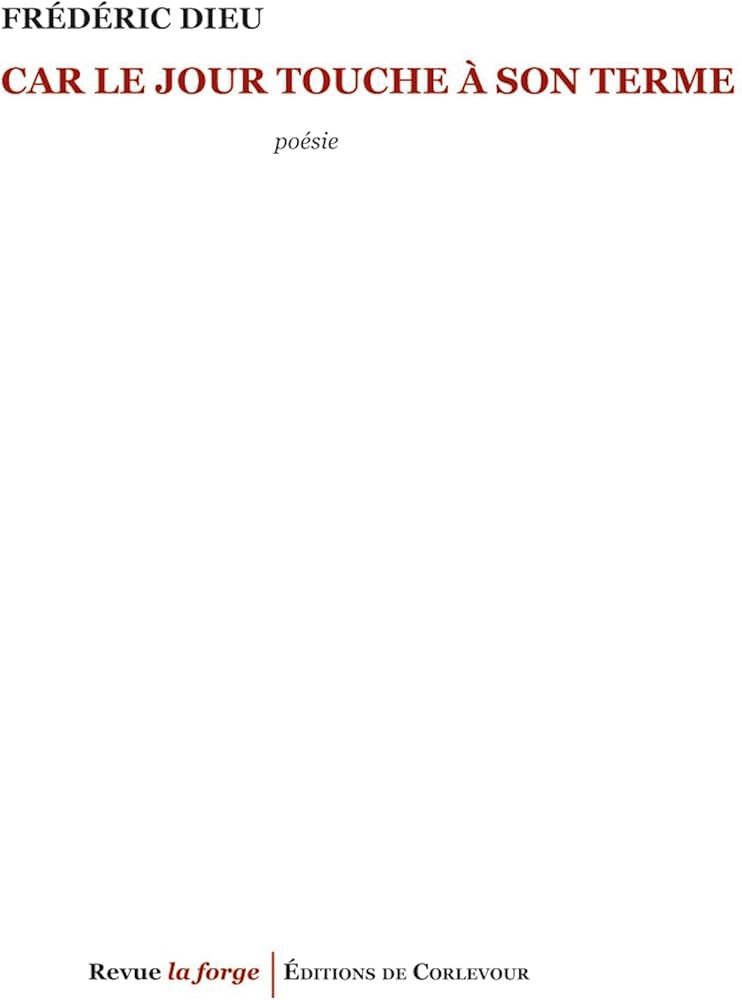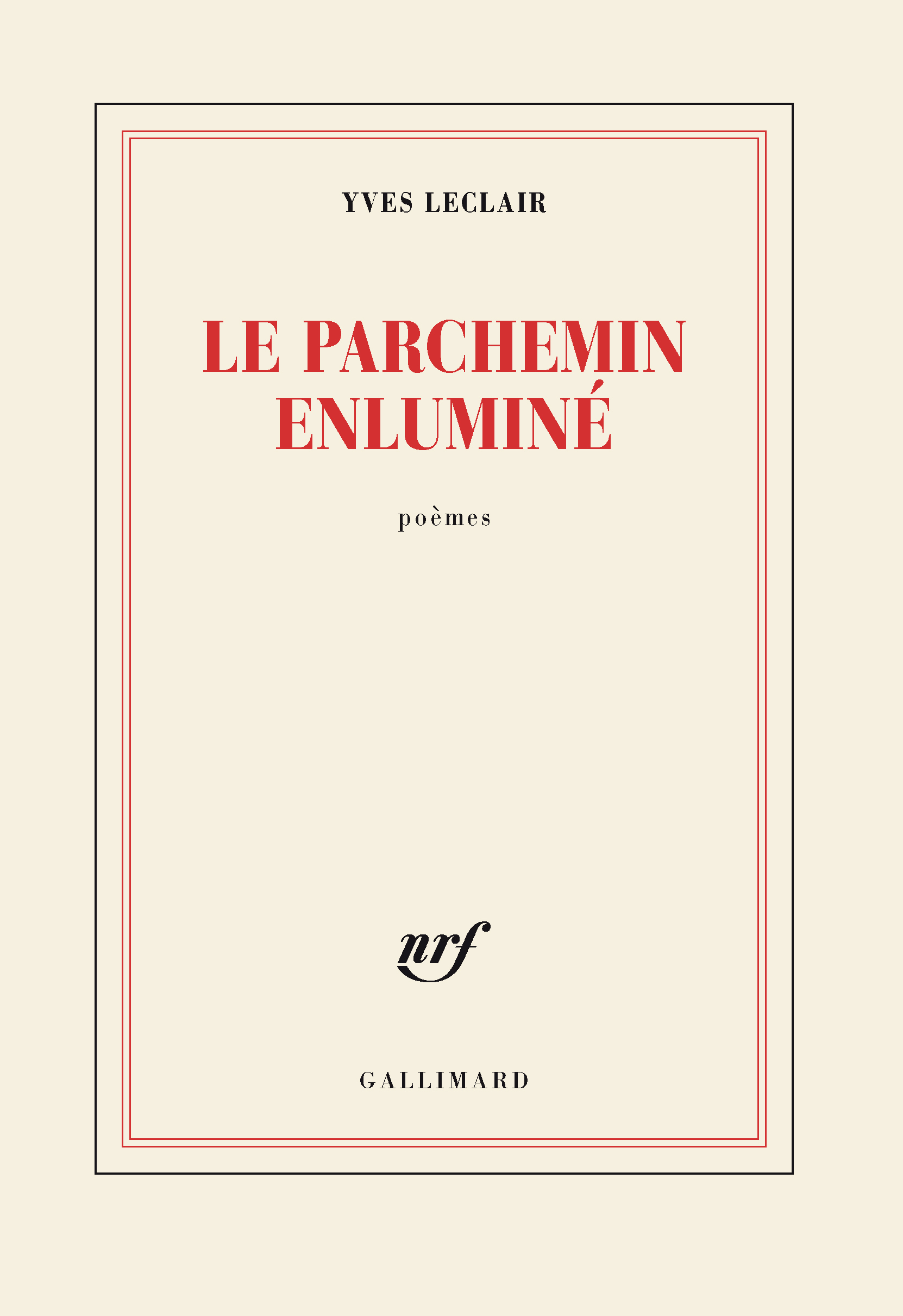Jim Jarmush, Permanent vacation.
Une fois le chant désenchanté, reste la chanson. C’est, de Jim Jarmush, Permanent vacation.
John Lurie au saxophone alto casse entre ses lèvres des brindilles de bois dur, de chaque morceau claque une étincelle. Son nom d’Ayler dans Manhattan bombardé – clin d’œil intellectuel, et pourquoi non ?
The dance scene, Permanent vacation de Jim Jarmusch.
Le jeune Aloysious Parker vaque d’ici à ici d’un quartier de New York dévasté par l’économie. Parce que ces ruines à gaspards ne sont plus un endroit où socialement quelque chose a lieu, elles ressemblent, du moins est-ce ainsi que je les vois, à une salle de cinéma, en ses fauteuils de parfois grand inconfort l’esprit se divertit, aucun mystère ne s’y célèbre, on ne sacrifie à aucun rite, rien n’appelle à la communion, la tête phosphorescente se détourne de l’immonde religiosité des sociétés humaines.
Christopher Parker dance on music of Earl Bostic, Permanent vacation, Jim Jarmusch.
Permanent vacation. Vacance est un nom de jeunesse, c’est un état de disponibilité si intense qu’il décourage l’invite. On la voudrait durer jusqu’à la nuit. Ce plus tard, dont on cherche la dispense, où vieillir sera ne plus cesser d’habiter la vie réelle.
Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood
Dans Once Upon a Time… in Hollywood Quentin Tarantino expose l’envers du décor de l’usine des Studios à la fin des années soixante. Il documente la réalité. On y voit ce que chacun plus ou moins sait, à savoir des rapports sociaux qui sont des rapports de force d’appartenir aux rapports de classe, le travail difficile des acteurs (et de tous les professionnels), l’humiliation dont ils sont l’objet surtout dès que le déclin s’annonce, humiliation favorisée par leur faiblesse morale et par leur médiocrité intellectuelle – tout cela exaspéré par le changement de pouvoir industriel déterminé par l’avancée de la télévision.
Scène de fin, première partie, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino.
Comme nous sommes dans la réalité, la forme filmique a moins de grâce, le rythme ne va pas sans une irrégularité cahoteuse, la lumière n’épargne la laideur ni les rides.
Seulement voilà, dans cet envers-là, l’assassinat de Sharon Tate n’existe pas…
Avec pour conséquence de changer l’envers du décor ou la supposée réalité en fiction et, par vases communicants, l’endroit du décor, là où l’œil sniffe les bords du cadre de l’image animée comme des lignes de coke, en réalité pure et dure – pour la raison que dans cette dimension, au cours de la nuit du 8 au 9 août 1969, au 10050 Cielo Drive de Los Angeles, trois membres de la famille Manson massacrèrent la femme enceinte de Roman Polanski et ses amis.
Brat Pitt meets Pussycat, Once Upon A Time in Hollywood, Quentin Tarantino.
Le passage de l’envers à l’endroit se fait lors de la tuerie finale dans la villa de l’acteur Rick Dalton : le mouvement retrouve sa fluidité, le montage son inventivité.
D’où la conclusion suivante : la barbarie est garante de la réalité des films.
Un souvenir vient à l’esprit : dans les années cinquante, des cinéphiles appelés mac-mahoniens, du nom de la salle ayant leur préférence, défenseurs des œuvres de Losey, Lang, Preminger et Walsh, l’un d’eux, Michel Mourlet, contribuant parfois à Défense de l’Occident, affirmait que par esprit de cohérence l’amour du cinéma américain conduit à l’amour du système qui le produit, parce qu’il est impensable sans lui.
Bande annonce de Once Upon A Time in Hollywood, de Quentin Tarantino.
Un souvenir en appelant un autre : dans le fragment réalisé par R.W. Fassbinder pour le film collectif L’Allemagne en automne, réalisé à la suite de la mort par suicide aidé en prison de Baader, Ensslin et Raspe, sa mère avec laquelle il se dispute, lui confie qu’elle serait pour un pouvoir autoritaire… qui serait bon, aimable et juste.
Ajouter, enfin, cette sublime nuance : la réalité des films, qui influe sur la réalité du spectateur, est, elle, inspirée de Rosa Luxembourg, Anarchie ou barbarie.
Quentin, tu nous en racontes de belles !
Interview de Quentin Tarantino, à propos de Once Upon A Time in Hollywood.
Adieu Philippine de Jacques Rozier
Les films de la Nouvelle Vague eurent le tropisme du Sud. C’est bien étrange.
Les cinéastes de ce mouvement informel, qui n’avaient eu de mots assez durs contre le nihilisme mis en œuvre dans les productions du cinéma de qualité-française, furent fascinés par le crâne humain que sur la terre projette le soleil en ce lieu géographique. Leurs récits n’ont de cesse de quitter les rues brouillonnes du Nord pour rejoindre ou plutôt fuir littéralement vers les rives de la Méditerranée. Chemin faisant, au contact de la luxuriance des couleurs, ils se romantisent — puis s’attristent, car le sud, c’est la mort. La sécheresse, la pauvreté, la brûlure. La lumière y a une odeur de soupe chaude sur le feu et le décor y éprouve la défaite de ses traits.

Jacques Rozier, qui préluda à la Nouvelle Vague, voyage aussi vers le Sud. Où il se sert de l’aspect modal des mélodies corses, de leur insistance sur un son, pour troubler l’inconscience de ses deux « Philippines » – lorsque l’on devine que le rouge monte à leur front, lorsque les demoiselles comprennent que ce qui appelle le jeune appelé du contingent, c’est la mort de l’autre côté de la mer, à ce moment-là, et le bateau s’en va, la flûte en roseau du Maghreb remplace le chalumeau taillé dans le figuier du maquis.
Roubaix, une lumière
Arnaud Desplechin filme le malheur comme un mystère religieux – dont la signification est immanente, c’est-à-dire existentielle et sociale, rien moins que mystérieuse.
Il décompose en tableaux de pitié silencieuse les visages – qui sont comme front à front avec nous, même de profil, ils regardent à travers nos peaux. Lenteur cérémonielle – lenteur de l’irrémédiable. Lumière d’un doré laineux – que les corps glacés ainsi saisis ignoreront jusqu’à la dernière seconde, ils ne sont pas de son duvet. Bienveillance maternelle des voix, entrecoupée des éclats paternels du loup – mais il n’est plus de chaperon rouge ni de fable, la beauté ne peut rien, l’enfance est une trahison : sa proximité avec la nature en fait un concentré de faiblesse, ce qui aide à comprendre la révolte de l’homme mûr empoisonnant les eaux, polluant l’air et le feu partout, où que se tournent les yeux.

Affiche du film Roubaix, une lumière.
La voiture de police les amène, le film s’achève. Les deux jeunes femmes, que Desplechin a livrées à un sentiment d’impuissance où prend figure la folie meurtrière, n’ont plus que quelques minutes à passer avec nous. Comme moi qui n’ai plus que quelques années à vivre. Aimeraient-elles les consacrer à les regarder passer ? Mais est-il possible de regarder passer le temps ?
Jacques Rozier, Adieu Philippine.
- Jacques Sicard : Opus — Jim Jarmush, , Permanent vacation, Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood, Jacques Rozier, Adieu Philippine, Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière - 6 novembre 2024
- Opus 8 — trois variations autour de Claire Denis, Vittorio de Sica et Marguerite Duras - 7 juillet 2024
- Opus 10 : Jim Jarmush, , Permanent vacation, Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood - 6 novembre 2020
- Opus 10 : Jacques Rozier, Adieu Philippine, Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière - 6 mai 2020
- Opus 9 : Agnés Varda, La Pointe courte (suite) - 4 juin 2019
- Opus 9 : Noces Rouges de Claude Chabrol - 3 mars 2019
- Opus 8 — trois variations autour de Claire Denis, Vittorio de Sica et Marguerite Duras - 4 janvier 2019
- Opus 8 — dyptique : Seyrig-Coltrane, Marx-Ingold - 4 septembre 2018
- Atlal de Djamel Kerkar : dyptique - 5 mai 2018
- Jacques Sicard, Monochromes - 1 mars 2018
- Films en prose — Opus 8 - 14 novembre 2017