Il m’arrive pourtant de croire que j’ai dans les yeux pour leur sourire la toupie folle d’espérer et
Tant de soleil et si peu d’amour pour soulever le mutisme des pierres.
Tout Philippe Mathy se tient ici dans une oscillation entre deux extrêmes. Derrière chaque poème, il y a un martèlement discret, une force qui va. Ce sont des images intégrées discrètement aux phrases, non pas collées, c’est-à-dire en surplus. Elles se confondent dans le corps du texte le rehaussant d’une présence forte et discrète. Cette poésie se glisse en nous pour nous laver de quelque chose et nous renvoyer à la nature en même temps qu’à notre condition. Philippe Mathy met en avant la gravité de notre existence qui ne nous choque pas tellement elle est évidente. Le lecteur doit se laisser pénétrer par ces impressions justes, ces modesties de la profondeur où il plonge au fond de lui.
Car, c’est de nous que le poète nous parle, toujours au présent comme si tout s’accomplissait à l’instant de la parole, ce qui rend aux poèmes la densité de l’éternité qui traverse le temps et l’espace : Je referme la porte // elle est nue comme une source.
Sous la tristesse de notre condition, de notre amour mortel, de la dégénérescence de tout être vivant et de toute chose (cf. Châteaubriand), Philippe Mathy établit une biographie mentale par une poésie amenée par ce qui l’entoure directement et qui lui sert de tremplin vers le monde. sortir sortir sortir nous dit-il, quand l’évidence est quelquefois un mur.
Recueil difficile à commenter tellement nous approchons de l’insaisissable et de la présence, autour de nous, de la poésie. Un long chant à travers le monde dans ce qu’il a d’intime et de cosmique. Un monde saisi dans son quotidien le plus ordinaire et le plus fort nous est rendu autre comme par magie. Philippe Mathy a su rendre le propre du poète, d’une part, on voit et c’est autre chose que l’on dit, d’autre part, on cherche à s’évader mais non pas à fuir, c’est donc d’une ouverture qu’il s’agit.
Ouvrir encore la porte aux bruits du monde.
Partout présent dans l’air
un rire de clarté
pour oublier l’orage
revenir
au cœur sec de l’été
Page 85, nous trouvons, non pas une définition de la poésie, mais un mode d’emploi, sa profonde utilité « par temps de manque ».
Il y a beaucoup de délicatesses mais aussi de petites taches sombres qui glissent comme une continuité. Il n’y a pas d’à‑coup, le monde est « rond » mais sans concession : le bien et le mal, la laideur et la beauté ne sont qu’uns.
Dans la recherche d’une certaine vérité, le poète tente de fuir le mensonge conçu par l’esprit de l’homme. Celui-ci se trompe : la terre et la mer ne se joignent pas, c’est lui qui les joint au bout de l’horizon pour en tirer une image mais surtout une pensée. L’erreur serait-elle le fondement de notre raison ? Tout le recueil, derrière son monde sensible, donne lieu à beaucoup de réflexions.
S’il y a un espoir pour Philippe Mathy, il est autour de nous dans l’observation du monde et de sa jouissance de tout ce qui se passe et passe. Recueil qui nous élève et nous enlève.
Le saule ne pleure plus. Il danse, comme si le soir le tenait par les hanches.
Le froid nous ramènerait-il à la raison, à la solitude barbelée de nos maisons ?
Belles peintures d’Agnès Arnould qui éclatent de couleurs, de surprises face au monde quand on a su ouvrir grand les yeux et que du regard perçant mais doux on ose regarder l’autre parce que l’on ose se regarder soi-même.
*
Philippe Mathy, Sous la robe des saisons, peintures d’Agnès Arnould, Editions : L’herbe qui tremble
*

Ce recueil débute par une présence négative, certes un je suis, mais dans l’impossibilité de laisser tourner le monde en rond. Je est un gaffeur aussi bien dans le domaine spirituel que matériel, pire : L’exclu…de cette page déchirée. Espèce de négation de la négation : Le maudit qui a un clou dans le cerveau. Ne rien réussir et n’être atteint par rien, nous sommes au point zéro d’un côté et d’une peur de l’autre. Le monde y est décrit comme une impossibilité d’exister parce que d’un côté rien n’est saisissable et de l’autre, les obstacles à vivre ne peuvent être levés. Une part du rêve éveillé, où à peu de chose près, le possible serait ce rêve matérialisé comme décrire sa propre naissance sans en avoir gardé souvenir. Le réel est apprivoisé par son côté onirique. Navigation intérieure à tous les vents et à tous feux ouverts dans des mondes à la limite de l’étrange et de la peur contre lesquels nous butons. Claudio Pozzani affirme qu’il vaut mieux garder les yeux ouverts dans un délire…qui fuit. Nous sommes le plus souvent du côté négatif du monde.
Seulement des crochets de grues abandonnées
qui dansent dans le vent comme des femmes pendues
Page déchirée comme une déchirure intérieure, le tout dit sans emphase par affirmations directes qui s’accumulent comme des évidences dans un monde à oublier qui se réclame plus de la solitude. Dans le macabre et les destructions parfois des lueurs dansent, des éclats comme pour eux-mêmes. Il semble trop tard, rien ne changera. Quels secours chercher : la mère, l’amante, la religion ? Livre brûlé par des rêves, une présence absence inextricable. Ce sont des textes d’une ronde harmonie, penchés sur le présent et l’étrangeté d’être à deux pas de nous. Ces poèmes proposent leur vie au silence, à cette maturité où se reconnaît la sagesse de durer, longue vie à s’interroger au cœur des mots. « La parole ne sauve pas, parfois elle rêve » dit Yves Bonnefoy.
Tout se fait avec force détails comme si le réel n’existait plus que dans les mots. Le réel se met en place au travers du langage et le monde n’y est plus qu’un fait de langage. Le poème devient un effet sans cause. L’auteur peut tout dire sans retenue, sans référence à la raison, sans liens logiques. Le poème ne renvoie plus qu’à lui-même. Le réel y est devenu une fiction active qui n’offre plus aucune garantie puisque la norme et les codes disparaissent. Notre culture, occidentale est basée sur l’idée de la cause. Si nous voulons sortir de l’ornière collective de la langue et du langage, il nous faudra modifier nos rapports entre les mots.
L’avant dernier poème : Je danse est une transe :
Et je danse, danse, danse,
et je danserai à jamais
Je danse, danse, danse
parce que c’est toi qui me l’as demandé
Le dernier poème : J’ai vomi mon âme : préfigure un changement d’être :
Et à présent je me sens plus léger
Je peux nager librement
sans le poids du remords et des méchancetés
C’est un recueil thérapie qui tout au long va quelque part, en tâtonnant, vers une sérénité gagnée après avoir fait cet effort de se découvrir, de s’accepter, de s’imposer au monde pour finalement tenter de devenir autre. Après maintes questions, des débuts de réponses, même, à dépasser ses rêves, à attendre les mots, les siens, seule emprise sur sa propre vie. Cette page déchirée est soi renaissant.
J’ai vomi mon âme
hier
et je m’en fous
*
Claudio Pozzani, Cette page déchirée. Questa pagina strappata Prix 10 euros, Voix vives de Méditerranée en Méditerranée Editions Al Manar (bilingue)
*

« C’est pourquoi le plus dangereux de tous les biens, le langage, a été donné à l’homme… : pour qu’il témoigne ce qu’il est … ». Hölderlin
C’est le pas tranquille de tout un paysage. Pour Serge Nunez Tolin, les mots font partie intégrante du monde, ils ont absorbé les choses qui elles-mêmes les ont absorbés. Je le croyais, en début de lecture, et puis cassure entre mots et choses : Finalement un grand intervalle. Les mots n’expliquent rien. Ce qui sépare les mots des choses, ce n’est pas le silence, c’est la hâte de s’y mettre. L’auteur a posé de longues questions sur les mots, le monde et leurs rapports. Des mots récurrents : comme hâte, fenêtre, pas, mots … parsèment le recueil. Ils ne cessent de se renvoyer l’un l’autre l’écho d’un sens parfois variable. Un questionnement fait fissure dans le jour, quel est le rôle que le mot tient face aux choses, celles que l’on dit, celles qu’on ne dit pas. Nous sommes les seules vivants à détenir les mots, si faibles : si peu dans les choses. Terrible sens unique des hommes dans les choses et jamais le contraire. Nous nous occupons des choses qui ne s’occupent pas de nous. Voilà l’homme entre les deux, seul capable de les relier puisque mots et choses jamais ne se rencontrent que par son intermédiaire.
La seule conscience émane de l’homme qui fait exister le monde qui existe bien sans nous. Relation qui nous laisse amers et brimés. Les choses peuvent être vues sans être nommées et être nommées sans être présentes. De ces mots qui, en fait, nous laissent orphelins, il y a ceux qui manquent et ceux qui, présents, ne servent à rien, suggère Serge Nunez Tolin. Cet ensemble de réflexions judicieuses finissent par exaspérer, il n’y a jamais de réponse, il n’y a jamais de repos. Les mots, comment ne plus y voir qu’un piétinement, une pauvre immobilité qui ne conduit nulle part ? Les mots n’aident pas, à un certain stade, ils compliquent la vie et l’obstruent parce qu’ils noient notre conscience. Il y a peut-être une évidence du monde qui se passe des mots : les mots ne font pas la réplique.
Fou, dans ma hâte, celle de foutre le camp, d’abandonner cet « objet d’inanité sonore » comme si le présent ne pouvait être révélé que par les mots, comme s ‘ils étaient toujours et nécessairement attendus. Seraient-ils là, qu’en ferions-nous ? Et s’ils n’étaient pas là, comment vivre, comment sortir de nous-mêmes, comment nous échapper, comment communiquer ? Sans les mots, nous étoufferions.
Ces pas associés, synonymes des mots :
Faire des mots avec les jours / J’avance sur le jour, fou dans ma hâte.
N’est-ce pas, en fait, tout le problème de la vie qui est posé ? Chercher la réponse est tourner en rond. La première page du recueil en donne l’orientation générale. Les textes sont des essais de sortie, le lecteur s’y cogne la tête jour après jour. Il ne sait rien de plus à la fin du recueil et comme jusqu’au dernier jour de notre vie, nous n’avons fait que de Transmettre la poussée des présences. Certes entre les mots, entre les choses nous aurons vécu et comme eux nous ne sommes rien, seulement contenus dans notre désir de durer.
Etat de fait, Durer, Au jour le jour, titres de trois recueils que j’ai publiés, qui rejoignent l’idée générale, le fil conducteur de tout le recueil de Serge Nunez Tolin. Telle est notre condition, notre seule joie : être nous sans question et sans réponse, au point zéro de l’existence.
Mais de temps à autre, les mots ouvrent une fenêtre, l’espace peut y être respiré. Les chemins s’ouvrent dans l’ordre du quotidien. Un appel de la poésie, peut-être ? C’est le labyrinthe de la vie avec ses avancées, ses reculs, ses acceptations et ses rejets, ses joies, ses peines. C’est un recueil dans lequel le lecteur s’enfonce pour trouver la sortie que l’on ne trouve jamais. Il peut se lire, en avant en arrière, entre deux points fixes : la première page et la dernière page, comme notre vies sans doute, avec ses deux extrêmes, ses deux certitudes. Recueil épuisant que des lectures successives n’épuisent pas. On bute, on bute encore et dans notre emportement et dans notre volonté à saisir.
Peu de doute chez l’auteur, des phrases à caractère simple mais tranchantes par leur affirmation : Savoir qu’on a à ce point la faculté des mots ! Si poèmes, certes, il y a, nous sommes plus dans la sonorité de la prose que dans celle de la poésie. C’est peut-être la force de ce recueil : nulle volonté de charger la phrase autre que celle du sens appuyé sur une stricte ponctuation. L’évidence est là, entière, toujours entière pour que Voir éclate dans mes yeux. Beaucoup d’adverbes de lieu et de temps ponctuent les phrases dans une volonté d’affirmer un dire, avec toute la charge d’une vérité ressentie. Peu de métaphores, de comparaisons, la voix/voie est claire et ne livre qu’un seul sens : Tout ne finit-il pas par s’égaler ? Elle ne nous permet pas de fuir le texte, nous devons l’accepter. Nous sommes dans le domaine des constatations, le vocabulaire est courant et précis. Les mots de tous les jours sont rendus à leur stricte utilité, leur force, leur affirmation, c’est-à-dire à leur interrogation.
Me sentant de connivence avec ce recueil, je me dis qu’une recension n’exprime pas directement ce que l’auteur a dit mais ce que l’auteur m’a dit.
*
Serge Nunez Tolin, Fou, dans ma hâte Serge Nunez Tolin, Editons Rougerie 13 euros
*
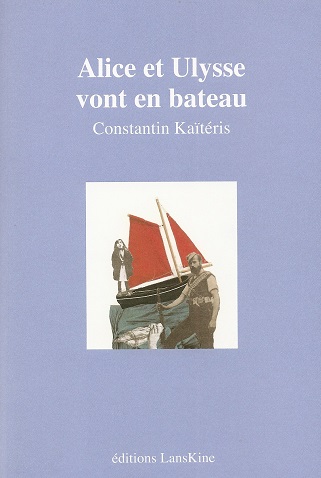
Nous sommes dans un monde multi face où les lieux et le temps se mélangent dans une sorte d’unité que traverse comme un fil conducteur tout un ensemble de textes tantôt horizontaux, tantôt verticaux. Tout ce qui existe et a existé peuvent se rencontrer.
Espèce de souffle qui traverse le livre, des mots sont lancés à la poursuite d’eux-mêmes comme si les séparations de sens avaient disparu. Le sens de l’un s’appuyant sur l’autre s’agrandit aux marges d’un monde insécable. Volonté de dépasser toutes les contraintes, tous les obstacles, toutes les règles de logique et de raison. Nous sommes dans un monde par-delà libéré de lui-même où le lecteur vient buter parce que sa culture scolaire est mise à mal, ne s’appuie plus que sur du connu qui fuit ou se transforme, passage par d’autres langues, des mots inventés… Jusqu’à ce que tout se replie dans l’éventail du réveil.
Situé entre rêve et réalité, entre possible et impossible, véritable navigation à l’estime, quelquefois par temps clair, tanguant entre les mots, les faits, prêt au naufrage de l’habitude
Les compagnons eux
toute la bande aux oreilles bouchées
souquent et galèrent ferme
tout en se rinçant l’œil
sourds aux promesses
qu’elles murmurent et tempêtent
comme aux ordres suppliants du patron
A la fin du recueil, il y a un dialogue où se glissent des éléments d’explication de la démarche. L’auteur Constantin Kaïtéris, ne nous tire-t-il pas en bateau ? Le bateau n’est-il pas le livre, le radeau de la mémoire ?
Passé et présent sont en fusion permanente. Les barques des morts clandestins, évoque l’actualité des naufrages de réfugiés clandestins avec force détails où l’attention se concentre sur des restes témoins de naufrage qu’un Ulysse moderne tente de ne pas oublier : un aviron pour mémoire contre l’oubli aveugle de la mer. Ce recueil nous présente le monde inchangé dans le fond, il n’y a que la forme qui varie au travers des siècles. Apparait aussi en filigrane toute une série de personnes devenues personnages, Rimbaud, Celan… inclus dans ce périple culturel avec Ulysse, Calypso… Dans ce mélange des peuples, de couleurs, de parfums, d’événements, se profile une immigration dont le dernier mot est nostalgie.
Un vaste remous à brasser la terre et la mer, à rassembler des souvenirs de cultures différentes comme des bribes reliées entre elles et sonnant clair, quelque part au fond de nous comme des présences, des souvenirs jamais éteints dans le feu du quotidien. Une lutte contre l’oubli encastré dans un présent sans cesse mourant, va-et-vient de la mer entre ressac et silence.
Voyages des mots, des phrases, des images autour desquels Alice et Ulysse se rassemblent où pour partir, il suffit de tourner la page et comme fin du périple de mettre le point final. Bateau d’encre et de papier, nous aurons filé sur notre frêle esquif, les nœuds marins concrets et abstraits de nos rêves entrecroisés laissés à la rose des vents comme seul gouvernail. Univers clos qui dans sa mobilité se fait fixité le temps de la lecture qui le relance dans un ailleurs où notre présence et notre culture sont sollicitées pour à nouveau parcourir le monde d’aujourd’hui.
Dans les textes, les mots sont lancés les uns sur les autres, comme des vagues qui se précipitent vers le rivage puis refluent parfois avec fracas de cailloux emportés. Il y a tout un mouvement interne qui nous ballotte sans cesse entre phrases longues et courtes, très courtes parfois et nous précipitent d’un événement à l’autre sans laisser le temps de reprendre haleine. Nous filons vers le Terminus maritime :
Pourrait- il y avoir
sur le quai
s’éloignant
sans bouger maintenant
Alysse et Ulice ?
Cette petite partie de poème, à elle seule, résume tout le recueil dans sa mobilité de lieu et sa fixité de temps, jusqu’à dans l’échange des prénoms, ce transfert qui assure un lien d’intimité entre tous les événements du monde.
Les collages, surprenant par leurs contrastes, incitent à la même méditation. Ils sont de véritables tableaux à superposition d’images et de temps et de lieux. Technique surprenante et parfaite, chaque recoin est à visiter en détail car il signifie. Il n’y a pas de centre, celui-ci se reconstitue à partir de n’importe quel point avec des couleurs parfois très vives et discrètes à la fois. Ce qui rend ces collages plus vrais est le respect de la profondeur de champ où l’œil se promène sans se perdre. Textes et collages, bien qu’ils se rehaussent, peuvent être lus séparément. Ce recueil est d’une densité difficile à rendre compte dans une recension. Il faut le lire au ralenti, par petites parties, et rafraîchir sa mémoire, de temps à autre, par l’usage du dictionnaire. Bref, nous refaisons le tour de notre culture passée assis sur le présent : La Santa Maria saluant le croiseur Aurore.
*
Alice et Ulysse vont en bateau, Collages de l’auteur, Constantin Kaïtéris, Editions LansKine 16 euros
*
Chez Recours au Poème éditeurs, Jean-Marie Corbusier a publié : Georges Perros / Un pas en avant de la mort, collection L’Atelier du Poème, 2014
















