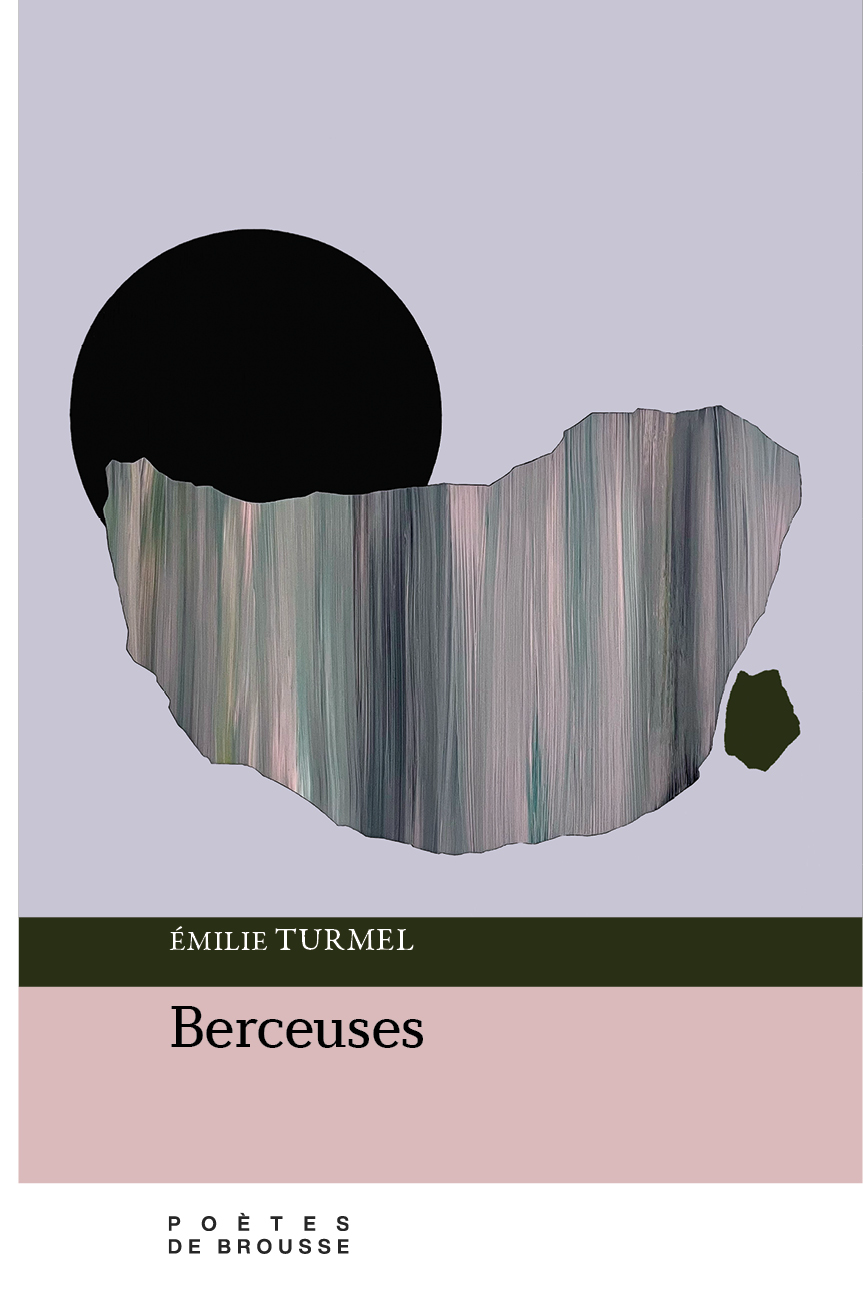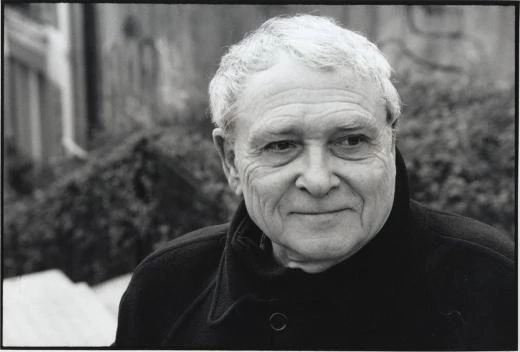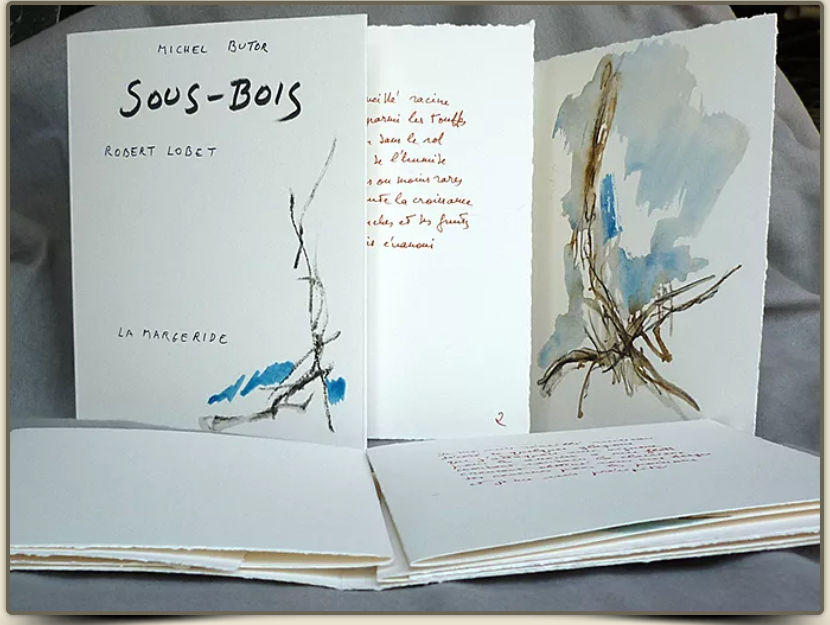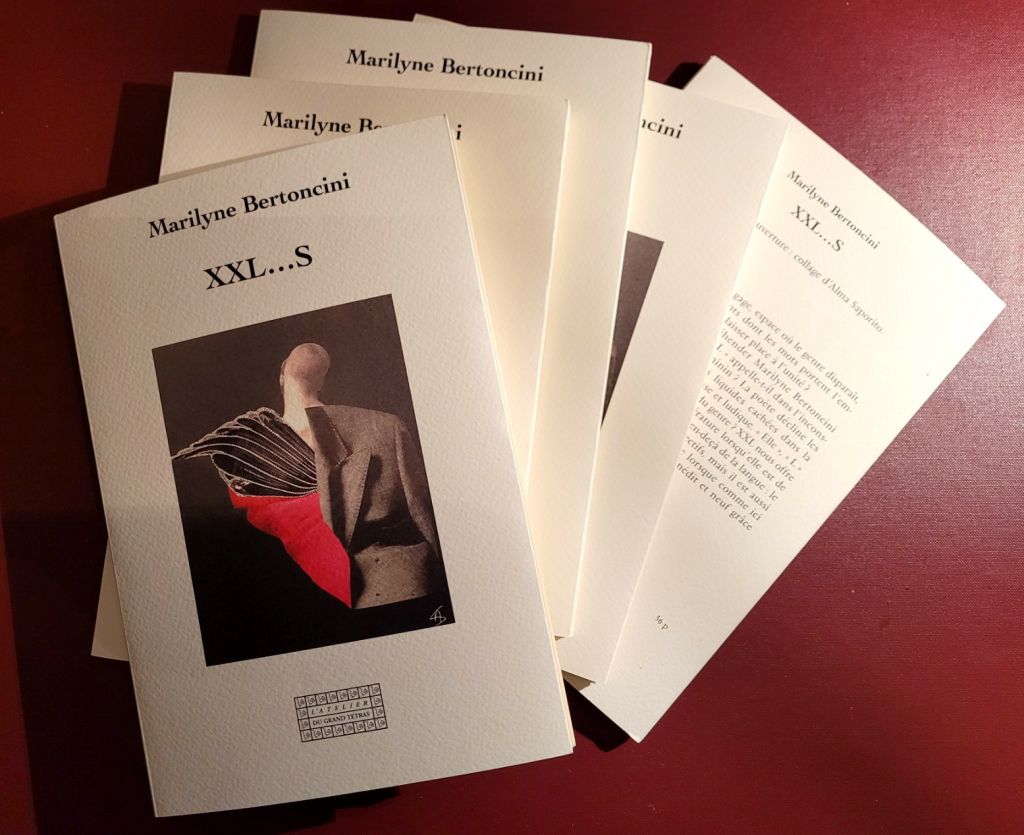1) Recours au Poème affirme l’idée d’une poésie conçue comme action politique et méta-poétique révolutionnaire : et vous ? (vous pouvez, naturellement, ne pas être en accord avec nous, ou à être d’accord dans un sens diamétralement opposé au nôtre)
Je ne suis pas certain de pouvoir deviner le sens que vous attribuez précisément à cette affirmation qui, me semble-t-il, peut donner lieu à une grande variété d’interprétations.
Je vous rejoins sur le fait que la poésie puisse être considérée comme un acte. Rappelons ici que l’étymologie grecque du mot poésie, poiein, signifie « faire ». Mais s’agit-il d’une « action politique » ? Il m’apparaît, au contraire, que l’action poétique est parfaitement libre des contingences et de la nécessité auxquelles l’action politique est soumise et qu’elle a pour devoir de gérer. A l’inverse, en paraphrasant Nicolas Diéterlé, le poète peut se permettre de contourner le monde pour voir, derrière, le Monde. Au fond, la poésie est essentiellement une vision — l’art de voir l’Invisible dans le visible et l’Imperceptible dans les objets des sens. Certes, un tel regard porte en lui une dimension « révolutionnaire », en ce sens qu’il tranche avec l’aveuglement nihiliste qui gouverne notre époque (et il conviendrait certainement à notre époque non pas de voir plus, ni même de voir mieux, mais de changer radicalement de regard).
La poésie, dans son acception la plus élevée, est une vision spirituelle sur laquelle la théorie a peu de prise. Quelques poètes occidentaux l’ont su intuitivement. Ainsi Arthur Rimbaud, dans la fameuse lettre dite du voyant : « Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant ». Ou Jean Cocteau dans Opéra : « Toute ma poésie est là : Je décalque / L’invisible (invisible à vous) ». Le poète voit et donne à voir au-delà des apparences trompeuses, dans une tentative de communiquer ce qui se situe au-delà du langage, « car la poésie, observe Fray Louis de Léon, n’est rien d’autre qu’une communication du souffle céleste et divin ». Si elle n’est pas traversée par ce souffle, elle ne vaut alors guère mieux qu’un bavardage de plus.
2) « Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve ». Cette affirmation de Hölderlin paraît-elle d’actualité ?
Indiscutablement, l’humanité traverse une crise profonde. Toutes les espèces vivant sur la terre sont aujourd’hui menacées, dans leur existence même, du fait de l’activité humaine. Plus de 26 000 espèces issues de la faune et de la flore disparaissent en moyenne chaque année. Par ailleurs, les besoins alimentaires croissants, en raison du triplement de la population mondiale depuis 1950, sont mal gérés sur le plan de la politique agricole et provoquent une déforestation sans précédent, ainsi qu’une explosion de la sous-nutrition dans les pays du Sud. D’après l’UNICEF, une personne meurt de faim dans le monde toutes les 3,6 secondes…Pourquoi ? Gandhi — prêchant dans le désert sans eau que représente l’individualisme tout-puissant de notre époque — répondrait que la terre a suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins de tous, mais pas pour assouvir l’avidité de chacun. Or, aujourd’hui, l’extrême avidité d’une minorité d’individus suffit à compromettre la satisfaction des besoins du reste de l’humanité. Tous les indicateurs statistiques montrent une évolution défavorable de la répartition des richesses depuis vingt ans. A l’échelle mondiale, les 80 personnes les plus fortunées possèdent autant de richesses que les 3,5 milliards les plus modestes[i]. Même dans les pays riches, les inégalités se creusent un peu plus chaque année : au seuil de 50 % du revenu médian après transferts sociaux, 20% des Américains vivent au dessous du seuil de pauvreté et 14% de Français, ce qui représente une augmentation relative de 29 % depuis 2002 en France, alors que ce taux n’avait jamais cessé de baisser depuis les années 70. En conséquence, la première fois depuis plusieurs générations, les français nés après 1968 sont, en moyenne, sensiblement plus pauvres que ne l’étaient leurs parents au même âge[ii].
Mais la misère de notre époque ne se limite pas à a son expression matérielle. Il existe aussi une forme de faillite spirituelle, une désorientation profonde qui permet par exemple au marché de la drogue d’être celui qui connaît la plus forte croissance au niveau mondial. Il est devenu le deuxième marché économique au monde, devant le pétrole et juste derrière la vente d’ armes[iii] ! Ajoutons qu’en parallèle du trafic de drogue, le marché licite des nouvelles substances psychoactives (drogues de synthèse et euphorisants légaux) prolifère à vive allure — plus 50% entre 2009 et 2012[iv] — et celui des « pilules du bonheur » connaît un succès que rien ne semble ni pouvoir ni vouloir arrêter. La France est d’ailleurs la championne du monde des pays consommateurs de psychotropes : un quart de la population française en consomme quotidiennement. Qui ne connaît pas, dans son entourage, quelqu’un qui ne peut ni s’endormir sans avaler un somnifère, ni affronter sa journée sans un antidépresseur ou un tranquillisant ? Ces réalités sont significatives du profond mal-être intérieur éprouvé par beaucoup de nos contemporains, qu’ils l’admettent ou le dénient.
Venons-en à la citation d’Hölderlin. Ce dernier s’est probablement inspiré de l’analyse que propose son ami Hegel du couple action-réaction : toute action provoquerait, selon le philosophe allemand, sa réaction contraire. Ainsi serait-il légitime d’espérer que le péril menaçant notre civilisation provoque des réactions salutaires des Etats ou de la société civile, susceptibles de faire émerger une nouvelle civilisation, plus égalitaire, plus solidaire, plus juste car mieux éclairée, guidée par une conscience plus large de l’interdépendance de tous les êtres sur cette Terre. Mais vouloir n’est pas savoir et, pour être sincère, je demeure circonspect quant à la nature profonde des réactions que la crise a pu engendrer jusqu’à aujourd’hui ; elles me semblent illustrer, trop souvent, le troisième temps de la dialectique hégélienne, en vertu duquel « ce qui sauve » ou semble sauver est porteur d’un nouveau péril. Malheureusement, si les contradictions d’un système produisent les conditions de leur propre faillite, rien n’assure en revanche qu’elles produisent in fine celles de leur propre dépassement, c’est-à-dire qu’elles accouchent d’un système en tous points supérieur et durablement salutaire.
Quelque chose cherche à naître aujourd’hui. Nous pouvons en percevoir les signes épars. Mais nul ne sait ce qui viendra au monde ni quand. Au niveau des Etats, l’approche « thérapeutique » de la crise demeure principalement symptomatique quand il s’agirait surtout de s’attaquer aux racines du mal ; non plus de se contenter de gérer l’existant, de recourir à des mesures cosmétiques pour tenter de rendre le visage malade de notre société moins repoussant, mais de penser et d’organiser un véritable changement de paradigme sociétal. La société civile, dans son ensemble, demeure de son côté figée dans une posture émotionnelle de dénonciation des dysfonctionnements du système existant, mais ne semble pas non plus encore prête, sauf exception, à renoncer concrètement aux acquis de ce système, c’est-à-dire à modifier profondément et durablement ses habitudes de vie, pour permettre l’émergence d’un autre monde plus juste, plus sensé et vivable pour tous. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que le monde traverse une crise profonde : « il y a crise, jugeait Antonio Gramsci, quand l’ancien monde ne veut pas mourir et que le nouveau monde ne veut pas naître. »
Une chose est certaine : la réaction engendrée par la crise profonde que nous traversons sera d’autant plus salutaire que le diagnostic établi sera juste. Or les crises politique, économique, écologique, identitaire, morale, etc., sont autant de manifestations symptomatiques du même mal, de la même faillite spirituelle. Pour être salutaire, la réponse apportée au péril actuel devra donc spirituellement éclairée. Rappelons ici que dans le poème dont la citation de votre question est issue, Hölderlin appelait de ses vœux le salut d’un monde déchu, où les hommes seraient enfin réconciliés avec la transcendance :
« Proche est
Et difficile à saisir le Dieu.
Mais là où il y a danger, croît aussi Ce qui sauve.
Quand j’étais enfant, un dieu souvent me retirait des cris et du fouet des hommes »
3) « Vous pouvez vivre trois jours sans pain ; – sans poésie, jamais ; et ceux d’entre vous qui disent le contraire se trompent : ils ne se connaissent pas ». Placez-vous la poésie à la hauteur de cette pensée de Baudelaire ?
Cette citation me remémore une pensée de Marina Tsvetaeva, parlant de poésie : « partant de la terre — c’est le premier millimètre d’air au-dessus d’elle[v] ».
En ce qui concerne la pensée de Baudelaire, je pense que celui ou celle qui se connaîtrait en vérité saurait, par expérience directe, que la poésie n’est pas vraiment une nourriture dont il serait dépendant pour sa subsistance, mais sa substance propre. Ou, plus précisément, il saurait que son être profond n’est pas différent de la Lumière qui donne à la poésie sa splendeur, son pouvoir illuminateur et son rayonnement.
Pour répondre à votre question, je serais tenté de dire que la place que j’accorde à la poésie n’est ni au-dessus ni au-dessous de cette pensée de Baudelaire, mais radicalement ailleurs : sur l’invisible sommet de ce Lieu hors de tout lieu où la civilisation védique a su l’ élever. Ainsi l’Agni-Purâna : « L’état d’Homme est difficile à atteindre en ce monde et la connaissance alors est très difficile à atteindre ; L’état de poète est difficile alors à atteindre et la puissance créatrice est alors très difficile à atteindre[vi]».
Si l’ensemble des poètes est de nos jours désigné, en Inde, par le terme « kavi » [vii], qui signifie « voyant » ou « visionnaire » en sanskrit, il désignait à l’origine une catégorie de Rishis qui jouissait d’un statut particulier. Qui sont les Rishis ? Les livres d’indologie occidentale en font le plus souvent les auteurs des Vedas [viii]. Il s’agit d’une conception erronée. S’ils étaient vraiment les auteurs des Vedas, la tradition les nommerait « Mantra-kartas », ceux qui ont « fait » les Mantras, or elle les nomme « Mantra-drashtâs », ceux qui les ont vus. Faut-il préciser qu’il ne s’agit évidemment pas d’une perception visuelle ordinaire ? Ce n’est, bien entendu, pas l’œil physique qui est ici l’instrument de perception, mais l’œil de la connaissance (jñâna-cakshuh[ix]), c’est à dire la Conscience. C’est en effet la Conscience, qui est une des grandes définitions védantiques de l’Absolu (Brahman), qui dirige tout selon les Upanishads, ces textes métaphysiques d’une époustouflante beauté symboliquement situés à la fin des Vedas car ils en constituent l’accomplissement : elle est l’œil (netra) et le fondement (pratishthâ) de tous les êtres et de toute chose[x].
Ainsi le Rishi, authentique kavi, est-il capable de voir ce qui est invisible (kavih krantha darshano bhavati), la Réalité voilée derrière le réel apparent (kavaya satyashrutah[xi]) et de la donner à voir aux autres hommes. « Directement reliés au divin par un cordon ombilical [xii] », il possède une connaissance directe de l’ordre cosmique manifesté dans le cours régulier des étoiles et la succession régulière des saisons à l’origine des lois qui régissent l’univers. Il est le médiateur entre la Parole éternelle (Vâc) et les êtres humains, car sa vision intérieure dépasse, disent les Vedas, les limites de l’espace et du temps (krântadarshin).
Toute la vision de l’art et de l’esthétique classiques de l’Inde est inspirée par l’idéal incarné par le Rishi, archétype du sage accompli et du poète visionnaire qui a su déchirer le voile des apparences, « voir » le Réel qui nous voit sans être vu. A l’évidence, l’idéal du kavi qui en découle limite les prétendants au statut de poète ! D’autant que de nos jours comme probablement de tous temps, rares sont les kavi-vara, les poètes authentiques chez qui il existe une adéquation entre l’expérience intérieure et le dire du poème.
Cet idéal se situe à l’opposé du type de poésie que Carl Jung qualifiait de « névrotique », majoritaire dans la poésie occidentale, où se joue la sublimation des névroses de l’auteur et l’adhésion à une certaine forme de fascination pour les replis les plus obscurs de l’âme humaine. Il se rapprocherait davantage de l’autre type de poésie que Jung qualifiait de « poésie visionnaire », celle qui atteint selon lui la réalité de la « psyché objective ». « L’essence de l’œuvre d’art, écrit Jung, n’est précisément pas constituée par les particularités personnelles qui l’imprègnent ; plus il en est, moins il s’agit d’art. Mais au contraire par le fait qu’elle s’élève fort au dessus du personnel et que provenant de l’esprit et du cœur elle parle à l’esprit et au cœur de l’humanité. Les éléments personnels constituent une limitation, ou même un vice de l’art[xiii]. »
Dans cette perspective qui est précisément celle de la poétique indienne également, l’enfermement dans les limites de la subjectivité individuelle, si chère à l’Occident postmoderne, est un obstacle à l’inspiration la plus haute — cette forme de perception intuitive qui fait jaillir le savoir à la conscience dont le grand grammairien Bhartrihari (455–510) fit le pivot de sa théorie de la connaissance. Plus la poésie échappe aux catégories limitées de l’ego du poète, plus elle est inspirée ; plus elle est inspirée, plus elle donne à « voir » objectivement la Réalité telle qu’elle est, le substrat intemporel ou l’écran immuable sur lequel les images du spectacle temporel défilent et disparaissent.
D’une certaine manière, la poésie authentique « déplace le moi au plus loin » (le moi limité et mortel s’entend, triplement conditionné par l’espace, le temps et la causalité), comme l’avait pressenti Paul Celan dans Le Méridien. D’où la remarque du Professeur Louis Renou, parlant de la poésie religieuse de l’Inde antique : « Il arrive, il est vrai, que des particularités de langage ou de fond unissent ensemble les poésies attribuées à tel auteur ou à telle famille. Mais nulle part, dans cette littérature assujettie à des normes rigoureuses, on ne rencontre l’expression immédiate d’une personnalité[xiv]. »
4) Dans Préface, texte communément connu sous le titre La leçon de poésie, Léo Ferré chante : « La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe (…) A l’école de la poésie, on n’apprend pas. ON SE BAT ! ». Rampez-vous, ou vous battez-vous ?
Peut-on réellement se battre, quand on s’imagine poète, contre autre chose que sa propre ignorance et sa propre cécité spirituelles, sans participer du « grand simulacre » dont on se voudrait étranger ?
5) Une question double, pour terminer : Pourquoi des poètes (Heidegger) ? En prolongement de la belle phrase (détournée) de Bernanos : la poésie, pour quoi faire ?
Pour voir et donner à voir la Réel qui nous voit sans être vu.
[i] Source : OXFAM, 2015.
[ii] Source : Observatoire des inégalités.
[iii] Source : Rapport mondial sur la drogue de 2013.
[iv] Ibid.
[v] Marina Tsvetaeva, L’art à la lumière de la conscience, Cognac, Le Temps qu’il fait, 1987, p. 54.
[vi] Agni-Purâna, Lecture 336, st. 3 et 4. Cité par Robert Linsen, in Les Cahiers du Sud, Marseille, juin-juillet 1941 (n° spécial “Message actuel de l’Inde”).
[vii] D’après les recherches du Pr G.C. Tripathi, cinq synonymes du mot kavi sont utilisés dans les Vedas : kâru, sûri, vipra, vedhas et, naturellement, rishis. Kâru, littéralement le « faiseur [vii]» désigne le compositeur, le technicien, l’artisan dont l‘œuvre est parfois comparée à celle d’un charpentier ou d’un architecte (tvashtâ). On retrouve ici une correspondance avec l’étymologie grecque du mot poésie, poiein, qui signifie « faire ». Sûri (à ne pas confondre avec la divinité oraculaire de la mythologie étrusque) désigne le poète illuminé, de nature contemplative, celui qui médite dans le but de découvrir les mystères de l’univers. Vipra est l’adjectif utilisé pour qualifier le poète érudit, qui a fait l’expérience directe d’une réalité spirituelle que l’inspiration — Pratibhâ — lui permet de communiquer aux autres hommes à l’aide de mots. Dans le Rig-Veda, un vipra n’est pas toujours un Rishi mais un Rishi, toujours un vipra[vii]. Vedhas est le créateur par excellence, celui qui unit la connaissance et l’action.
[viii] Le Rig-Veda ou « Veda des hymnes » est un des quatre Vedas. Deux grandes sources de textes sacrés sont reconnues dans le Sanâtana Dharma (« Loi éternelle », le nom traditionnel de l’hindouisme) : la Shruti et la Smriti. La Shruti (-litter. « ce qui a été entendu », de la racine « SHRU– » : « Entendre ») est sans commencement (anadi), c’est-à-dire éternelle et donc d’origine non-humaine (apaurusheya) : la révélation védique, les quatre Vedas ( racine « VID-» : « science, connaissance ») dont font partie le Upanishads. La Smriti (racine « SMR– » : « mémoire ») est d’origine humaine (paurusheya) : la somme de textes mémorisés et transmis par la tradition en accord avec le contenu de la révélation des Vedas, dont fait partie la célèbre Bhagavad-gîtâ.
[ix] Cf. Bhagavad-Gîtâ XV, 10 et XIII, 34.
[x] Cf. Aitareya Upanishad III, i, 3.
[xi] Rig Veda, V. 57.8.2
[xii] Asmâkam teshu [deveshu] nâbhayh, Rig-Veda, I, 39,9.
[xiii] Carl Jung, in Problèmes de l’âme moderne (“Psychologie et poésie”)
[xiv] La poésie religieuse de l’Inde antique, P.U.F, Paris, 1942, page 6.