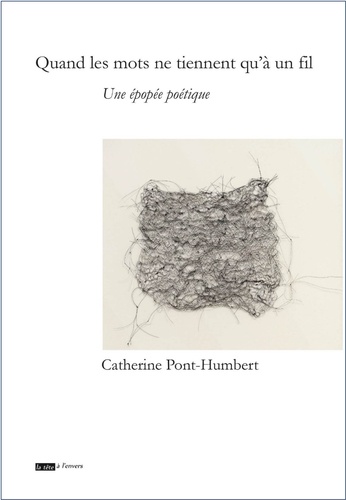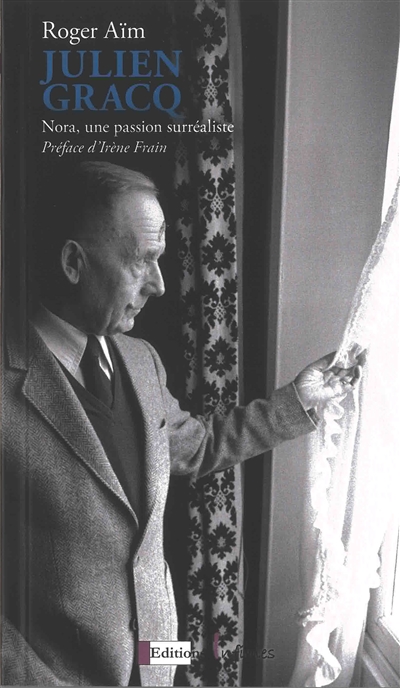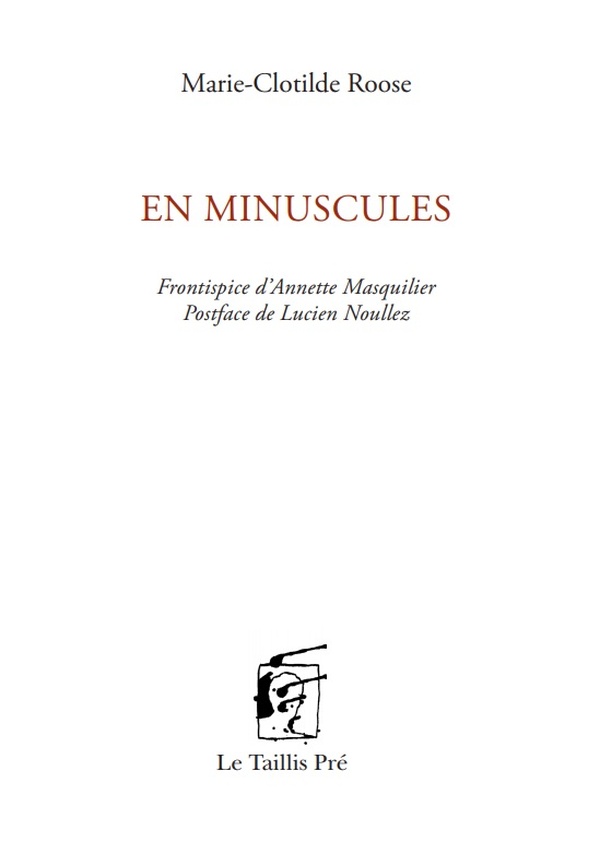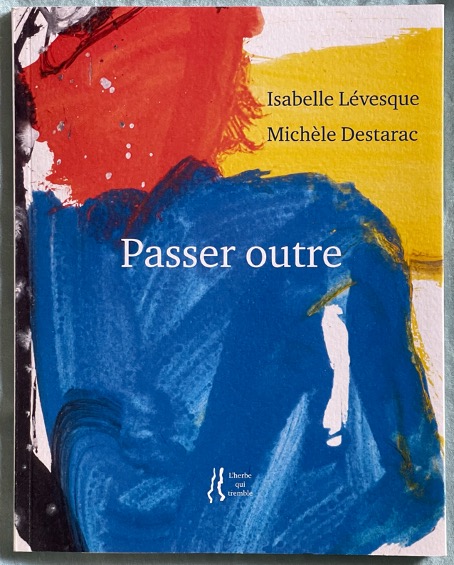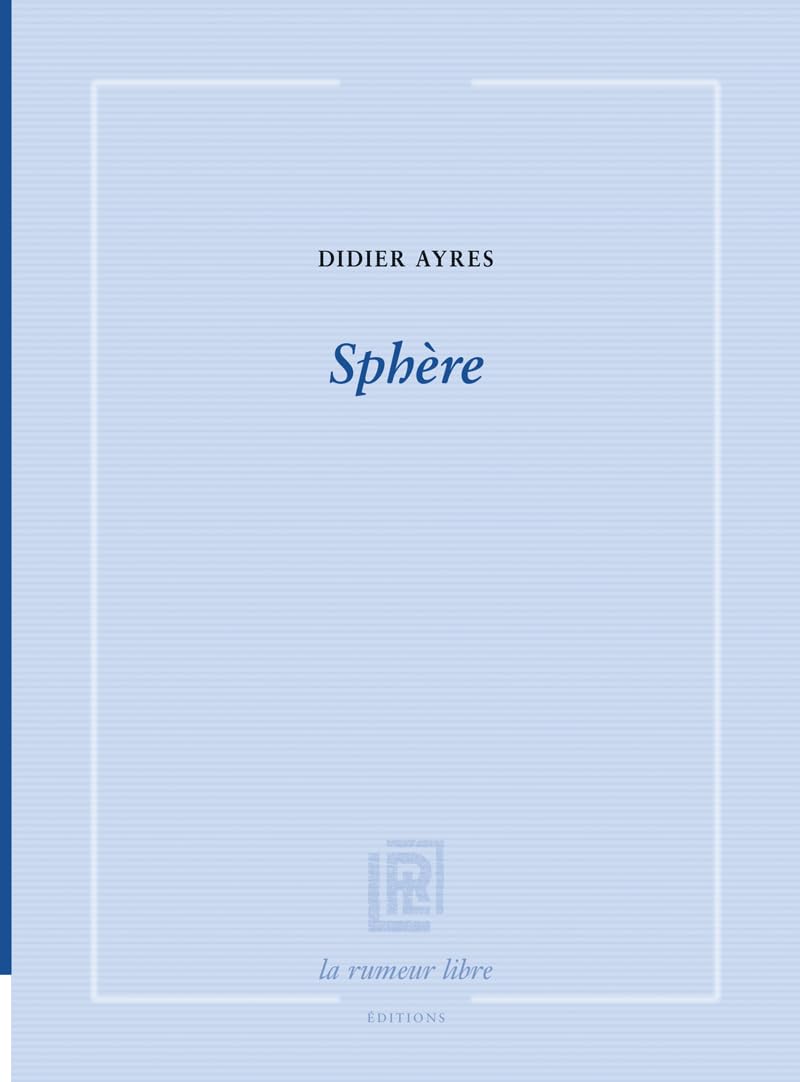Hannah Sullivan, Etait-ce pour cela, Joël Vernet, Copeaux du dehors
Hannah Sullivan piétonne de l’existence
Depuis qu’elle a trouvé pour elle le sens de la poésie Hannah Sullivan écrit pour attraper l’absence, mais l’absence glisse entre mes doigts. Face au réel elle cherche une lumière qui ne veut pas d’ombre, mais celle-ci reste source d’ un battement d’ailes dans la cage d’un cœur aussi blessé d’une femme. D’où la fièvre de cette poéte anglaise paradoxale et déjà couronnée pour son premier livre (Three poems) par le T.S. Eliot Prize en 2021.
Queques années avant Hannah Sullivan se trouvait à bord d’un bus qui la conduisait de Londres à Oxford. Le trajet l’a fait passer devant la carcasse calcinée de la tour Grenfell incendiée - un immeuble de logements sociaux du quartier de Kensington - Elle se souvient du soleil matinal, dont les rayons transperçaient le squelette de béton “dans un subit flamboiement” juste avant c’était avant que ses murs furent « pudiquement » cachés par des bâches blanches).
L’auteure a ressenti “l’horreur de cette carcasse physique, et de ce qui se trouvait toujours à l’intérieur”. Elle a écrit quelques lignes que l’on retrouve aujourd’hui "Était-ce pour cela”, recueil de poésie est sur le sens de l'existence et la place de l'homme. A travers une exploration des différents lieux qui ont marqué sa vie, l'écrivaine explore son passé et interroge son présent.
Parfois le vent dévore les coupoles et les dômes de Londres, les rues se courbent sous l’assaut du néant, la Tamise, monstre reptilien, lèche les quais et des âmes liquides se dissolvent dans ses reflets grisâtres.
Hannah Sullivan surgit des averses, parfois ses paumes jointes en prière de lumière, face à l’éclat fragile d’un regard fauve de la pluie qui noies les âmes, les visages, les noms. Retenant dans ce livre des sortes d’exils où les êtres marchent, les yeux grands ouverts pour contempler l’éclat de petites victoires et de défaites parfois plus large. Mais une telle poésie d’existence est exceptionnelle.
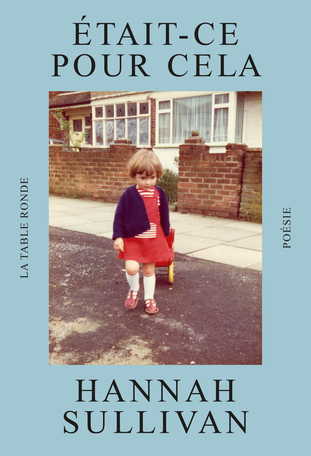
Hannah Sullivan, Etait-ce pour cela, bilingue, trad. Patrick Hersant, La Tablle Ronde, ¨Paris, 2025, 248 page, 21,50 €.
D’autant qu’Hannah Sullivan nous « oblige » à faire lorsque la fin du monde arrive au sein d’une accumulation minutieuse : manger des pavés de saumon rôtis, des Smarties, des fruits rouges, des vitamines à coenzymes, des pêches à peine mûres. Mais pour compléter les nourritures terrestres elle engage lectrices et lecteurs visiter les œuvres de Homère, Yeats, Eliot, Freud, Virginia Woolf bien sûr. Ce qui pour elle juge vaguement les règles de la mode.
Se succèdent ainsi duffel-coat bleu, robe de cocktail dos nu ou pantalon de grossesse. Mais restant chez soi tout est possible : regarder YouTube, La Pat' Patrouille, les infos, les chiffres, de vieilles photos pour regarder les uns et les autres, penser emprunter de l'argent, porter le deuil. Tomber amoureux de la charmante bouche d’un homme. Enfin, elle traverse aussi les terrasses et districts du Londres des années 80, les larges rues de Boston où les blocs de glace ressemblent à des Brancusi. Dans chaque lie où rien n'est trop insignifiant ou disgracieux pour retenir son attention.
La créatrice lèche parfois des ruines sans se souvenir de ce qui fut, un frisson d’invisible contre sa peau. De fait, elle n’oublie jamais rien tout à fait. Elle se laisse glisser en un pli de brume qui s’efface d’un baiser de sel et elle devient limon même s’il existe une faille, juste là, au bord des lèvres entre le cri et le silence.
Dans un tel livre, les mots arrivent comme des chevaux sans rênes, hésitent, trébuchent, se fracassent contre l’indicible, mais ils sont parfaitement écrits, cherchant à creuser dans l’ombre une empreinte qui refuse de tenir. S’y saisit une flamme, un vertige suspendu dans l’air, une brûlure qui refuse de laisser des cendres.
Hannah Sullivan écrit, écrit encore dans une fièvre qu’aucun châssis ne saurait tenir et une ébauche qu’elle ne termine jamais pleine d’une absence qui le brûle. Bref elle tend sa main avalée par la gravité du monde. Il y a dans chaque texte un choc : l’auteure est là et voit partout jusque dans les flaques qui bouillonnent sous la pluie, dans le hurlement muet des fenêtres ouvertes à l’abîme. Son ombre marche derrière elle, jamais entière, fracturée, éclatée
∗∗∗
Joël Vernet : émerveillements
Quoique fidèle à un de ses titre : L’oubli est une tâche dans le ciel, Vernet rassemble toujours les signes du monde qu’il fait sien même si de l’image de la vie il fait de sa poésie un interminable journal inachevé, inachevable ».
Le réel seul y est suggestif et semblable aux images qu’en de nombreux voyages sur les terres d’Afrique le poète a saisies mouvantes, fuyantes et presque innommables. Contre la vie immobile chacun de ses textes se veut la synthèse provisoire de ce que voient les yeux là où le sable rejoint les pierres et où un fleuve dessine ses méandres. Il est donc toujours nécessaire de s’attarder pour retarder les adieux.
Errant pas excellence, Vernet fait un art de sa contemplation infatigable. D’autant que chez lui agit comme un rabot. Ses textes, fragments d’esprit, deviennent des copeaux enlevés du Dehors pour nourrir sa maison de l’être. Tour se passe ici comme s’il n’a plus de paroles à proférer : »Je peux et sais enfin me taire. Je puise l’encre dans le dernier silence. Désormais, le Dehors est un soleil écrivant tous les livres à ma place. »
Celui-ci est le dernier, et comme souvent il est le fruit et la conséquence de ses voyages. Après la Syrie et l’Afrique ses copeaux se sont accumulés ici au fil de trois années de flânerie dans les paysages hivernaux des Balkans.
Comme toujours l’écriture retient ce que ses yeux voient. Des phrases de lumière sont tirées de l’ombre de l’existence et des clameurs du monde. Et ce livre empêche de croupir. La poésie doit retenir les couchers de soleil, les éclats d’âme et elle fait des autres des compagnons de voyage. Et par exemple « Quelques larmes sur les joues d’une vieille femme, la lumière argentée qui tinte dans les arbres à cette seconde où un éclat m’apporte tout. ». Il s’agit de partager avec elle la plus haute ferveur et l’insupportable ennui, le pain, les jours, bref un ordinaire.
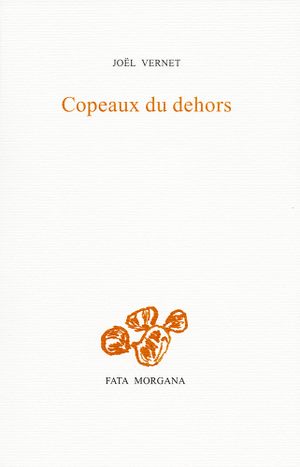
Joël Vernet, Copeaux du dehors, llustrations de Vincent Bebert, Fata LMorgana, Fontfroide le Haut, 144 p., 25 €.
Ce livre est donc une nouvelles suites de retrouvailles, et le celui des regards. S’y repèrent les envie de ciels limpides, de temples, de bordels, de nuits à la belle étoile, de quelques amours furtives aux chambres défaites. La poésie de Vernet y interroge en permanence le réel, balaie les illusions, métamorphose ce que l’œil sait retenir et, éduqué, celui-cu donne à la beauté un visage : buriné de brèches et de veines lourdes à mesure que le temps passe.