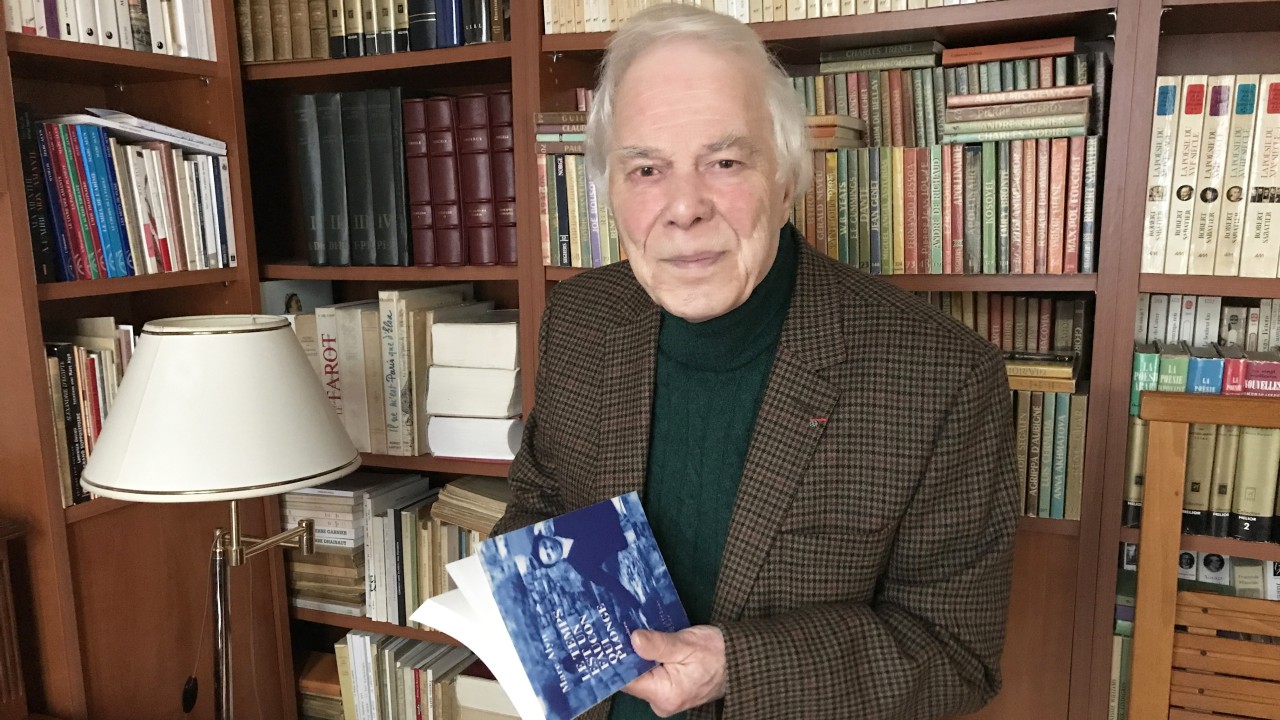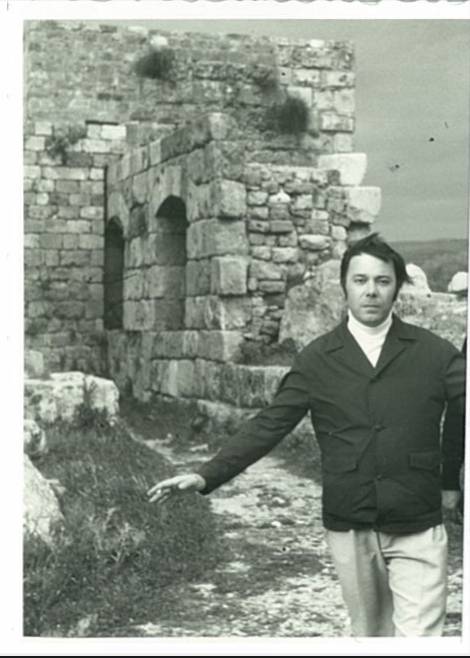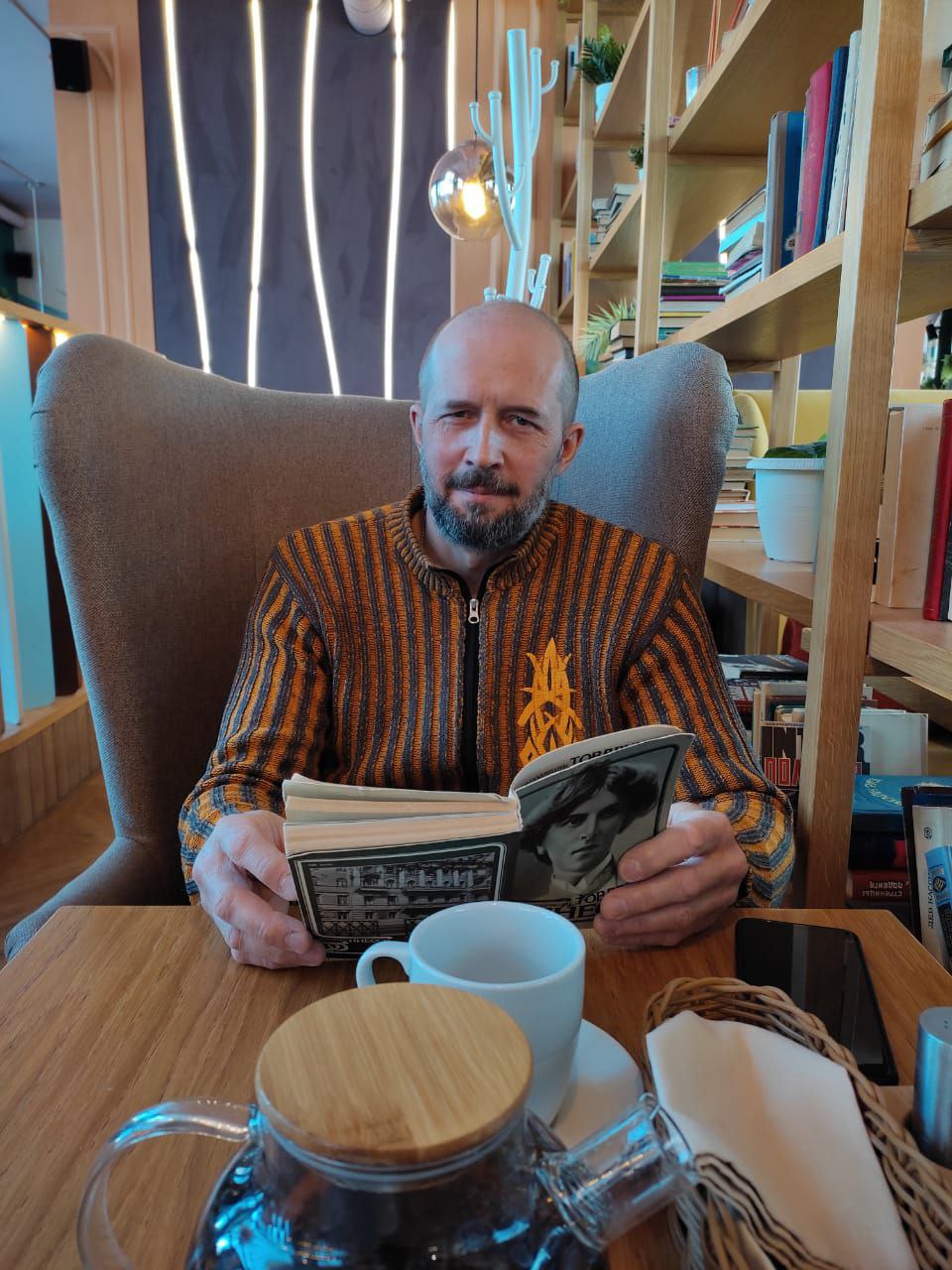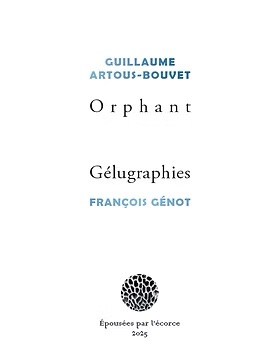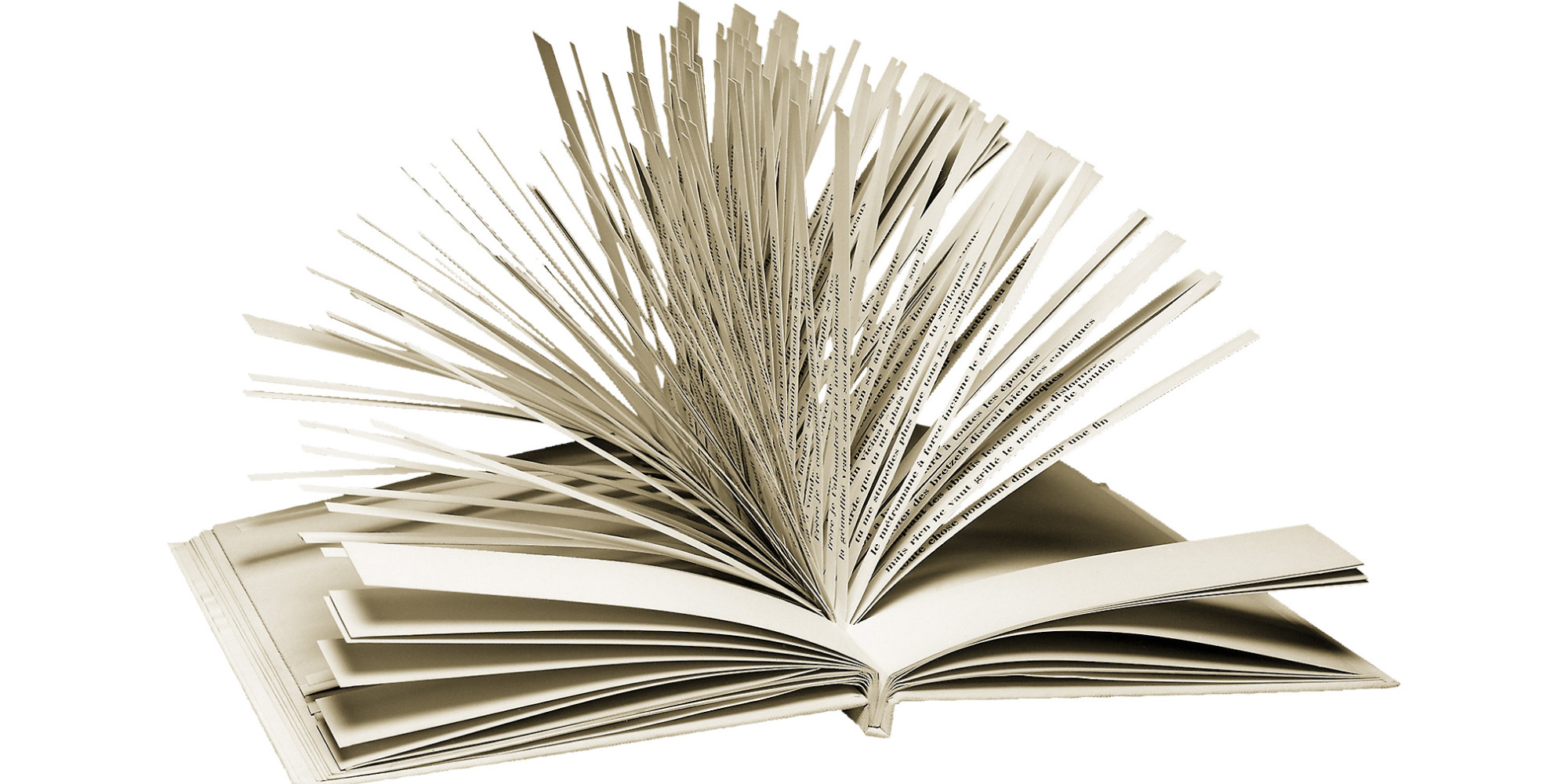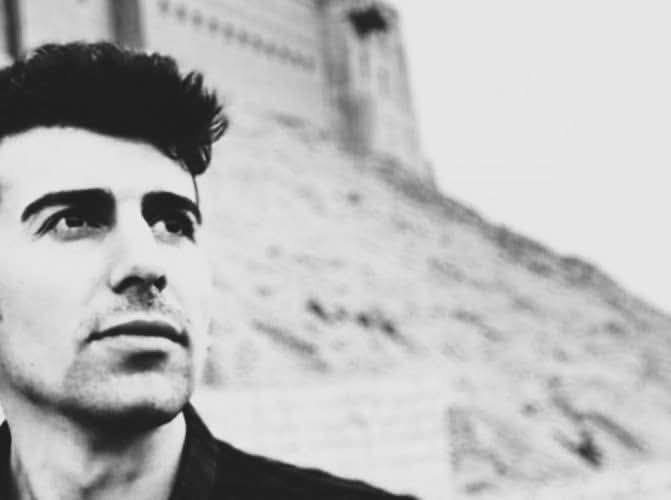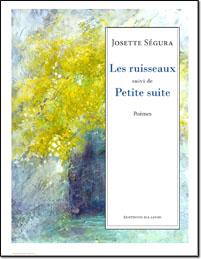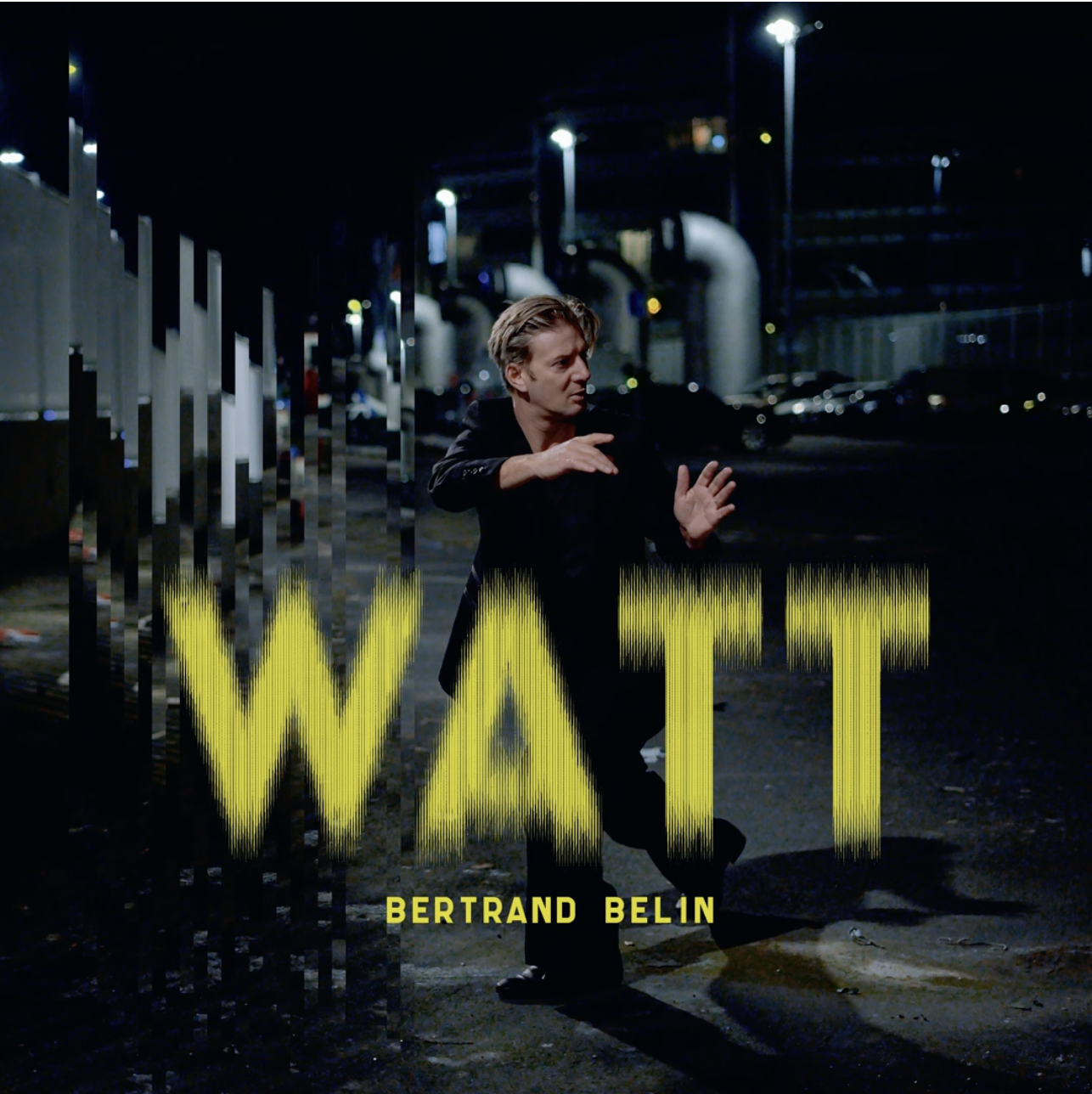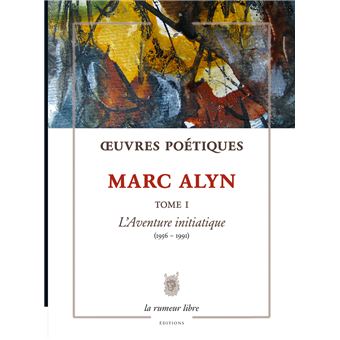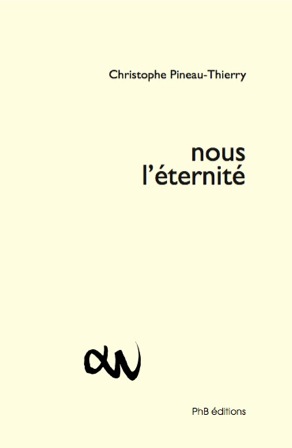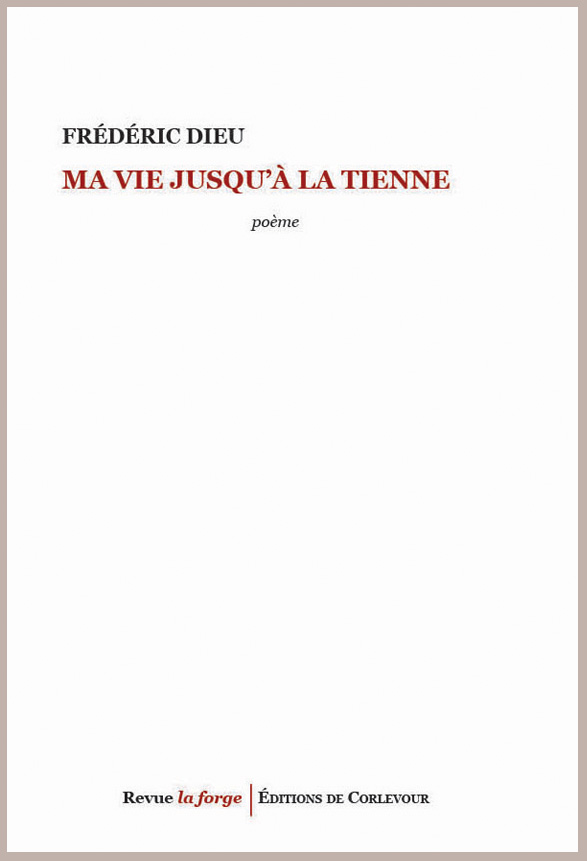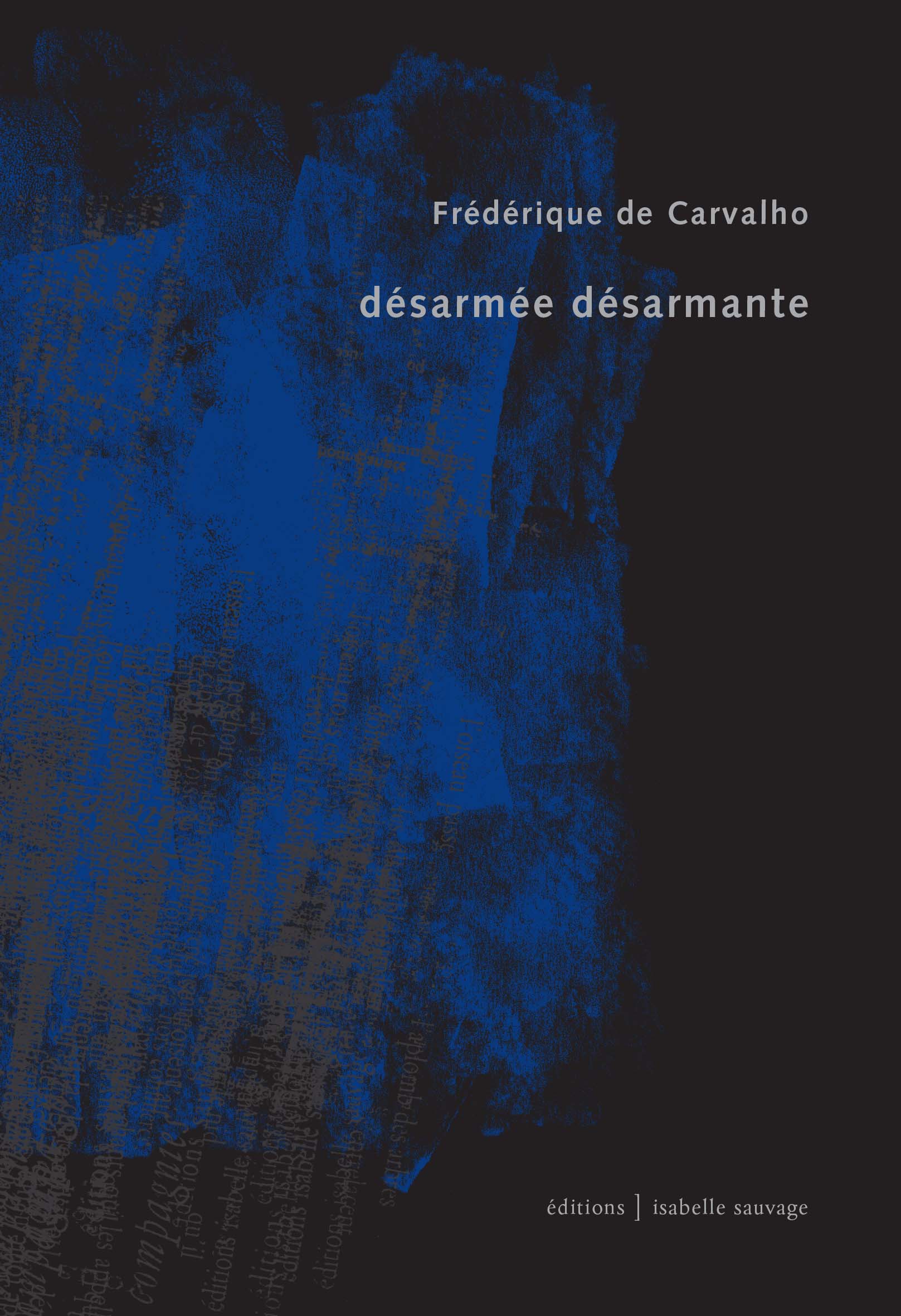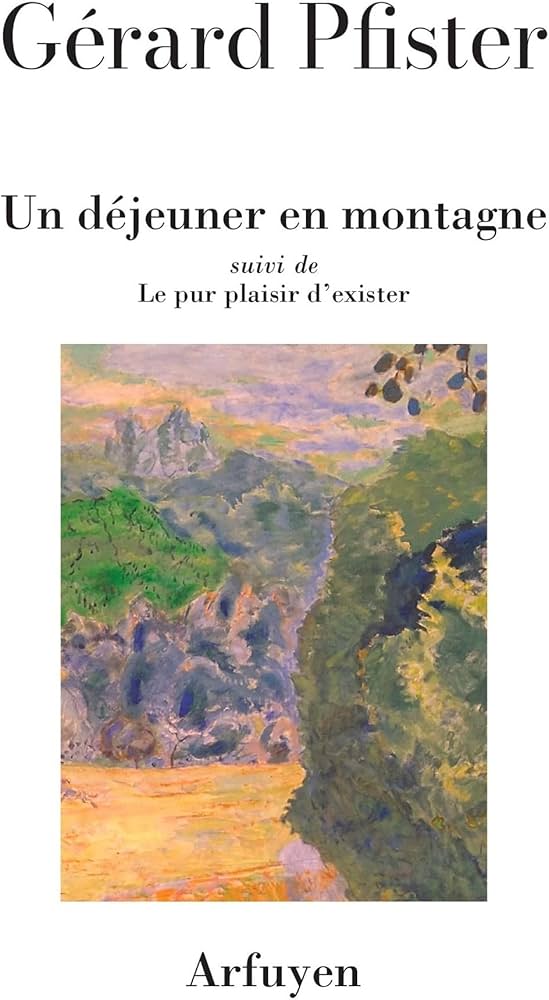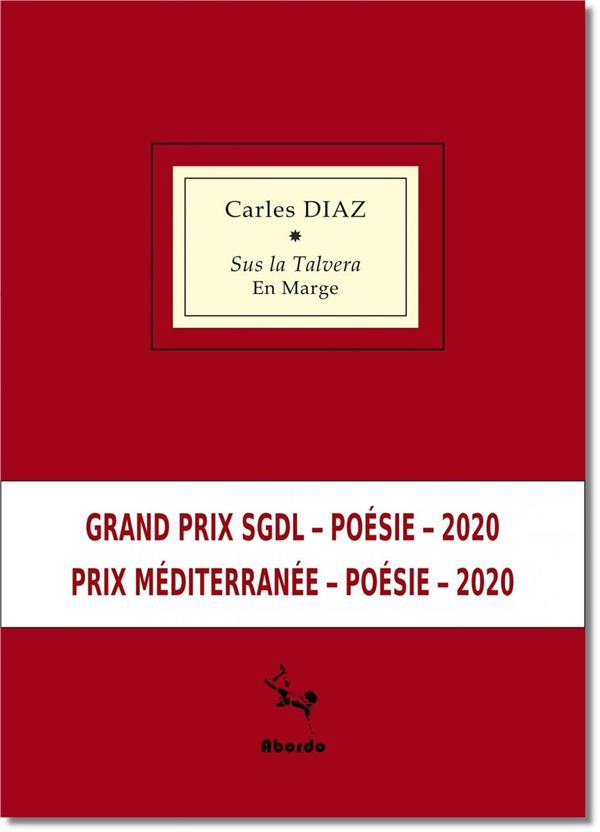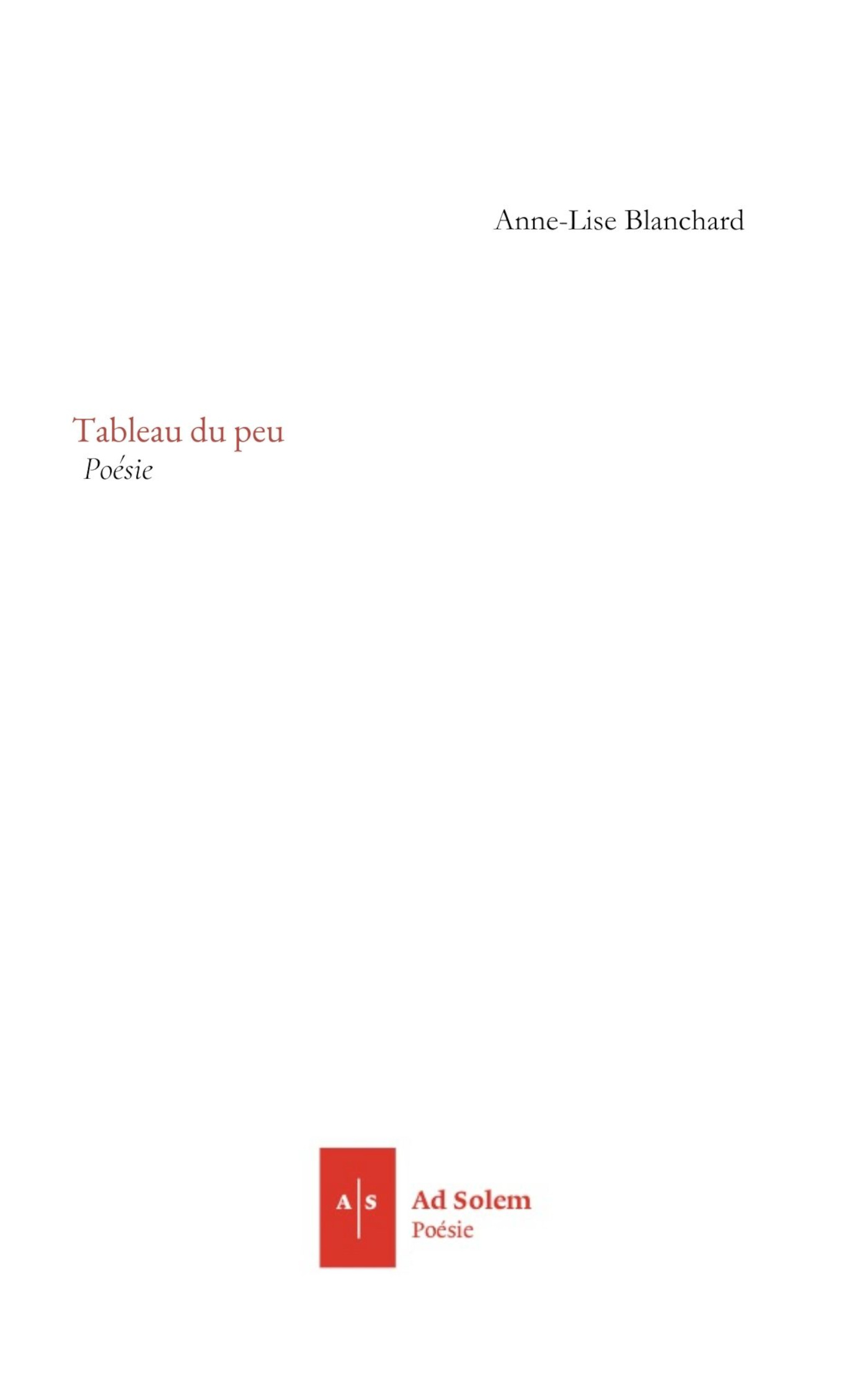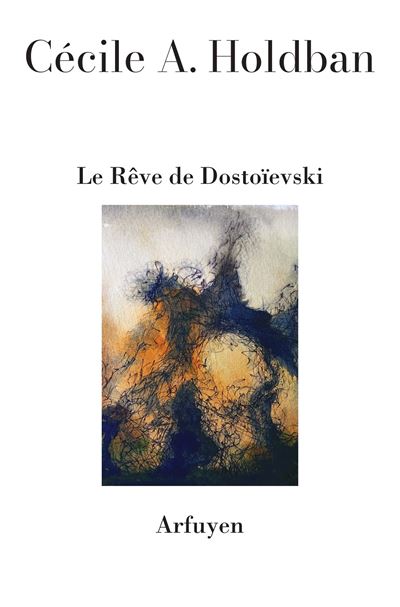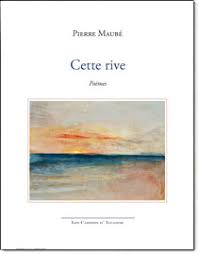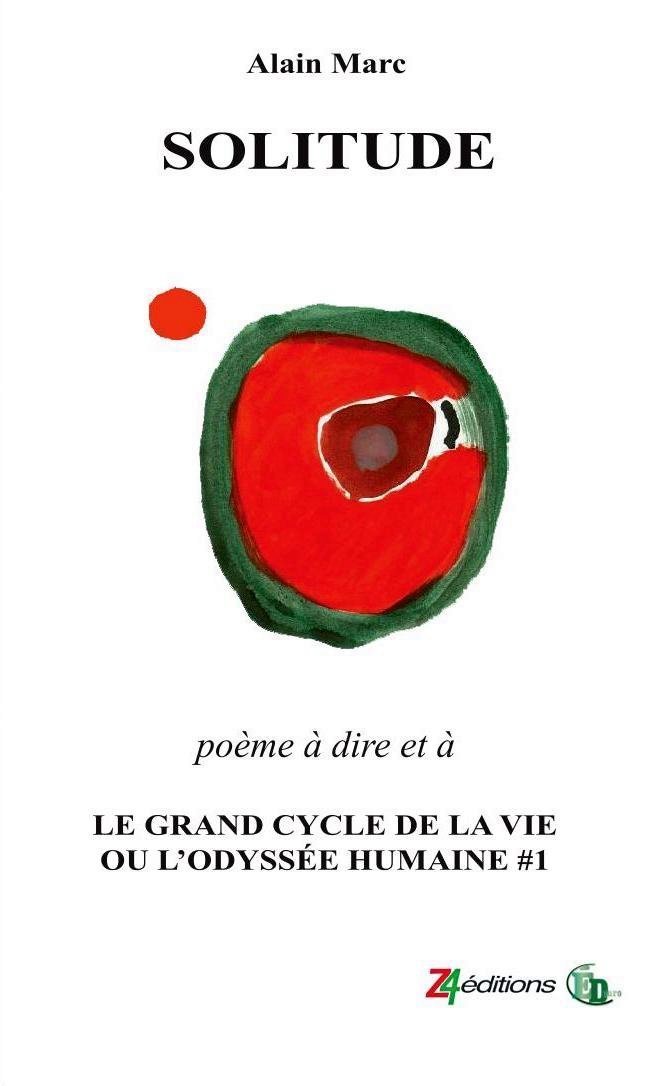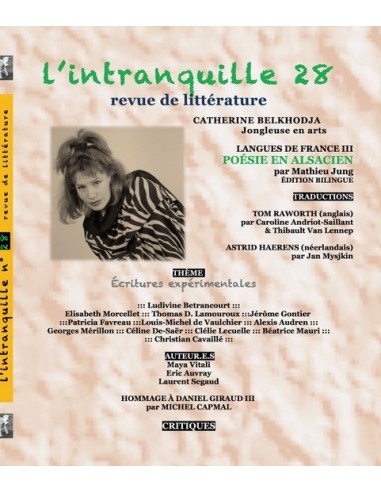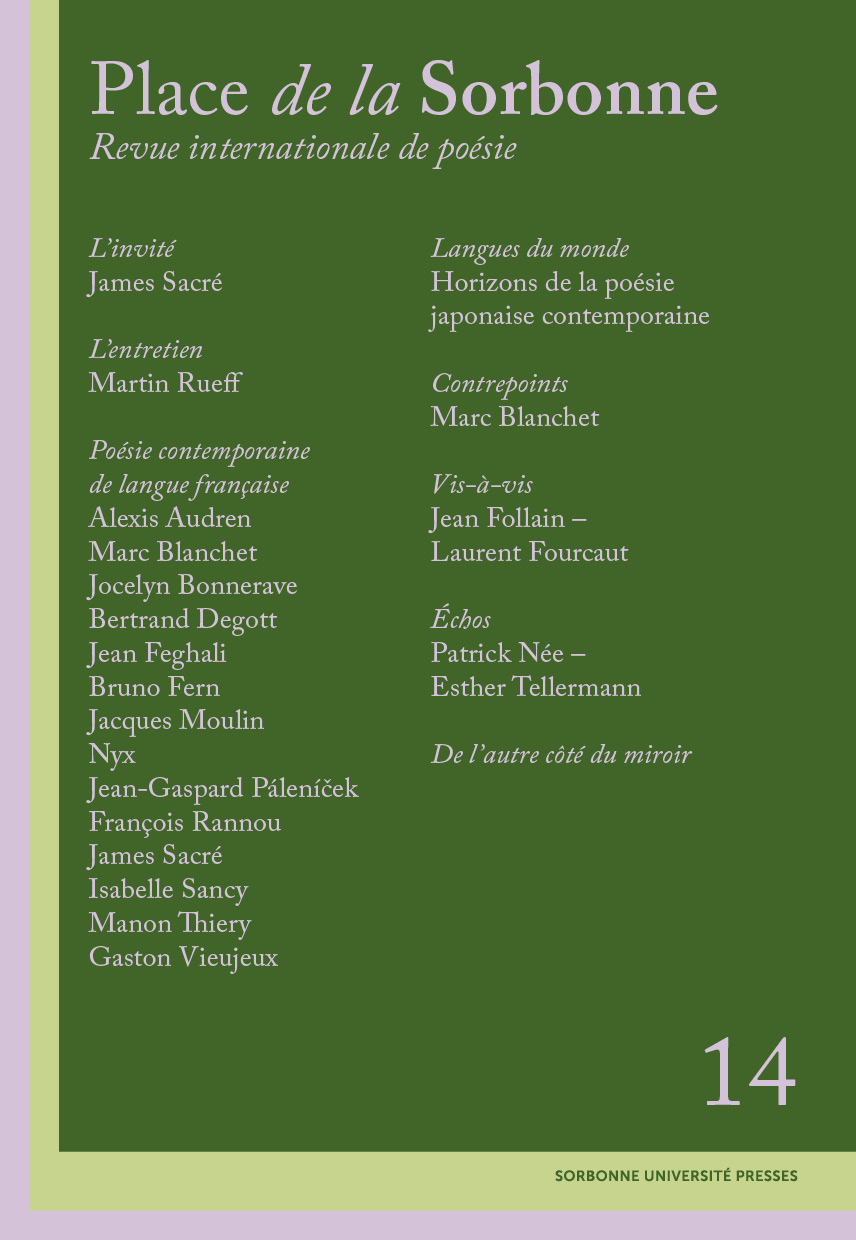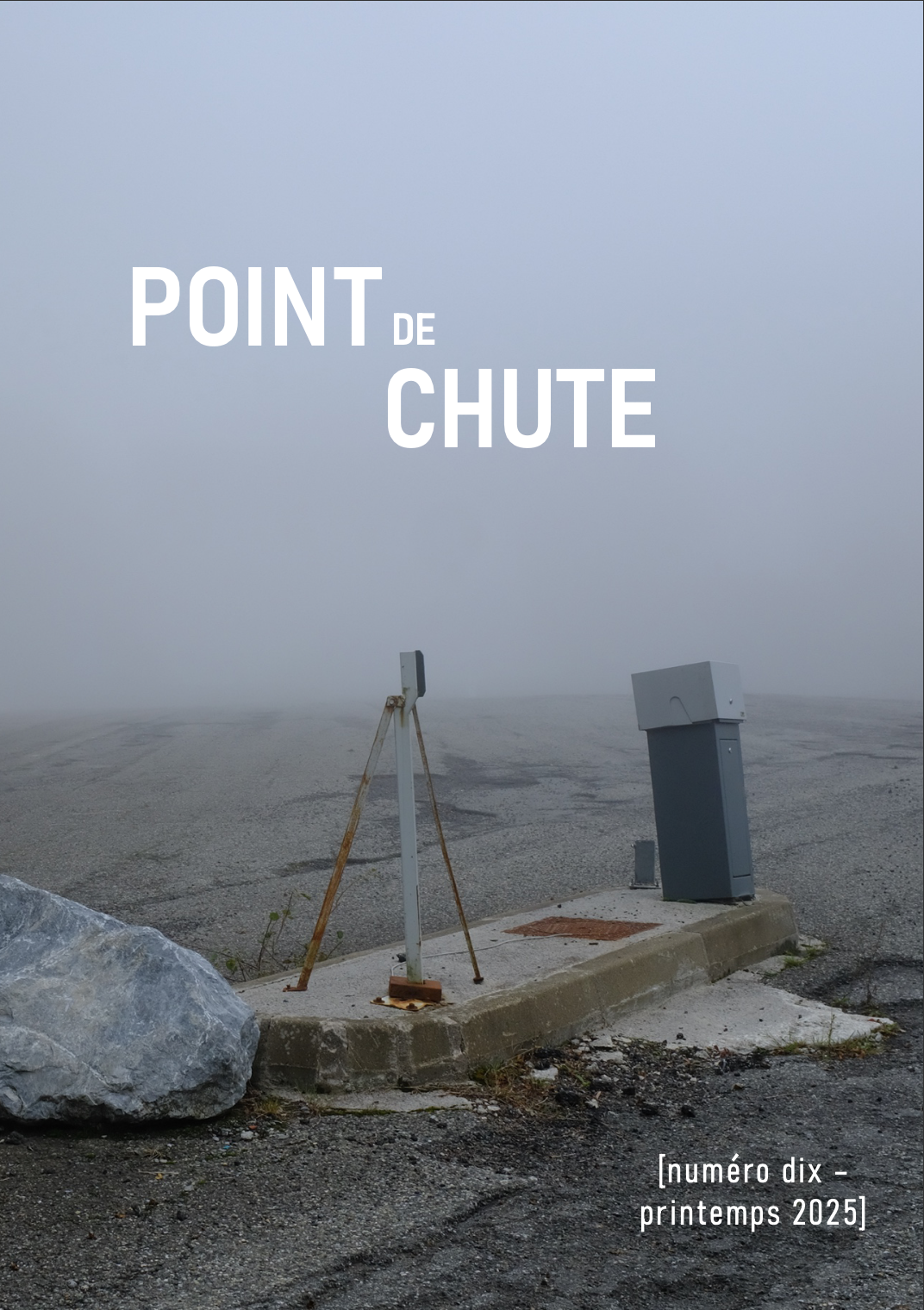Recours au poème – Numéro 235 — Janvier/Février 2026
Dossier Dans la Nuits majeures du poème — Hommage à Marc Alyn
Poèmes en une
-
Marc Alyn
T’ang l’obscur, Mémorial de l’encre, extraits
-
Fabienne Roitel
À contre-courant
-
Marie-Josée Christien
Les sens en tous sens
-
Salah Al Hamdani
Nouvel An avant l’heure
-
Roselyne Sibille
Ce qui perdure
-
Raphaël Rouxeville
Nuit du rapace
-
Hanen Marouani
Ton jasmin nous appartient et autres poèmes
-
Guillaume Dreidemie
Je commence
-
Neo Brightwell
Triptyque du pays silencieux
Focus
L’Enfant de poésie : entretien avec Marc Alyn
2026–01-07T12:19:05+01:00Par Bérénice Bonhomme|Catégories: Focus , Marc Alyn|
Essais & Chroniques
Regard sur la poésie Native American, Diane Burns : une poésie pulsée
2026–01-07T07:29:42+01:00Par Béatrice Machet|Numéros: 235|
La poète Diane Burns est […]
Sergeï Din, la part invisible du jour
2026–01-06T16:41:35+01:00Par La rédaction|Numéros: 235|
Sergeï Din représente une voix […]
Autour des éditions Épousées par l’écorce : d’Étienne Vaunac, Guillaume Artous-Bouvet
2026–01-06T18:06:18+01:00Par Jean-Christophe Belleveaux|Numéros: 235|
Les éditions Épousées par l’écorce […]
Kenny Lefevre, VALIDATION FORMELLE DE LA STRUCTURE K12
2026–01-06T16:41:10+01:00Par Kenny Lefevre|Numéros: 235|
Palindrome total en alexandrins français […]
Patricia L. Hamilton – Sélection de poèmes
2026–01-07T07:27:24+01:00Par Alice-Catherine Carls|Numéros: 235|
Poèmes présentés et traduits de […]
Les Habitants du Silence : Omed Quarani, poète kurde
2026–01-06T17:43:27+01:00Par La rédaction|Numéros: 235|
Omed Qarani (né en 1992 […]
Chronique du veilleur (62) : Josette Ségura
2026–01-06T16:38:49+01:00Par Gérard Bocholier|Numéros: 235|
Dans son dernier livre, Les […]
Chronique musicale (17) : WATT de Bertrand Belin
2026–01-06T16:38:36+01:00Par Rémy Soual|Numéros: 235|
SO WHAT ? WATT ! […]
L’œuvre poétique de Marc Alyn : un itinéraire alchimique
2026–01-06T16:37:30+01:00Par Béatrice Bonhomme|Numéros: 235|
Les trois volumes des œuvres […]
Critiques
Christophe Pineau-Thierry, nous l’éternité
2026–01-24T09:48:44+01:00Par Philippe Leuckx|Numéros: 235| Catégories: Christophe Pineau-Thierry , Critiques|
Frédéric Dieu, Ma vie jusqu’à la tienne
2026–01-24T09:36:06+01:00Par Jean-Marc Sourdillon|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Frédéric Dieu|
Frédérique de Carvalho, désarmée désarmante
2026–01-06T16:42:30+01:00Par Mathias Lair|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Frédérique de Carvalho|
Gérard Pfister, Un déjeuner en montagne suivi de Le pur plaisir d’exister
2026–01-07T07:00:04+01:00Par Marie-France de Palacio|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Gérard Pfister|
Carles Diaz, Sus la talvera / En marge
2026–01-09T05:51:42+01:00Par Franck Ferraty|Numéros: 235| Catégories: Carles Diaz , Critiques|
Parme Ceriset, Amazone d’Outre-monde, Entre la mort et l’extase
2026–01-07T14:55:18+01:00Par Stéphane Juranics|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Parme Ceriset|
Anne-Lise Blanchard, Tableau du peu
2026–01-06T16:39:16+01:00Par Pierre Tanguy|Numéros: 235| Catégories: Anne-Lise Blanchard , Critiques|
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski
2026–01-09T05:48:53+01:00Par Pierrick de Chermont|Numéros: 235| Catégories: Cécile A. Holdban , Critiques|
Pierre Maubé, Cette rive
2026–01-07T15:19:29+01:00Par France Burghelle Rey|Numéros: 235| Catégories: Critiques , Pierre Maubé|
Alain Marc, SOLITUDE — le Grand cycle de la vie ou l’odyssée humaine # 1, Jacqueline Saint-Jean, Nous les inachevés
2026–01-06T16:42:56+01:00Par Jean-Paul Gavard-Perret|Numéros: 235| Catégories: Alain Marc , Critiques , Jacqueline Saint-Jean|
Revue des revues
L’Intranquille n°28
2026–01-06T16:38:12+01:00Par Carole Mesrobian|Numéros: 235| Catégories: Revue des revues|
Place de la Sorbonne n°14
2026–01-06T16:38:05+01:00Par Carole Mesrobian|Numéros: 235| Catégories: Revue des revues|
Point de chute, cabane semestrielle pour poèmes en chantier — n°10, printemps 2025
2026–01-06T16:37:59+01:00Par Carole Mesrobian|Numéros: 235| Catégories: Revue des revues|
Rencontre avec…
Actualités
Là où les étoiles font rive — Vénus Khoury-Ghata (1937–2026)
2026–01-29T16:57:20+01:00Par La rédaction|Catégories: Actualités , Vénus Khoury-Ghata|
Agenda
février 2026
Aucun événement
Nous avons reçu…
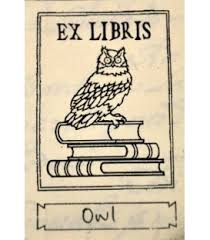
Voir l’album des Livres Reçus sur notre page dédiée => Nous avons reçu
L’ire Du Dire
RaP sur YouTube
li(V)re de Marilyne Bertoncini
Poetry sound map
Pour plus d’informations ⇒ contacts
Newsletter
[wysija_form id=“1”]