Paul Nizan : le cheval de Troie
Normalien, ami de Sartre, militant communiste, philosophe et romancier, Paul Nizan (1905-1940) vivait et écrivait en des temps extrêmement périlleux. Se serait-il engagé dans la Résistance s’il n’était tombé sous les balles allemandes, près de Saint-Omer, en mai 1940 ? Sans doute. De cette vie fauchée dans la fleur de l’âge, il reste cependant quelques livres majeurs de la littérature française d’avant-guerre. Le cheval de Troie est de ceux-là. Moins connu que La conspiration qu’il précède de quelques années, ce roman est la preuve assez parfaite que l’engagement ne nuit pas à la littérature quand il est porté par la plume d’un grand écrivain.
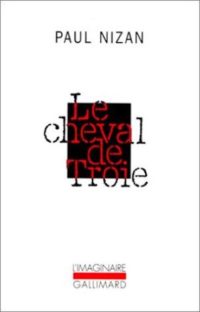
Paul Nizan, Le Cheval de Troie,Edition l’Imaginaire/Gallimard (avec une préface de l’historien Pascal Ory)
Car Nizan fut un remarquable prosateur capable, tout comme Aragon, de transcender la réalité par des descriptions confinant à l’allégorie, usant avec bonheur de l’analogie pour faire mettre en lumière les rapports secrets entre l’activité humaine et les productions de la nature. Il excellait aussi à croquer en quelques lignes des portraits de militants, à commencer par Antoine Bloyé, le professeur en quête d’un idéal fraternel, l’âme pensante de ce petit groupe d’hommes et de femmes précocement marqués par la dureté des tâches quotidiennes :
Le ventre de Berthe gonflait sa robe : sur ses jambes nues se nouaient les serpents violets des varices ; ses paumes tournées vers le ciel portaient les ampoules, les callosités des mains d’hommes. Les yeux de Catherine étaient bordés de rouge ; ses seins étaient vidés. Ces deux corps manifestaient au grand jour par des signes accablants leurs fardeaux, leurs combats. Seuls le corps, les joues, les jambes de Marie-Louise profitaient encore des sursis de la jeunesse. (Page 35)
Car le Nizan de cette période est déjà un romancier du collectif, à l’opposé tant de Sartre et du Roquentin de La nausée que du Gilles de Drieu La Rochelle. Seul Lange, dans ce groupe, est celui qui, par son indécision, se rapproche le plus de ces figures conflictuelles de l’individualisme bourgeois. Nizan veut exalter l’union des prolétaires en vue de faire advenir un monde plus juste. Si ce chemin-là passe forcément par la lutte contre les tenants du fascisme, il implique d’abord l’affrontement avec les représentants d’un pouvoir républicain résolu à faire régner l’ordre et la paix civile par les moyens les plus brutaux. C’est précisément ce qui va arriver par un beau dimanche après-midi, avec un meeting socialo-communiste organisé sur la grande place de Villefranche, commune rhodanienne où se situe l’acmé tragique de cette histoire :
La place de la Cathédrale était encore déserte : il y avait simplement des rangées de gardes-mobiles qui s’avançaient vers l’entrée des boulevards ; les officiers commandaient leurs déplacements : sur le terrain pierreux de la place et de l’esplanade qui descendait jusqu’au fleuve, ces gros vers noirs rampaient comme les régiments dans les batailles de la guerre de Sept Ans. (Page 182)
Peu ou prou, nous connaissons tous, par les documentaires télévisés et les ouvrages d’histoire contemporaine, ce que furent les années Trente en France, avec leurs cortèges de grèves et de rixes entre des factions aux lignes idéologiques bien marquées. Mais ce savoir théorique ne nous dit rien sur les sentiments éprouvés par ceux qui allaient risquer leur vie face à des policiers mieux armés qu’eux et qui n’avaient – contrairement à ceux d’aujourd’hui – aucune limite déontologique dans leurs moyens répressifs. Pour les connaître, précisément, il faut lire les romanciers, comme Nizan, qui ont pris pour sujet ces luttes sociales sans lesquelles bien des acquis dont nous jouissons aujourd’hui seraient encore en jachère. Alors on comprend mieux le courage de ces hommes et le sens de leur sacrifice. Car ces batailles de rues ne faisaient pas que des blessés mais aussi des morts, surtout du côté des militants.

C’est ce qui advient ici au personnage de Paul, nerveux ouvrier des Lignes des Postes qui sera tiré comme un lapin avant d‘être achevé à coups de pied par les policiers. Cette nouvelle produira un effet de sidération sur ses camarades :
Mais quelqu’un était mort parmi eux. Tué. L’adversaire reprenait toute sa taille, la colère reprenait sa sève, la haine sa vertu. Le mot mort, le mot tué étaient des mots qui exigeaient soudain un sens charnel, un sens sanglant, un accent familier. Ils lui donnaient d’abord le sens de la fureur. (Page 209)
C’est à l’hôpital voisin qu’ils iront nuitamment identifier son cadavre. Du reste, la mort plane d’un bout à l’autre sur les protagonistes de ce grand roman prolétarien. Et certaines des pages qu’elle inspire à Nizan confinent à l’insoutenable, tellement elles scrutent les sensations qui accompagnent le processus létal. C’est le cas pour la jeune Catherine qui meurt dans son lit d’une hémorragie pendant que Cravois, son époux, assiste au meeting :
C’est l’heure où Catherine fut enlevée par un vertige : elle se sentait basculer en arrière, filer la tête la première au fond d’un abîme d’obscurité, de tourbillons, d’étoiles, elle tombait, et comme elle tombait, pour la première fois depuis son réveil, elle essaya de résister à la mort. Cette résistance exténuée n’avait aucune chance de victoire. (Page 164)
Peut-être est-ce la mort, le véritable cheval de Troie dans la vie incertaine de ces femmes et de ces hommes égarés, bousculés dans un siècle d’airain – qui fut aussi le nôtre. Depuis, d’autres ont repris le flambeau de la révolte contre les injustices et les inégalités ; car l’humanisation de la société – à défaut de changer le monde – est une tâche à poursuivre sans relâche, génération après génération. On aura compris qu’on ne sort pas tout à fait le même de cette lecture, désespéré ou tonifié selon son tempérament.

