(Voir “Recours au Poème” 187, septembre 2018)
Les poètes n’ont pas toujours voulu ignorer la masse des gens ordinaires qui, autour d’eux, quand ce n’était dans leur propre famille, devaient trimer durement pour assurer leur subsistance. Rarement soumis eux-mêmes aux travaux les plus lourds, prêts à tout pour y échapper, ils font leur propre métier en prêtant une voix à ceux qui n’en avaient guère, ou pas du tout (Villon serait, du côté français, un bon exemple). Vies de clercs, d’étudiants, de jongleurs… La longue prédominance du lyrisme a fait que les auteurs italiens ont longtemps paru se tenir à distance de ces motifs, sauf pour ce qui concerne des formes assez convenues de poésie didactique, géorgique ou autre.
Sous l’effacement apparent de la métalepse, la “monstration” de ces inavouables ou irregardables peut n’en acquérir que davantage de force, pour qui sait lire : ainsi, du paysan pauvre qui va piocher sur les pentes des alpes apouanes (Dante), fouissant pour récupérer ce marbre qui leur donne une blancheur étonnante… ou les silhouettes entrevues de Pavese, intellectuel citadin comme sidéré par le spectacle du travail manuel et sa rudesse. Ce qu’il reste de textes populaires (en général chantés) n’est guère plus explicite, mis à part les chants de travail proprement dits, censés mettre de l’entrain sur les chantiers ou dans les champs – il y a là, par exemple, encore quelques traces de ramasseurs de tomates italiens dans le Sud, comme celle-ci : « Monsieur le chef, fais-moi une faveur : / laisse-moi les ramasser, tes tomates ! » etc. (Signure cape, éditions musicales Bella Ciao). Des intellectuels, enfin, ont accompagné le projet culturel d’Adriano Olivetti et de ses revues dans les années 50 et60 du siècle dernier (Sinisgalli, Fortini, Bigiaretti…). Il s’agira donc, sans complaisance, d’aller chercher un peu entre les lignes, ce qui passe et dure jusqu’à nous quand même, en laissant beaucoup deviner du quotidien laborieux d’une majorité pauvre, qui ne parlait pas en général – et lisait encore moins – l’italien, au moins jusqu’au retour des soldats survivants de la première Guerre Mondiale.
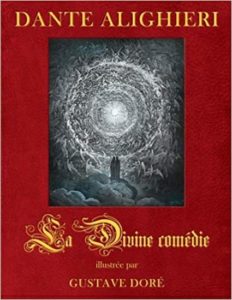
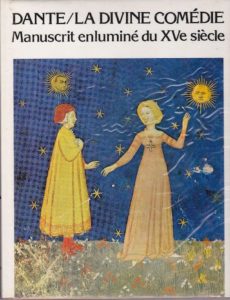
Les travaux et les jours
(et en effet ils sont des hommes… – La Bruyère)
(Dante aussi)
Vois Tirésias, qui changea d’apparence
quand, de mâle qu’il était il devint femme,
en se métamorphosant dans tous ses membres ;
et il fallut d’abord frapper derechef
les deux serpents enlacés, de sa verge,
pour recouvrer le masculin plumage.
Aruns le suit, qui s’adosse à son ventre :
dans les monts de Luni, où le Carrarais
habitant de la plaine monte piocher,
il eut parmi les marbres blancs pour demeure
une grotte ; d’où il pouvait sans obstacle
observer les étoiles et la mer.
Et celle qui recouvre ses mamelles
qu’on ne voit pas, de ses tresses dénouées,
et porte par là tous les poils de sa peau,
fut Manto, qui parcourut beaucoup de terres
et puis s’installa en celle où je naquis.
(La Comédie, Enfer XX, 40–56)
(Au sortir de l’hiver…)
Qu’il porte l’idée, et son labeur ensuite,
vers les prés qui durant le dernier hiver,
ouverts, à l’abandon, furent négligés,
aux troupeaux, aux rôdeurs nourriture et proie.
Qu’il les entoure de fossés, qu’il les ceigne
de piquets et haies, et, s’il le croit propice,
puisse en pierre élever murets et barrages,
tels que le fruste berger, ses goulues bêtes,
mordant et piétinant, ne coupent, n’extraient
la vigueur nouvelle qu’insufflent dans l’herbe
en suave sève et la terre et le ciel.
Puis, de ci, de là, où l’on verrait que manque
la nourrissante humeur, il n’ait de dégoût
avec ses propres mains par le fumier sale
à l’engraisser si bien qu’elle prenne force.
L. Alamanni, Della coltivazione, 1546
(Dédicace au duc de Ferrare)
Brisé le pont de Trajan, l’Isthme enterré,
D’Éphèse le temple, à Rhodes le Soleil
Détruits, Memphis voit la fin de ses merveilles,
Et le temps annule toute autre beauté.
Thèbes aux portes, Ilion aux murs a guerre,
Pleure Athènes son Lycée et les écoles,
Du Cirque à Rome les ruines se désolent,
Et du palais de Cyrus, couvrent la terre.
Ces œuvres ayant péri par fer et vers
Je consacre, Garzon, au grand fils d’Alcide
Ce vestige et cette ombre d’antiquité :
Où en un seul lieu je peins et veux montrer
Arts, études, lettres, armes et valeur,
Au désir desquels l’éternité sourie.
T. Garzoni, La Piazza universale di tutte le professioni del mondo,
Venise, 1588 (voir : http://circe.univ-paris3.fr/Garzoni_r.pdf , p. 12)
Chansons du peuple
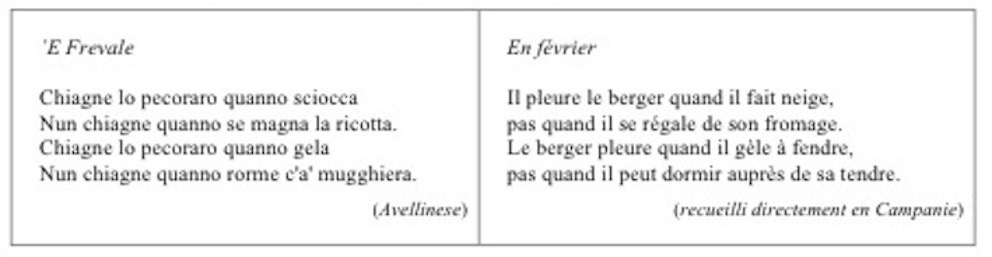
Variante :
Le berger pleure bien sûr quand il neige,
Ne pleure pas quand il mange sa jonchée.
Le berger pleure c’est sûr quand il gèle,
Ne pleure pas quand il dort avec sa belle.
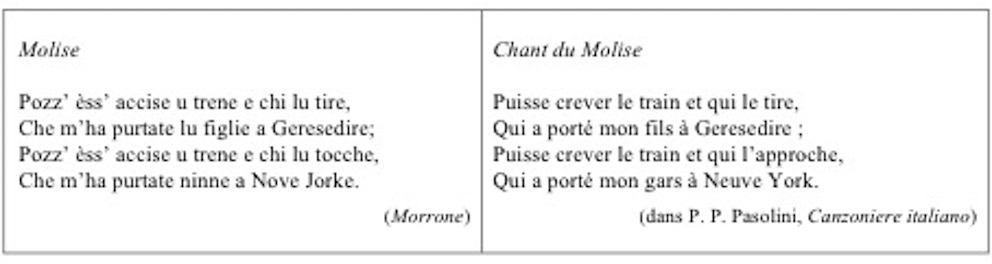

Biancamaria Frabotta
Soir d’octobre
Tu vois le long de la route sur la haie
en grappes rire les vermeilles baies ;
depuis les labours reviennent vers leurs granges
les vaches lentes.
Sur la route s’en vient un pauvre qui, las
fait crisser les feuilles à chaque pas ;
dans les champs une jeune entonne un refrain :
Fleur d’aubépin !…
G. Pascoli, Myricae, 1891
Ces gens y étaient…
Lune tendre et givre sur les champs avant l’aube
assassinent le blé.
Sur le plain désert,
çà et là pourriture (il faut du temps
pour que le soleil et la pluie enterrent les morts),
c’était encore un plaisir de se réveiller et de voir
si le givre les recouvrait aussi. La lune
inondait tout, et quelqu’un pensait au matin,
lorsque l’herbe allait poindre plus verte.
Les paysans qui regardent ont les yeux qui pleurent.
Pour cette année, au retour du soleil, s’il revient,
de petites feuilles brûlées et c’est tout comme blé.
Triste lune – elle ne sait qu’avaler les brouillards,
et par temps clair les givres mordent tel un serpent
qui du vert fait un fumier. Ils en ont donné du fumier
à la terre ; et voilà virer en fumier même le blé,
et regarder ne sert à rien, et tout sera grillé,
pourri. C’est un matin qui ôte toute force
rien qu’à se réveiller et vaquer vivants
le long des champs.
Plus tard ils verront poindre
quelques brins timides de vert sur le plain désert,
sur la tombe du blé, et ils devront lutter
pour en faire aussi du fumier, en y mettant le feu.
Car le soleil et la pluie ne protègent que les mauvaises herbes
et le givre, une fois qu’il a touché le blé, ne revient plus.
C. Pavese, Lavorare stanca [1933], 1943
Nous ne nous baignerons pas…
Nous ne nous baignerons pas sur les plages
c’est faucher que nous irons
et le soleil nous cuira comme la croûte du pain.
Nous avons la nuque dure, la face
de terre nous avons et les bras
de bois sec couleur de briques.
Nous avons des quignons à manger
enfilés dans les manches
des vestes en bandoulière.
Nous dormons sur les aires
attachés aux licous des mulets.
Notre chair ne sent pas
le moustique qui agace
et suce notre sang.
Chacun a les os tordus
et ne rêve pas de monter sur les femmes
qui dorment fraîches dans leurs robes courtes.
R. Scotellaro, Margherite e rosolacci, 1948 (1978) [posthume]
— Cf. http://www.prodel.it/rabatana/wp-content/uploads/2016/01/MARGHERITE- E‑ROSOLACCI-.-pdf.pdf
***
Dans l’usine il y a un saint
avec une barbe blanche ;
il a lui aussi un bleu de travail
et il aide toute la journée
les gens qui sont fatigués.
C’est un saint impeccable
pour ceux qui travaillent aux pièces,
plein de patience et de courage
pour ceux de la chaîne de montage,
la main prompte à se plier
pour ceux de l’atelier,
l’œil toujours vigilant
pour ceux de l’équipement,
aidant vaille que vaille
dans son bleu de travail
ceux de la coulée
à retirer leur pied,
amenant de l’air pur
à ceux de la peinture
supprimant bruit et heurts
à l’atelier moteurs.
Ce bon saint
tant et tant
aide tout le monde
sous les établissements
derrière les grandes portes
où l’on souffre grandement
derrière toutes les vitres
où l’on tient en un mètre
et pas de marche arrière
toujours debout
tous ces horaires
au froid et au brûlant
de l’été.
Travaillez, travaillez
tant et tant
n’arrêtez pas
la chaîne
et le saint semble souffler
travaillez tous et tant
travaillez ;
fatigués ? vous êtes saints !
Sans autels
juste vos postes
tous en rang
tous pareils,
les saints mortels.
Dans l’usine
on prêche :
la prière
le soir
est de sortir
pour bénir
un autre jour ;
après ce four
avec une
bouchée d’air
et une
œillade à la lune.
P. Volponi, Memoriale, 1962
La vie en vers
Mets en vers la vie, transcris
fidèlement, sans taire
aucun détail, l’évidence des vivants.
Mais n’oublie pas que voir n’est pas
savoir, ni pouvoir, plutôt ridicule
vouloir être un autre que toi.
Dans le sous- et le surmonde se nouent
des complicités de viscères, filent des
œillades d’accords. Et les présents se penchent
sur le limbe des rampes intermédiaires :
ils applaudissent, compatissent aux deux sentiments
du sublime – l’infâme, l’illustre.
En outre mets en vers que mourir
est possible à tous plus que naître
et qu’en tout cas l’être est plus que le dire.
G. Giudici, La vita in versi, 1965
Les soins à distance
Qui a des oreilles entende
qui a des oreilles en stand
Dit et répète Jean l’obscur
en égrenant au port ses visions
parmi les cris des frituriers
et les pastèques égorgées.
Moi j’ai des oreilles dans ce stand
j’y suis depuis des années.
Mais quelqu’un y viendra-t-il jamais ?
Une main qui lance un cri ?
Y a‑t-il eu dès l’origine
une faute d’impression ?
G. Ceronetti, Le rose del Cantico (1975)
L’autre jour je l’ai surpris
Romano Mezzacasa est un camarade
mécanicien
extraordinaire.
Il vient des montagnes.
Il travaille le fer et l’acier
avec une ardeur
qui n’a pas d’égale.
Il est dur dur
comme les rochers
de ses Dolomites.
Quand il parle de la première neige
des chevreuils
qui paissent
aux aguets
des printemps
il faut l’entendre
c’est l’amour et le cœur
de l’homme tout entier.
L’autre jour je l’ai surpris
qui construisait
un piège
à rats
il leva la tête
et ne me dit que quelques mots
fermes
il y a tant de rats qui rôdent
Ferruccio
des rats dégoûtants
mais nous les aurons tous
tu verras tu verras
nous les aurons
tous
tous.
Ferruccio Brugnaro, Le stelle chiare di queste notti, 1992
Aux camarades avec lesquels j’ai travaillé
presque toute ma vie
Cette nuit j’ai rêvé de vous tous
splendidement vivants
nous retournions voir
toutes les horreurs de cet atelier en riant
ils n’ont pas réussi à nous tuer
nous sommes encore bien vivants
neufs comme si nous avions ressuscité
non contaminés de la sale mort
Luigi Di Ruscio, in : Poesie operaie (anthologie), 2007
XVII
Quand la nuit est à zéro
et que les cigales explosent parmi les cailloux
Italie maudite c’est l’heure où tu retournes perdue
dans la caverne de ta malédiction numéro un
et sept. Tu n’es en rien antique
et tu as Dante dans ta gibecière.
“Donnez-moi de l’eau !”
“Bâtard, nous ne sommes pas tes domestiques”.
Quand l’homme est un rat pour le rat en duels furibonds
la vie se perd dans le fumier.
Je te trahirai par sept baisers
et la peur des étoiles qui ne filent jamais
œil du diable dans l’espace sans limites
en cette nuit d’un été sans neige.
Silence au malheur et pleure
sur tes mains mangées par les vipères
et alors ?
Les anges trop maigres n’ont pas d’yeux pour voir.
Aucune jeunesse me persécute encore.
Roversi, Trenta miserie d’Italia, 2011
***
Il y eut une fois le temps passé.
Partout vaguant dans les éternels
ultramondes le penser, l’idiot
comme le juste, raidi
dans l’obsédant écheveau du visage.
Chaque chose vécue était ténèbres.
Chaque geste accompli vapeur.
Il y eut une fois le temps futur.
Invoqué à durer latent au sein
d’attendus accomplissements et autres mortels
compliments, plus ou moins incomplet
de vérités relatives, d’erreurs rémanentes.
Nulle importance si chaque chose aimée
était ainsi arbitrairement espérée.
Biancamaria Frabotta, La materia prima, 2017
-et autres quotidiens
[italien de la ville de Rome, romanesco]
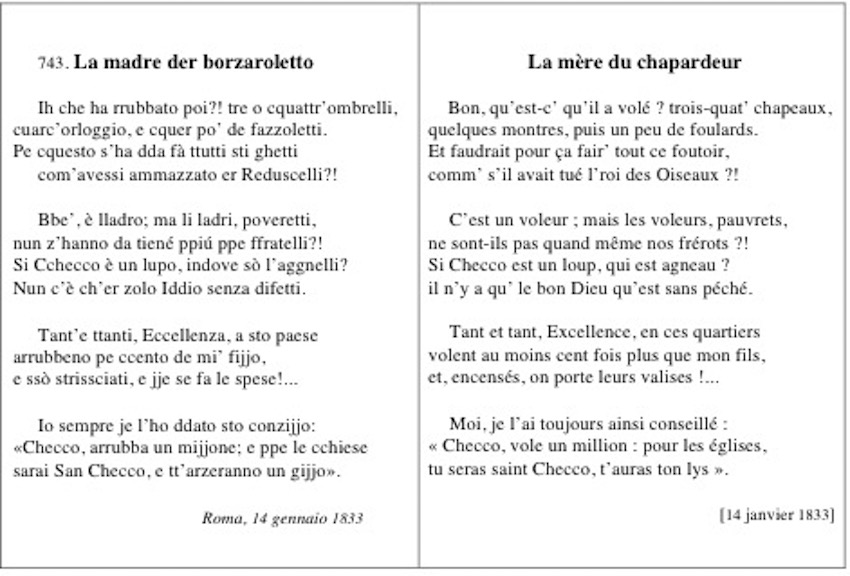
![]() Dans les champs
Dans les champs
Nous un par un
comptons les jours
du blé d’azur
qui se tient droit :
dans l’enfantin
champ le murmure
sans un épi
craint : et s’en va
par le ciel vague
ment tintillant
pleine alouette
de son amour :
nous un par un
comptons les jours,
peines, et dur
espoir qui sait.
C. Betocchi, Poesie (Prime), 1955
***
Et c’est tout
pour l’heure
en ce moment
c’est comme si
nous étions déjà
alors que nous sommes
à peine
et ce qui est
plus étrange c’est
qu’on ne se
l’imagine pas bien
où pourrait être
arrivée
la longue traversée
N. Balestrini, Ipocalisse, 1983
(Dialecte vicentin)
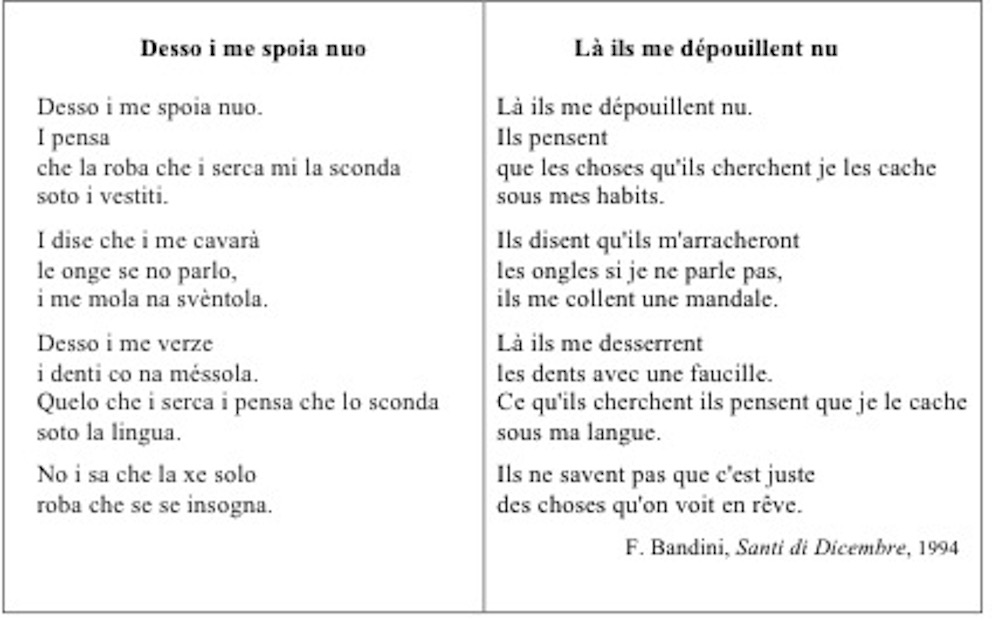
(Et le travail du mot)
La parole vide
ne dit pas le vide, ne nomme pas le néant -
elle résonne
creuse et vaine comme l’enveloppe
des cigales aux souffles
de l’automne, tremble
comme la neige sur le bronze
des cloches immobiles, pleure sans bruit
comme le marbre des cimetières dont le temps
a fait un seul blanc désert
Que du vide ma
parole ait la plénitude
qu’elle brûle au feu noir
du non sens ——
qu’elle ait l’aveugle
force inépuisable de la faiblesse
(Matteo Veronesi,Tempus tacendi, 2017)
- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021
- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020
- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020
- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020
- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019
- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019
- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019
- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019
- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019
- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019
- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018
- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018
- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018
- Amont dévers 8 - 3 juin 2018
- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018
- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017
- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017
- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016
- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014
- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013
- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013
- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012
















