Amont dévers
Treizième livraison
(Voir« Recours au Poème » 194, avril 2019)
Et puis, au bout du bout, il reste le chant. Ténu, léger comme cet air insaisissable que Leopardi disait envier dans la poésie d’Anacréon, tel « un souffle passager de brise fraîche en été, odorant et délassant », mais hélas vite dissipé, échappant à l’analyse voire décevant sa relecture (Zibaldone).
C’est la musique sans notes de certaines ivresses de mots presque gratuites des Baroques, tournant sur eux-mêmes tels des horloges (encore alors épatantes). C’est, à un point exquis d’harmonie rarement atteint, en dépit parfois de son manque d’insouciance devenu trop habituel, le résultat du tout dernier Pascoli (une fois acquises ses traductions des strophes sapphiques d’Horace), éloigné du “nid”où il avait trouvé un semblant de paix avec sa sœur Maria, désorienté par la grande ville (Bologne), frustré dans ses autres amours, au bord du silence. C’est le jeu, bien loin d’être innocent, avec le langage – et son idéologie – chez tel Novissimo… heureusement plus ironique que chez nos avant-gardes françaises ou parisiennes.

Mais déjà Le Tasse prisonnier, demandant à ce qu’on le contienne, à ce qu’on le protège, à ce qu’au besoin on le punisse, s’abandonnait terriblement seul à la musique intérieure de son obsession dominante, purement poétique – ou à ses démons familiers. C’est parce qu’elle est fictio, et musica à la fois (Dante), surtout harmonie qui n’en finit “jamais”, comme dans la sublime invention de sphères supérieures bienveillantes, que la poésie nous soutient et semble nous protéger jusqu’à la fin. En deçà (ou au delà) des terreurs et des espérances de quelque au-delà rêvé comme ultime horizon. Et ce sera aussi, pour nous, une façon de saluer une dernière fois (La Treizième revient… – on l’a déjà dit) le versant caché, dans l’ombre éblouissante, vers lequel dévale paradoxalement l’un de nos amonts.
− Les oreilles et la vue
(Ballade du regard)
Quitter le voile par soleil ou par ombre,
Dame, je ne vous vis,
après qu’en moi avez su le grand désir
qui chasse tout autre vouloir de mon cœur.
Portant en moi mes belles pensées celées
qui ont rendu mort mon esprit désirant,
j’ai vu de pitié s’orner votre visage ;
mais, quand Amour vous fit attentive à moi,
vos blonds cheveux aussitôt furent voilés,
et le regard charmeur en soi recueilli.
Ce que je désirais le plus, m’est ravi ;
le voile ainsi me traite,
qu’à causer ma mort et au chaud et au froid
de vos beaux yeux il ombrage la lueur.
F. Petrarca, R. V. F.xi
(Madrigal à Dame Laure)
Sur la verte toison
de ce laurier nouveau, oyez comment
des oiselets chanteurs
certains vont plaisantant de branche en branche,
disant — Je t’aime, t’aime — ;
et il semble répondre
par le murmure doux
de ses feuilles tremblantes -
Oui, je vous aime aussi — ;
et d’autres, plus coquets,
chantent, — Ici, ici -,
comme s’ils voulaient dire — En ces rivages
autour de ces feuillages
les nymphes te désirent.
T. Tasso, Rime amorose, 1581
(Petite ballade pour boire)
Brises sereines, claires,
respirent doucement,
et l’aube à l’Orient
riche de lys et violettes s’affaire ;
sur la rive discrète
le long du ruisseau aux bords luxuriants,
Phyllis, à boire invite
la pourpre vive de fraise odorante ;
de mes tasses très chères
donne la préférée,
celle où l’on voir flécher
Amour sur un dauphin les Dieux des mers.
G. Chiabrera, Poesie, 1606
(Une île de sons)
Que cithare et crotale avec l’orgue
sur les bords des pâtures odorantes,
que cymbales et flûtes s’unissent
aux pipeaux, au tambourin et au fifre ;
et qu’ils apportent fête et joie à celle
qu’on nomme Vesper ou Lucifer,
emplissant de musique crépitante
cette île en ses transes résonnante.
G.B. Marino, AdoneVII (1623)
— déjà paru dans “Recherches romanes et comparées”, 4, mars 1999
(Théorbe à sabot)
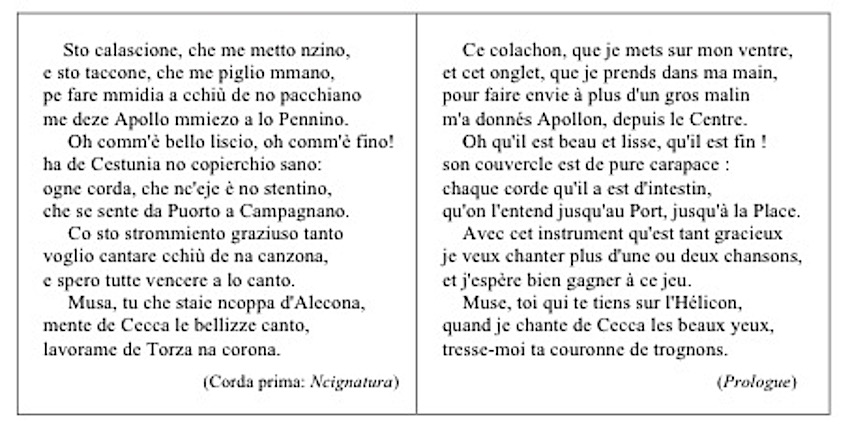
Felippo Sgruttendio de Scafato, La tiorba a taccone(1646)
[…]
Et j’arrivai à une source qui, seule,
geignait sous un grand chêne, en une sonore
conque de ponce rugueuse, qui le pleur
déjà pleuré pressait de grappes de gouttes
neuves, dans leur chute, et en tirait un chant
doux, infini. Je m’assis dans l’ombre fraîche.
Là, je ne sais comment, un dieu me vainquit :
je pris ma cithare d’ivoire et, rival
du flot sacré, longtemps en pinçai les cordes.
Ainsi éclata, dans le midi tremblant,
le son modulé d’une joute aérienne :
et grand était l’étonnement des yeuses,
car grand et clair était, entre la cithare
aiguë, le concours, et les eaux mélodieuses.
Toute voix de la source, tout tintement,
la creuse cithare en répétait l’écho ;
et pouvait croire en son cœur à deux fontaines
le berger qui non loin de là faisait paître.
Mais lent, à la fin, je fixai sur le joug
d’or mes yeux charmés, et sur les cordes mues
comme par un souffle court ; et les fermai,
vaincu ; et j’entendis comme un bruissement
de mille cithares qui pleuvait dans l’ombre ;
et j’entendis, comme s’éloignant en lui,
la merveille d’histoires dédaléennes,
telles de blanches longues routes en fuite
à l’ombre d’ormes et de peupliers frêles.
G. Pascoli, Il ciecodi Chio[1897] (Poemi Conviviali,1904)
Piano, la nuit
Un piano, la nuit,
joue dans le lointain ;
sa mélodie vient
au vent soupirer.
Une heure : tout dort
sur cette berceuse,
qu’on connaît encore
après tant d’années.
Au ciel, que d’étoiles !
La lune… Et l’air tendre !
Qu’on voudrait entendre
joliment chanter !
Mais seul, peu à peu
meurt le refrain su ;
plus sombre est la rue
dans l’obscurité.
Plus rien que mon âme
reste à la fenêtre.
Elle attend… peut-être
en rêve, à penser.
S. Di Giacomo, Ariette e sunette (1898)
Historiette
Le chien,
blanc sur la blanche grève,
poursuit sans trêve
une ombre,
la noire
ombre d’un papillon,
qui sur lui, blond
virevolte.
Inconscient
du danger, il le nargue
en volant autour de lui
dirait-on.
Inconscient
il vient (ou rusé) sur son dos.
Lui de là aussitôt
le secoue,
et se retourne
vorace vers l’ombre vaine,
qui s’éloigne
de la grève,
et dessus
une fleur, à son habitude,
referme la lumière
de ses ailes.
Sachez,
amis très chers,
que dans mes jours
de bonheur,
ces jours
où mon cœur (aride à présent)
était rené
à l’amour,
moi aussi
avec une proie plus extraordinaire
j’eus une histoire
similaire.
Et elle était
belle ! La dernière chose
qui en moi de rose
se teignit.
Et moi,
moi je lui laissai sa vie ;
je n’en ai saisi
qu’une ombre.
Je savais
– douceur sans liesse –
que c’était sagesse
humaine.
U. Saba, Cuor morituro, 1926
Naître au chant
Croire à l’innocence du monde.
Ainsi la voile pour le haut chanter.
Où elle ne peut pas être
l’inventer.
J’essuie sur ma joue
comme un sillon de pleur.
L. Calogero,Poco suono(1933–35)
* * *
Je voudrais nager dans le bouillon de poule,
je voudrais avoir un chapeau à fleurs
et un châle, un masque blanc.
Je voudrais avoir le pas léger,
danser moi aussi avec les mecs du faubourg.
Je voudrais inviter les vieilles à la fenêtre,
chanter et rire parmi les visages ridés
et rougis que je vois dans les vitres
peints par la veine violente,
par la main de l’artiste qui chante,
opaque et puissant, la terre.
Je voudrais porter un bonnet
à grelots…
Maurizio Cucchi, Malaspina,2013
Bagatelles
Trois mouches avec deux moustiques
Sur un arbre chargé de poires
Parlent sans se lancer de piques,
Ce qui est chose plutôt rare.
Le tournesol n’est pas content
Quand il pense à son infortune
Surtout si désespérément
Il rêve à un rayon de lune.
L’écrevisse mélancolique
Cependant que tombe le soir
Écoute la philharmonique
Jouer là-bas près du lavoir…
Une raie manta plus rapide
De conserve avec un dauphin
Dit à mi-voix mais intrépide
« Profil absolument divin ! »
Riccardo Held, Bagatelle,RIEF,2017
− Et l’harmonie ultime des sphères
(Le chant des justes)
…
Ô doux amour, que ton sourire enveloppe,
combien tu semblais ardent en ces flûtiaux
qui n’avaient souffle que de saints pensers !
Après que les chères brillantes gemmes
dont je voyais serti le sixième feu
eurent suspendu leurs aigus angéliques,
ouïr me parut le murmure d’un fleuve
dont l’eau limpide descend de pierre en pierre,
par l’abondance de ses hautes veines.
Et comme un son au col de la cithare
reçoit sa forme, et comme un vent au pertuis
du chalumeau dans lequel pénètre l’air,
ainsi – sans laisser de retard à l’attente –
sembla monter ce murmure par le col
de l’aigle, comme s’il eût été creux.
Là se forma une voix, qui sortit
par le rostre ensuite en forme de paroles
qu’attendait mon cœur, où le les écrivis.
Dante Alighieri, La Comédie (Paradis)XX,13–30.
[au ciel de Jupiter, le sixième “feu”]
(Un adieu)
Vante-toi, tu le peux. Raconte que seule
tu es de ton sexe à qui j’ai dû plier
ma tête fière, à qui j’offris simplement
mon cœur indompté. Raconte que tu vis
la première, et j’espère unique, mes yeux
qui suppliaient, moi si timide devant
toi, plein de crainte (je brûle si j’y pense
et m’indigne, et rougis) : moi privé de moi,
à guetter humblement chaque envie, chaque acte,
chaque mot tiens, à pâlir aux impatiences
superbes, m’illuminer au moindre signe
courtois, changer à chaque regard de mine
et de couleur. L’enchantement est rompu,
et avec lui brisé, à terre gisant,
ce joug ; je m’en félicite. Et, bien que pleines
d’ennui, après le servage enfin, après
une longue errance, j’embrasse content
sagesse et liberté. Car si de passions
est veuve ma vie, et de nobles erreurs,
comme une nuit sans étoile en plein hiver,
me sont suffisants réconfort et revanche
du sort des mortels dès lors qu’ici sur l’herbe
immobile étendu, oisif, je regarde
la mer, la terre et le ciel, et je souris.
Leopardi, explicit deAspasia(Chants)
* * *
Que font là, près de la terrasse veuve,
les chrysanthèmes, nos fleurs, que font-ils ?
Oh ! ils sont là, avec leur beauté vaine,
tenant la tête baissée, pleurent-ils ?
Ils pensent que cette année tu es loin,
pleurant car tu n’y es pas, pour de bon.
La cloche murmure : Ne revient point !
Mais les mésanges : Si, ils reviendront !
G. Pascoli, Diario autunnale,1907
Petit chant sans paroles
À un ramier le soleil
Céda sa lumière…
En roucoulant viendra,
Si tu dors, dans ton rêve…
Un soleil viendra,
En secret brûlera…
Il sera seigneur
D’une vaste mer
À ton premier soupir…
Fluctue seul chant
Sur la mer fluente
Ouverte à ton rêve…
*
À un ramier le soleil
Céda sa lumière…
En roucoulant viendra,
Si tu dors, en songe…
Étendit le grand flot,
Défia la mesure…
Tu hésitas, le vol
Perdit en toi,
Par écho se chercha…
L’ire dans cet appel
Abîma ton cœur,
La lumière au soleil retourne…
G. Ungaretti, “Officina” 11 (1957)
* * *
Le temps nous emmène, et le ciel est seul
même de ces hirondelles qui volent,
dangereusement croisant des trajectoires
comme qui cherche longtemps dans sa mémoire
quelque nom perdu… et le retrouver
n’a plus d’importance, car c’est le soir.
Bien sûr, on vieillit, et nous revient plus vraie
la vie déjà vécue, rongée par un ver…
un ver qui la nettoie. Et vient le soir.
Et les pensées se croisent, et les vols.
Et nous ne sommes plus nous, mais les profonds
ciels de l’existence – ah, combien entière, elle
et très profonde, sombre, en son bleu-noir.
Carlo Betocchi, L’estate di S. Martino,1961
Dans le chant
3.
Aimée, je veux qu’ils nous écoutent,
qu’ils entendent le gargouillis que je ne retiens pas,
comment se forme le chant
comment il se calme dans la poitrine
comment il peut sectionner la gorge,
comment la langue s’est esquivée.
28.12.1987
Antonio Porta, Yellow(posthume ; publié sur :
http://circe.univ-paris3.fr/A.Porta_Yellow.pdf
Sonnet astral
pulsent les pulsars en de fortes pulsions :
c’est à vous quasars, astres quasi-vivants :
s’écroulent assez denses, par des pressions
qui pour toujours s’abîment, en noirs rivages :
peut-être est-ce ainsi : torches en évection,
essaims de vos nébuleuses fugitives,
super-géantes, traînes en libration,
céphéides variables qui récidivent :
protubérances, et jets, et radiations
corpusculaires, éclipses inclusives
de pleines planètines et planètons,
aurores surcompressées en hautes cages :
oh, lumineuses nuits gravitationnelles,
mes fragiles zodiacales étincelles !
E. Sanguineti, Varie ed eventuali,2010
Cedrus atlantica
Devis pour abattage
avec échelle chenillée
heureusement tu n’assisteras pas
il était comme tien depuis le milieu du XXèmesiècle
cet arbre, ses bras en forme d’aiguilles
entraient par ton balcon presque
chez toi, sans parler du funeste
jour où ils t’ont retenue,
ont empêché le saut désespéré.
Mais désormais fantôme le saut, fantôme
le motif du saut et son origine,
fantôme la nouvelle, fantôme qui avait dû
te la donner, fantôme qui te consola,
fantôme qui t’appela le premier
veuve, fantôme lui le très jeune
conjoint parmi les plus blonds et beaux
en promenade dans le règne des cieux, fantômes
les cieux, fantôme tout, chaque incident,
chaque souvenir de souvenir d’incident,
chaque poème d’incident ?
Vivian Lamarque, Madre d’inverno,2016
− “… l’amour qui meut le soleil et les étoiles”
(À Gennarino)
Écoute… si tu vois
Gennaroce bourrin,
dis-lui : bel assassin !
Non, ne le lui dis pas !
Dis-lui… Oui, dis-lui donc
Qu’il est moche ! Et taré !
Qu’il l’a toujours été !…
Non, attends… Lui dis rien…
Et si tu disais : “Rose
voudrait vider sa haine,
bien qu’au fond elle-même
ne sait si ell’ pourra…”?
Non… Dis-lui que je pleure !
Dis-lui : elle est brûlante !
Dis-lui : elle est mourante !
Et ramène-le-moi…
S. Di Giacomo, Ariette nove, 1916
Deux jeunes
Dans une auto déglinguée
aux limites d’un champ,
– une auto en démolition –
dans cette auto abandonnée
deux jeunes, assis
discutent sans interruption
La fille est mignonne
les cheveux courts et noirs,
le garçon a un visage de fouine
maligne et drôle ;
ils s’abritent des gens ;
lui la serre fort
et ils parlent vite vite à voix basse
C’est bon d’écouter
comme ça la vie qui glisse,
la vie glisser doucement comme un serpent qui s’ennuie ;
se donner dix baisers par minute sans crainte ;
parler d’aujourd’hui, parler d’amour, parler de demain,
se toucher avec les mains
La vie est tellement proche
tout est encore à faire
le futur est vert, il est froid, il est profond comme la mer
ils essaient de le toucher avec les pieds
avant de se décider à plonger
« Tu es une petite souris blanche
moi, moi, moi
moi je t’ai transformée en ange
avec des ailes formidables
Tu lavais repassais les chemises
et moi assis dans un coin je fumais
Regarde-moi encore avec amour,
je sais que je suis vieux,
je sais que j’ai déjà vingt ans »
« Mais – elle répond – je t’épouserais quand même
moi, moi, moi
même si je t’ai toujours dit :
je veux aller au lit avec un homme
mais je ne sais comment faire
Tu me disais : pourquoi tu ne me prends pas moi ?
C’était un jeu
moi, moi, moi
je le sais que c’était un jeu
et je ne sais quoi faire
parce que là je ne veux plus
que rester ici à te regarder et écouter »
D’en haut pleut une neige verte
portée par les ombres du soir ;
tout à coup trois étoiles explosent
énormes comme un grand réflecteur
au-dessus de l’auto déglinguée
aux limites d’un champ
dans une auto en démolition
où deux jeunes hors du temps
font l’amour
R. Roversi, Il futuro dell’automobile. Dodici
testi per Lucio Dalla,1976
- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021
- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020
- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020
- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020
- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019
- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019
- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019
- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019
- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019
- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019
- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018
- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018
- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018
- Amont dévers 8 - 3 juin 2018
- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018
- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017
- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017
- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016
- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014
- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013
- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013
- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012
















