Angèle Paoli & Stephan Causse Rendez-vous à l’arbre bruyère, Stefanu Cesari, Bartolomeo in Cristu
Ce sont deux "divagations" que je propose ici : parcours singuliers d'une lectrice happée par ces livres, tous deux déployant leur frondaison de mots autour des lieux où croissent la bruyère arborescente et l'amandier en fleurs - deux rendez-vous marqués par le recours à un arbre que je vois comme un axe du monde et de la mémoire, enraciné en Corse.
Angèle Paoli & Stephan Causse : Rendez-vous à l'arbre bruyère
Rendez-vous à l'arbre bruyère : le titre de ce livre - mot de passe et talisman – je le saisis, avide, comme enfant l'on s'empressait de saisir le « furet » de la ronde, fuyant et désiré : Il est passé par ici, il repassera par là - qui l'a ?
L'arbre bruyère – bruit/hier : c'était sur une sente, un maquis odorant. Et l'arbre se dressait, fantôme vrombissant de milliers d'abeilles agitant les clochettes de l'erica odorante. C'était un autre, et c'est pourtant le même, qui se dresse ici, flamme à la croisée des chemins – buisson ardent de « son odeur (qui) fait courir un frisson/toi qui cherches refuge/dans l' exil et les larmes/embrasse ce buisson/sans révélation »
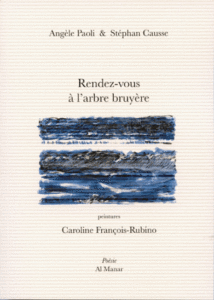
Rendez-vous à l’arbre bruyère, Angèle Paoli, Stéphan Causse,
peintures Caroline François-Rubino,
Al Manar, Poésie, 78 p. 16 euros.
Promeneuse en mémoire, promeneuse-lectrice, tous les sens en éveil, à mon tour je m'engage dans le maquis des mots, tandis que résonnent, dans ma mémoire, ces vers d'Apollinaire :
J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends ((Alcools))
Ils me reviennent sans doute, comme une ritournelle à la vue de ce titre, parce que ce rendez-vous sans destinataire, sous les auspices de la bruyère blanche qui m'avait tant impressionnée, est un embrayeur d'imaginaire, et ne peut que faire écho à d’autres souvenirs, d'autres lectures et d'autres mots encore. Pas un Adieu, ici, mais un vrai « rendez-vous » - syntagme à prendre dans le sens impératif aussi de son étymologie : parcours auquel vous presse l'intimation - vers quelle rencontre ? Quelle découverte ? Quel abandon, au pied même de l’arbre qui s’enracine au cœur de la mémoire, et y puise sa chanson, comme on en fait son miel ?
Commencé sous la coloration novembrine des feux d'automne, alors que « chaque soleil était un soleil d'adieu », habité d'ombres qui passent, l'échange épistolaire qui nous est offert s'étire jusqu'au printemps, dans un avril résonnant du « vaste bleu » - « Je me souviens d' une autre année/c'était l'aube d'un jour d'avril » chantait encore le Mal-aimé dont la voix ne me quitte pas – et ces vers, comme un viatique, me remontent à la gorge tandis que je li(e)s ce rendez-vous des souvenirs ramenés, tressés, au fil des plumes croisées d’Angèle Paoli et Stéphan Causse, dans la psalmodie en répons dont on nous dit que l’un commence le recueil tandis que l’autre le clôt, mais dont bien habile serait le lecteur qui pourrait savoir qui écrit dans le tissage des voix convoquées à l’ombre de cet arbre tutélaire.
Qui écrit ? sinon les souvenirs mêmes qui se remémorent dans l’échange. Et c’est en cela un livre remarquable, tant l’osmose des écritures – scrutées pour y déceler une identité - crée le corps d’un livre habité par La Mémoire – l'unique - celle des rêves, des mythes, des paysages et du temps, celle du corps de la poésie, incarné dans d'autres vers aussi, jadis - et ici bruissants, murmurante méditation à deux voix dont la sensualité de vagues vous enveloppe, et vous emporte, comme la marée des songes.
Vagues - comme le ressac, comme le flou dans lequel vous bercent ces imprécises évocations. Vague comme l'échange de ces plis sans doute virtuels, ainsi qu'il en est de nos jours, avec des mots qui s'inscrivent sur un écran de lumière puis disparaissent - fugaces évocations qui ne sont pas à proprement parler un dialogue, mais un enchaînement où les mots s'appellent, parfois se répondent ou se reprennent, créant ce tissu d'analogies et d'images qui se superposent avec de légers décalages, un sfumato de mots portant l'imaginaire du lecteur vers des horizons aussi larges que celui de la mer , sans cesse évoquée : « La mer n'est jamais loin ».
Vague – c'est aussi, incisif, le porteur de ce « V » frappant de sa forme et de sa sonorité l'ensemble du livre, clos du signe double de LE VIGAN/VIGNALE – Six syllabes repliant en anagramme le double lieu d'émission de ce rendez-vous sans destin : noms en reflet comme une ultime anamorphose, reprenant celle du rocher devenant Alaska à la dérive (p.36) à laquelle répondent des chênes évidés parlant de Totem Pole (p.37)...
V, comme l'échancrure d'une inguérissable blessure – la blessure de vivre sans doute, portée par toutes les allitérations qui s'envolent des mots avec le bruit des ailes en déchirant l'azur : traversée – rêve – vif – étrave, vent, vert, vaste - dérive … vers ces entailles/entrailles d'où les mots nous appellent :
les mots nous hèlent
hors
(de) nos sentes ordinaires
(de) nos foyers d'insurrection
ensevelis sous la cendrel'obscur nous rapatrie
aux entaillesdit l'une des voix.
Davantage que le bleu, mis en valeur par les belles encres de Caroline François-Rubino – bleu de la mer et du vent, et cette paisible source-voix qui « sonne bleu/et plonge ses doigts/dans le mutisme des ronces », c'est la couleur et le goût de la cendre qui me restent de cette flânerie vagabonde à l'entour l'arbre aux souvenirs : « grappes d'un blanc/cendré /les bruyères en fleurs » (p.44), sur « l'île blanche » passée au brou de noix, sous « la pluie frissonnante de cendre » - mais aussi (mais surtout ? ) manques de la mémoire qui se disent dans les blancs semés sur la page imprimée, fantômes des cailloux du Petit Poucet qui saurait qu'il faut « semer des blancs/pour que surgisse/la larme claire// »
Semer des blancs, pour permettre au lecteur d'inscrire ses propres images, ses propres émotions, au fil de ses lectures – car dans les blancs, on repasse, on lit au contraire du devenir sagital, et si « la mort traverse », les mots sont là pour nous sauver du temps. Tout beau livre est ainsi « une chambre d'échos » où s'entrechoquent les mots et les souvenirs, remontés de l'enfance comme d'un « coffret de pirate » - à jamais présents.
Mémoire sans jadis, chante l'une des voix... Sans jadis, parce qu'au pied de l'arbre désiré affluent tous les souvenirs, « comme une relecture/d'une littérature oubliée ».
Est-il alors meilleur hommage et lecture plus fidèle à ce livre que celle qui ajoute ses propres échos à ceux des mots ayant vibré en sa mémoire, et qui résonnent ainsi encore, vers d'autres lecteurs, les invitant à leur tour :
Rendez-vous à l'arbre bruyère, qui est le vôtre.
*
Stefanu Cesari, Bartolomeo in Cristu
N’avoir pas recensé auparavant ce très beau livre me permet d’annoncer qu’il a reçu le prix Louis Guillaume du poème en prose 2019 – et de démontrer que c’est une attribution amplement méritée.
C’est d’abord un bel objet comme je les aime : la dimension du livre qui ne dépasse pas la paume de ma main et le satiné de sa couverture le rendent agréable à tenir : on ne parle jamais assez de la dimension esthétique du toucher des livres dans les recensions qu’on en fait. La bipartition qui s’y dessine – un grand espace ivoire sur lequel se détachent en fin caractères alternés - noirs et d’un rouge - brique ? sang séché ? - bordé au pied d’une frise crantée, du même rouge sombre … Voici mise en place l’organisation interne et le code typographique, dépouillé et raffiné, qui commande l’intérieur du livre tout au long duquel court la même frise.

Stefanu Cesari, Bartolomeo in cristu, poèmes,
aux éditions éoliennes, 128 p. 16 , 50 euros. 2018
Ouvert, il présente en page paire le texte rouge sang en corse et, page impaire, le texte que je lis, en noir sur le même fond ivoire. Et, surprise : dans la frise crantée, un autre texte, tête-bêche, dont il faut chercher le début tout à la fin, sur la page triplement numérotée : 123, indicateur du nombre de pages du livre – mais inscrit à l’envers, sous l’arc cranté de la frise - et 59 ou 60 : les pages du texte en français sont aussi numérotées. Je ne suis pas une experte en numérologie, et je ne tenterais pas de démontrer que ces chiffres ont un sens caché, si je n’avais retrouvé, au fil du texte renversé, une notation en caractères gras… je suis sensible au fait que l’éditeur, Xavier Dandoy de Casabianca, ait ainsi pensé la mise en scène de ce livre, un peu comme les étapes d’un parcours sacré, le long des stations de la Passion, le long des labyrinthes dessinés sur le sol des églises… dans un petit livre qui ressemble à celui décrit ici « un petit monde fermé ouvert entre les pages, rouge comme un évangile, une histoire dans l’histoire il y a cinquante-neuf grains plus 1. » (l’importance des chiffres pour ce recueil se lit peut-être aussi dans l’indication des coordonnées du lieu qui a inspiré l’auteur (pp. 117-116) – je laisse au lecteur le plaisir de résoudre l’énigme).
C’est bien de labyrinthe que parle le texte à lire dans la frise, en lettres ivoire comme si on les avait incises dans la matière rouge (semblable à celle de la sinopia tracée sous une fresque), qui semble superposée au texte dès la couverture. Ces deux lignes de texte nous invitent à « remonter le cours du récit » car « c’est pénétrer dans le labyrinthe. Le rouge du réel a pris place celui du ciel et celui du sang. notre regard, notre propre temps dans lequel il faut s’immerger la tête penchée (...) »
Que nous raconte donc ce livre dans les « pavés » de textes (briques d’une construction) qui sont de brefs et très beaux poèmes en prose ? Je rebrousse le chemin, ainsi que m’y invite le texte renversé, qui me parle du visage d’un saint, comme un idéogramme. Bartolomeo/Barthélemy : le martyre dont l’attribut est sa peau écorchée (comme le ruban couleur de cinabre du livre, incisé par les lettres) et qu’on connaît surtout pour sa représentation dans la chapelle Sixtine : Michel-Ange s’y représente dans la dépouille brandie… Le saint du titre faut partie d’une fresque de la toute petite chapelle romane de Gavignano, dédiée à San Pantaleon, que je n’ai pu visiter, lors de mon passage, car elle était fermée. Une reproduction en est donnée, dans les teintes brunes du livre – et j’ai consulté, bien sûr, la recherche Google, pour en trouver l’original((https://corse-romane.eu/gavignano-pantaleone-y/)) . A l’extrême gauche, le tout dernier de la procession des apôtres, commentée par un saint muni d’une Bible (dont l’exipit m’amène à me demander si le poète ne s’y est pas projeté((« il est comme toi lisant le livre, tout ce vivant lui voile le regard, plus vague dans notre souvenir, presque déjà parti »)), Bartolomeo se tient comme les autres, la main droite sur le cœur en signe de dévotion : il porte sa peau jetée sur son épaule comme la dépouille du lion sur l’épaule d’Herakles, la tête comme une besace, à l’envers, pâle sur son corps nu, écorché – représenté de ce brun rougeâtre choisi par l’éditeur pour le livre. Pauvre saint, nu – dépouillé et de nouveau comme à la naissance, à l’origine : « l’enfant absolu » - « in cristu »((peut-être cette expression corse est-elle à mettre en lien avec ce passage de la Bible (Galates 3:27-28) « vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »)) .
Cette figure étrange qui retient l’auteur est la « source » d’un texte qui remonte aux sources de sa création : sous la tutelle d’un arbre double, vivant et mort, le poète suscite un pays où « tout se dresse comme un signe âpre, un pourquoi qui n’est pas une question ». Le fil du texte interroge d’abord la pierre – et l’interroge comme on la touche, avec les mots, de même que la soupèse le berger-maçon, pour juger l’usage qu’il en fera dans la construction, avec l’attention des gens simples « pour des formes vagues, pour la beauté ». Une beauté qui n’est pas celle artificielle à laquelle nous habitue notre culture, mais la beauté essentielle liée aux gestes du quotidien, dans lequel tout aussi est sacré, dans un même mouvement de vie : du sable de la rivière, à la chaux qui prépare la fresque, se prépare l’autre geste, celui qui donnera corps à « une pensée à peine saisie, quelques éclats de lumière qui ont troublé ta vue ».
Stefanu Cesari engage un dialogue avec le peintre qu’il imagine, et qui « sait sans savoir » - créant l’image du sacré qu’il porte en lui, et qui le reflète dans cette figure pauvre et nue du saint au visage surpris. Je ne peux résister au désir de citer plus longuement cet éloge du travailleur vagabond, anonyme, modeste – pas un « artiste » - pas même un artisan – un homme qui travaille et qui répond à l’appel de ce qui le dépasse((je pense ici au très beau texte de Jean Giono, Le Déserteur, consacré à Charles-Frédéric Brun, peintre d’ex-voto au Valais.))
Tu as un nom et puis un autre, dans une langue et dans une autre, tu voyages loin tu t’amenuises, à mesure des récits qui sont contradictoires mais comme ton père tu es berger, dans ta jeunesse tu cherchais les bêtes qui s’égarent (…) L’écriture menue qu’elle laisse après elle, tu peux lire à l’envers tout ce qu’il te faut savoir. On dira ton nom confondu à d’autres, se perdra le lieu où tu naquis (…).
La force de ce texte est de nous présenter avec un très grande économie de moyen stylistiques et lexicaux, à travers une lecture scrupuleuse de la fresque, et une « reconstitution » à la fois de sa création et de la vie de Bartolomeo, ce parcours emblématique du martyr, superposé à celui du peintre, dans une révélation qu’on imagine, au cœur du silence de cette chapelle, amenant l’auteur à apporter ses mots à ce qui n’a pas de langue – ses mots et ses souvenirs/sensations de l’enfance, dans un parcours « à rebours » - et une méditation sur la vie, le devenir des êtres et des souvenirs, la violence, la cruauté d’un monde où l’on torture , on abat et dépèce pour la vie ou la fête où
l’on entendait de loin certains hommes qui rient et l’odeur de la viande, tout le monde est rassemblé autour des bêtes accrochées ouvertes comme des livres on mange on racle on ôte la peau parfois on lit dans le sang qui goutte ce présent des corps appelants (…)
Ce visage du saint nous concerne, qui nous regarde, à travers les mots du poète qui y voit « un signe laissé de l’univers ou de l’enfance, la bouche ouverte les dents blanches, sur les marches creuses la moitié d’une grenade est posée, à la chair mordue d’un pays quelqu’un s’est arrêté ». Symbolique grenade de Proserpine ou de la Madonne, symbole de la fécondité, de la possible re-naissance, « in cristu », couleur de sang – ce sang dont Stefanu Cesari écrit « Le sang chemine. Nous voyons à travers lui » - symbole de ce « prolongement » évoqué p. 117 de cette longue oraison : « Nous deviendrons d’autres nous-mêmes, ne doute pas de cela. Nous apprenons l’absolu en fréquentant la mort sans savoir ce qui nous permettrait de dire. Sommes-nous comme des enfants ? ». Magique tour de passe-passe de l’écriture, qui fait de ce saint martyr, écorché, pauvre et nu, l’emblème de la vie qui circule, amenant à accepter les fleurs de l’amandier comme la pourriture, entre l’arbre vivant et l’arbre mort – « trà un àrburi vivu unu mortu ».