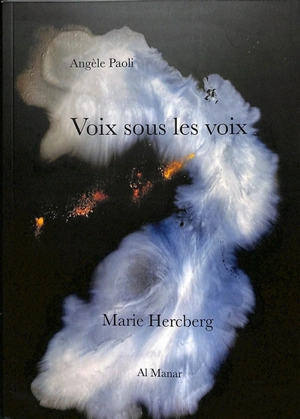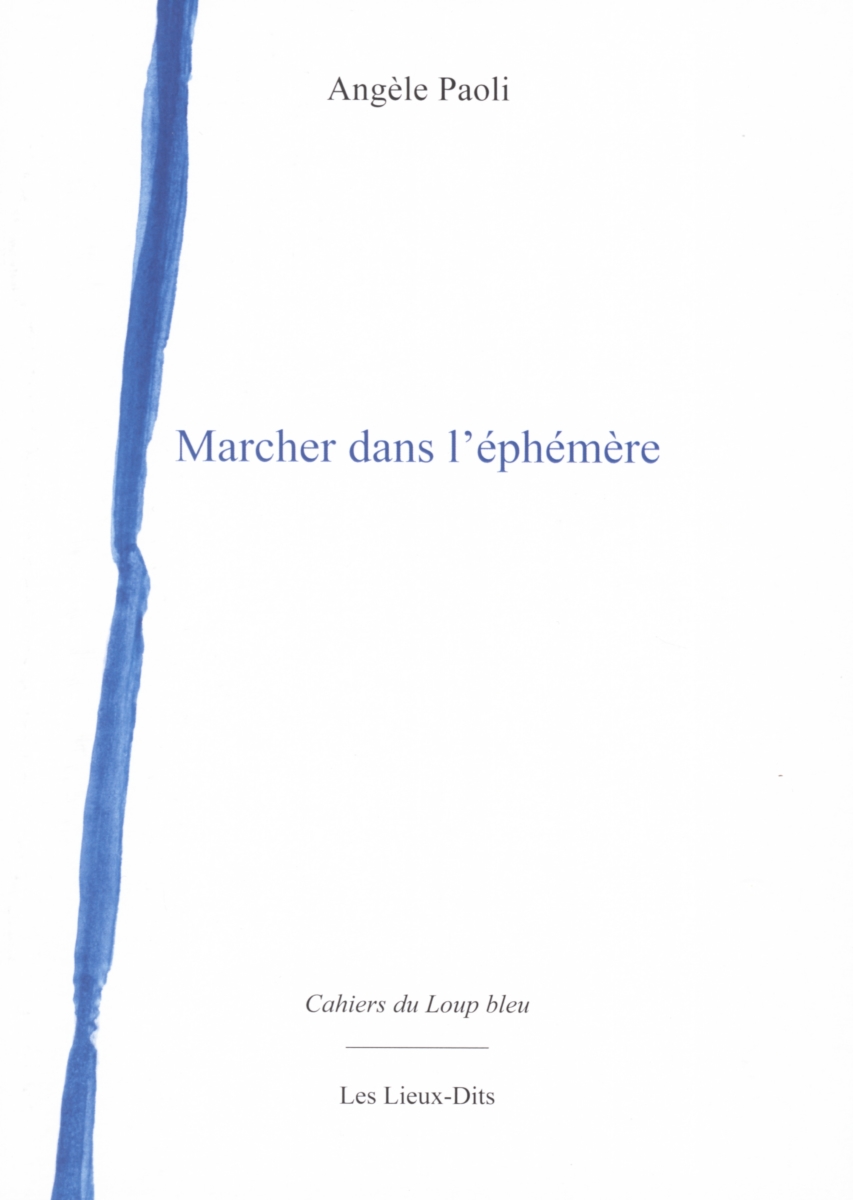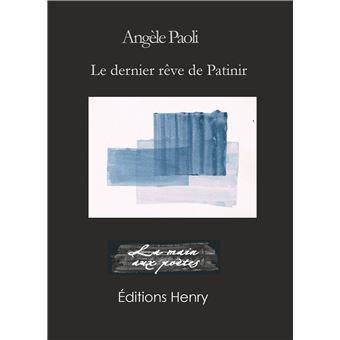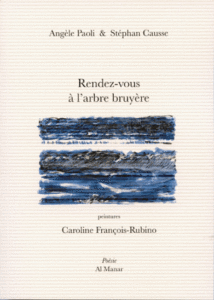« La voie que le poème cherche à se frayer, ici, est la voie de sa propre source. Et cheminant ainsi vers sa propre source, c’est la source en général de la poésie qu’il cherche à atteindre. »
Philippe Lacoue-Labarthe
La poésie comme expérience
De la trouée du silence, la poésie d’Angèle Paoli chemine jusqu’au « vif des fêlures » qu’elle aspire à dire pour les repousser « au plus loin ».
Diversité générique et foisonnement poétique caractérisent sa création littéraire qui accomplit une véritable traversée des pensées pour affirmer une voix de poésie personnelle et donner résonance à une quête ontologique voire métaphysique où l’être ne cesse de s’interroger face au temps, et dans l’espace.
Dans son livre Tramonti, figurant dans la collection « La main aux poètes » des Éditions Henry (2015), après la fugacité du Nous (« nous n’aborderons pas / aux rêves insolubles », p.17), le Je se tisse face à un Tu. Ces deux instances énonciatives sont reliées par les paronymes « dire » et « lire » : « et tu me dis / - je te lis dormante- » (p.57). Aussitôt, la quintessence de l’acte de création se manifeste, mettant en miroir ces deux verbes majeurs pour favoriser l’approche de la poésie comme « l’acte et le lieu » du partage et du don.
Sobriété et générosité du verbe, fluidité et goût de la rupture syntaxique, réticence vocale et fulgurance musicale : l’éclat des contraires subjugue « sur l’aile qui vacille » (p.53) pour mieux « voler/ à l’envers du temps » (p.54).
« Voler », oui, mais il s’agit essentiellement de cheminer, plus précisément de se frayer un chemin, comme le symbolise le choix de certains titres comme Carnets de marche (Les Éditions du Petit Pois, 2010), Solitude des seuils (Colonna Édition, 2012), De l’autre côté (Les Éditions du Petit Pois, collection Prime Abord, 2013).
Dans ce dernier recueil, le lecteur se trouve pris de vertige, happé par ce poème-diptyque quelque peu mallarméen où tout se reflète et s’inverse, comme dans la composition spéculaire du « Sonnet en yx », « allégorique de lui-même » : le motif du miroir scande ces pages pour conférer de la profondeur au paysage et le renverser par un jeu de bascule que la syntaxe désarticulée suscite, fourvoyant et séduisant tour à tour le lecteur :
« tremblé du miroir / le ciel en strates trace
diagonale
paysage en bascule / la terre est ronde / l’horizon tangue
les deux arbres en
vis-à-vis poursuivent
dialogue
clinamen // noir // »
(p. 12)
À l’apogée du poème, l’immersion du Je énonciatif dans le miroir se fait abyssale, provoquant la volatilisation du paysage paradoxalement inscrite sur la page de poésie :
« miroir plan / j’ / entre
dans le verre l’occupe
mi-corps / je / cherche
ne (me) vois pas la-sans-visage
buste / incliné sur foulard
bleu cheveux échappés bras
tendus (mon) appareil photo
cache seules (mes) mains
duo d’accord en écho
le paysage a disparu // Noir // autour »
(p.17)
Puis, lorsque « le miroir se redresse », par delà le « tremblement des couleurs » et l’« extension moi-au-miroir », se décèle, sous la fausse neutralité de la forme infinitive, l’injonction dynamique qui, enchaînant « traverser » et « passer de l’autre côté », fait résonner le titre du recueil :
« l’au-delà du verre traverser
passer de l’autre côté du / je / cherche
qui d’autre que moi ? quel ailleurs ? / rien /
hors le ciel »
(p.20)
Ce « rien » typographiquement détaché, aussitôt supplanté par l’aspiration à poursuivre la recherche dans l’espace du ciel, s’énonce de façon plus péremptoire à la fin de Carnets de marche, prose d’une densité double, à la fois narrative et poétique, où s’inscrivent avec ardeur les pensées en mouvement, proches de la double incitation gracquienne qui refuse la virgule, « en marchant en écrivant ».
« La première jonquille sauvage grelotte. La buvette lettres noires abandonnée hiver comme été à sa vacance en pure perte. Le froid taille en biseau sous la peau. Marine écrin verglacé. Marine écrin plexiglas. Cueillir des hellébores et puis rien. Le silence vent du matin qui gifle et qui grince plein fouet. » (p.122).
Cette cascade de phrases brèves, le plus souvent nominales, débouche sur le constat laconique « et puis rien », avant que ne s’énonce la mise en équivalence métaphorique du silence et du vent, soulignée par l’entrelacement musical des sonorités gutturales sourdes et sonores (« gifle » rappelant « jonquille », « grince » faisant écho à « grelotte ») qui par effet de contraste permet l’émergence vive de la fricative de « fouet » pour faire claquer la phrase ultime du livre.
Entre Carnets de marche et De l’autre côté, se marquent dans Solitude des seuils la palpitation de l’interstice et la jouissance du seuil. Dans son « Liminaire », le poète Jean-Louis Giovannoni apprécie la particularité du lyrisme vibratoire d’Angèle Paoli se fondant sur une « mise à peau » : « Tout est là. Au bord de son bord…retenu. Imprononcé comme l’est le nom de chaque chose, enfouie en son dedans ».
Cette « mise à peau » consiste précisément à faire affleurer par l’acte de poésie ce qui se dérobe en apparence à l’intelligibilité immédiate. Il s’agit de s’adonner à l’acte de dire pour faire émerger ce qui se trame sous le silence. Nul répit face à la nécessité vitale de prononcer tous les bruits qui « trouent le silence » (p.69), en ces lieux-limites de prédilection, désignés par les locutions spatiales qui se substituent l’une à l’autre : « au bord de », « à l’orée de », « à la lisière de », « sur le seuil ». Une véritable dynamique verbale se déploie pour créer le « mirage des mots nus » (p.23) et tenter de les habiller peu à peu, presque subrepticement, par des mots composés, dérivés, engendrés, qui se présentent comme autant de variations musicales pour dire le murmure du seuil à franchir : « bruissement », « crépitement », « craquement », « chuintement », « frémissement », « froissement ». Les effets de rimes intérieures, résultant du même suffixe s’enrichissent de l’allitération en /r/, sonorité vibrante accentuant les syllabes initiales de presque tous ces substantifs.
N’est-ce pas la figuration même de cette esthétique de la trame où les mots vibrent pour effectuer la percée du silence, prononcer « l’imprononcé » dans la solitude fructueuse des seuils ?
Le titre du recueil Tramonti, de consonance méditerranéenne, n’est pas sans évoquer dans l’esprit du lecteur non initié l’idée spatiale de traversée liée à celle de mont ou de vent. Or, le sens corse de crépuscule se trouve dévoilé dans le long poème éponyme scandé par l’anaphore « il y a » (p. 90-97) qui relie temps , regards, silence, crépuscules d’été, instants, sous le ciel picturalement figuré comme une « plaie crépitante de tous ses ors ». De « la lumière du soir » inaugurale où le temps se compte pour « scruter les étoiles » ou « penser la tendresse » jusqu’à l’irruption finale du motif floral de la « criste-marine du soir », quand « l’espace ouvre un chemin / de tendresse dans la douceur », toute une « harmonie du soir » s’esquisse, non sans réminiscences baudelairiennes, avec « valse mélancolique et langoureux vertige », au moment où « le jour chancelle » : s’entrelacent scintillements et estompages, ivresse et ondoiements, glissements et clapotements, « un grand cormoran bleu » et « une vache éblouie » priant « dans le soleil », avant que l’astre ne se noie fatalement « dans son sang qui se fige ».
Mais, belle trouvaille, l’idée d’un « aboli » tramonti se profère, avec l’exigence de l’inanité, la complexité troublante d’une temporalité tant itérative que singulative, et la profusion sonore de couleurs non crépusculaires :
« il y a des instants où
le crépuscule se refuse à être
où l’horizon boréal se grêle
de cailloux bleus
d’effluves mauves
de crénelures hérissées de vert
et »
(p. 95)
Ce moment de pure délectation sensorielle se trouve comme suspendu, mis en suspension par la vocation dilatoire du blanc typographique, mais surtout par l’apparition solitaire du petit mot « et » qui se trouve, en fin de page, audacieusement -mais provisoirement- privé de sa fonction de « conjonction ».
La seconde partie du livre, intitulée « Tramonti », instaure le triomphe de l’entre-deux. Tout s’y fait suspension vibratoire. Dans le premier mouvement, « Soleils anciens », la voix lyrique énonce sa quête à la seconde personne :
« tu cherches la voix des mots
brûlure du maquis
horizon sans faille
ne rien déduire de la vague
des ondulations des feuillages
notes égrenées sous l’archet
complaintes portées vers
l’en-deçà des monts »
(p. 20)
Dans le troisième mouvement, « Sous la peau, comme une écharde », se distingue une métaphore féconde propre à restituer la mission impérieuse du Je qui travaille les mots sous la trame du silence :
« je croise décroise recroise
tramail de mots
dans le tissé silence
qui se trame »
(p.148)
Ce « tramail » des mots se précise, toujours avec la mise en exergue du Je poétique et de sa gestuelle créatrice face au temps qu’il s’agit de saisir au mieux, de capter, de « retenir », ne serait-ce que par la fulgurance d’une image lumineuse :
« je couds mes fils
avec mes mots
pour retenir l’instant lumière »
(p.150)
Alors même qu’« une main rythmait le poème / oiseau papillon oiseau » (p. 151), voici que soudain
« une voix gonfle la phrase
s’en prend à l’obscène du corps
il faudrait adoucir le choc
des dents leur violence
court sous la langue
un cri éclate
la bouche lance
son désarroi
à chaque âge ses plaisirs
à chaque tête ses pensées
une enfant dessine
des ronds noirs dans un cercle bleu
dans le labyrinthe déjà ? »
(p.152).
Lieu majeur de la profération poétique, la bouche permet d’effectuer le glissement énonciatif qui au fil du livre nous fait passer du Tu au Je, puis du Je à Elle, pour tisser une fine chorégraphie pronominale à même de faire vibrer la richesse de la voix lyrique d’Angèle Paoli qui trame et dit, qui tisse et pense, qui relie « ici », lié à « l’immobilité absolue » (p. 39) à « ce qui se vit là-bas / dans cet ailleurs » poursuivi dans la « mémoire » (p. 40), pour faire jaillir son éclat clausulaire, avec la solennité de l’initiale majuscule et la force péremptoire du point unique, final :
« elle pense
à tout ce qui ne peut se dire
qui se pense dans le silence
elle pense à cet autre silence
le grand silence blanc
de l’écume
Là-bas. »
(p. 156)
Poésie qui se pense, poésie qui se coud, poésie qui s’écoute au cœur de ses échos sonores, de ses rimes intérieures, de ses allitérations et de ses assonances, de sa syntaxe affranchie et syncopée : la création révèle ici sa vitalité insatiable où la musique vibre, proche du silence, de l’écume, de leur blancheur immémoriale, où les sons et les couleurs ne manquent pas de tourner « dans l’air du soir » baudelairien. « Paumes tournées vers le ciel », la poésie d’Angèle Paoli parvient, comme dans Tramonti, à nous impliquer corps et âme dans son cheminement crépusculaire jusqu’au « vif des fêlures » qu’elle veut « repousser » (p.53) de ses « mots vertèbres » (p. 103).
Entre Je, Tu, Elle, son lyrisme se fait substantiel et heuristique, tramant entre l’aile et l’île, l’accès à la liberté créatrice que symbolise son néologisme « fémin-îlité » (dans Solitude des seuils, p. 52), intimement lié à ses « Terres de femmes », à sa Corse retrouvée, refondée, retissée comme haut lieu de la Poésie. Dès lors, comment ne pas cheminer sans cesse vers sa propre source ? Dans Phrase, Philippe Lacoue-Labarthe souligne la simplicité exigeante et essentielle de qui se donne ou s’abandonne à la légitimité du mouvement :
« C’est une grande chose que d’avoir ce droit
D’aller, simplement, d’aller – au plus près, pas loin ».
(p. 87)
Telle est la source profonde de la poésie d’Angèle Paoli : « au plus près, pas loin », dans cet entre-deux délectable qui se tisse en silence, qui « trame sur trame sur trame », comme dans le livret cousu main par les Éditions La Porte (2014), « sur le tremblé du soir », quand se profilent les lignes d’une « montagne couronnée » éponyme, figuration parfaite de l’œuvre à frayer, à édifier, à « tramailler » sans répit, « d’un point / de l’horizon / à l’autre » où palpite la Poésie. Non loin également des Feuillets de la Minotaure (Éditions de Corlevour, 2015), entre-deux formel foisonnant, « récit-poèmes » dont l’une des épigraphes ne manque pas de poursuivre l’esthétique de la trame : « Sans jamais perdre le fil de lin de la parole », seule façon d’exalter à demeure le labyrinthe de la création.