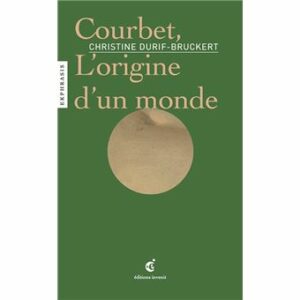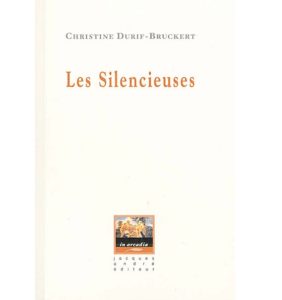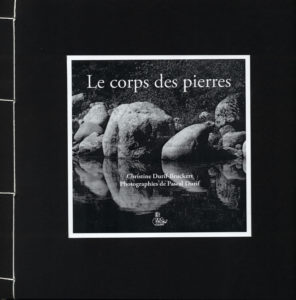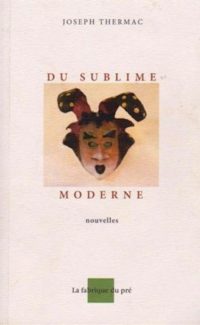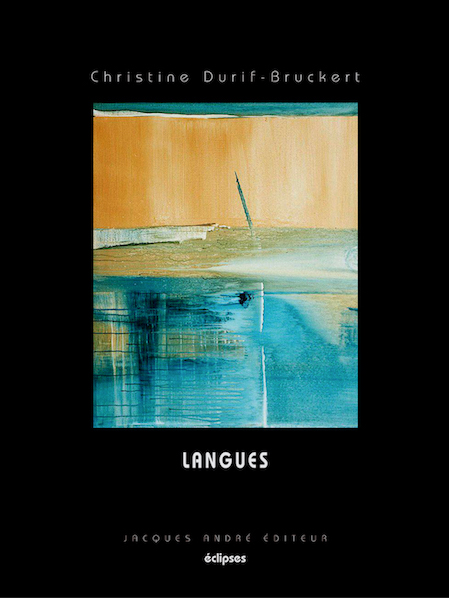Christine Durif-Bruckert, Elle avale les levers du soleil
Sobre et discret, titre rouge, sans motif, si ce n’est le masque logo de l’éditeur, avec ma manie de ne jamais ordonner les livres dans ma bibliothèque, de les caser à la sauvage sur les planches qui peuvent encore en contenir, parfois au pied des meubles, à même le sol…c’est typiquement le livre, qui mince et blanc aime se dérober au regard qui le cherche, ou pire encore qui se glissera à l’intérieur d’un autre livre.
Alors je prends soin de le ranger en double file, sur la deuxième rangée, et le laisser à portée de main, pour le repérer rapidement et m’habituer progressivement à le voir là précisément… Il faut qu’un livre prenne sa place dans la maison avant de creuser sa brèche entre le cœur et l’esprit.
Pas à côté des autres livres de son autrice, un peu à l’écart, celui-là. J’aime que la déambulation entre les titres et les noms d’auteurs soit totalement imprévisible.
J’avais eu le plaisir de découvrir ce texte par une lecture à haute voix. C’est amusant de constater comme dès la seconde lecture, un texte peut vous sembler familier, comment, on ne sait pourquoi la reconnaissance s’opère par pans entiers de textes déjà fixés au mur de la mémoire.
Un texte aussi puissant que poétique, terriblement dense, qui transforme et porte la charge émotionnelle de chaque rencontre avec les personnes anorexiques interviewées. On se dit d’abord que l’autrice pourrait avoir été, de manière personnelle, touchée par l’anorexie, la sienne ou celle d’un proche, comme si l’on ne pouvait s’intéresser à ce thème qu’en riposte à une expérience intime de cette souffrance – aigüe au point qu’on se demande bien pourquoi on irait y plonger l’âme et le museau, si on n’était soi-même impliqué.

Christine Durif-Bruckert, Elle avale les levers du soleil, PHB Éditions, 2021, 73 pages, 10 euros.
Puis comprendre que là est le propre de la recherche anthropologique à la source du texte, plonger par la médiation de protocoles et d’entretiens sensibles - mais dégagés de liens personnels - dans la chair et le sens de la maladie.
Alors finalement, oui, l’autrice, de chercheuse, devient « personnellement » concernée par la chose, à travers le passage du texte au philtre poétique, peut-être une forme de philtre d’amour.
Pour ma part, je n’ai jamais côtoyé de personne souffrant d’anorexie, et je voguais sur les quelques informations liées à la maladie, jusqu’à ce texte qui m’a permis de descendre très profondément dans la sensation d'un corps et d’une psyché anorexiques :
Ivresse douloureuse.
Les choses ont mal tourné.
J’avais si froid.
Le froid remplissait mes cavités
au fur et à mesure de l’apparition de mes creux
un mélange d’air et d’humidité.
Je ne suis déjà plus d’ici. 19
Précis, clinique, et sensoriel, rythmé, à la fois monologue incarné et voix universelles cristallisées dans une parole qui ne dévie pas de sa route. On suit par le texte, une descente aux enfers sans apparat, un constat sans faux semblants, sans fard, sans souci de ménagement ou d’édulcoration, à l’image d’une maladie sans pitié pour ceux qu’elle fauche, aux deux sens du terme. On reste médusé de vivre une immersion totale dans la maladie, posé quasiment sur la « langue » du personnage, de constater que l’acte somme toute banal pour la plupart d’entre nous de se nourrir, contient tant d’ombre, tant de méandres et de louvoiements. On a la sensation d’être « mouillé » dans une sale affaire : ces ruminations / mastications de vide, arrangements interminables avec l’aliment, le corps, la faim, le mal-être, le dégoût, d’avancer, soi-même flanqué de la maladie.
Ce goût dans ma bouche qui n’ose s’avouer tellement j’ai peur de m’y complaire.
J’hésite : continuer, arrêter, se gorger, fermer les yeux, laisser couler, sentir cette chose tant attendue.
Remords regrets.
Aller trop loin
Jusqu’au point de ma démesure.
Suave déglutition.
Ça se passe dans la bouche de se faire avoir.
Un bloc de silence renfrogné.
En alerte. 45
La poésie retenue du texte, l’exactitude et la simplicité du style dans la description des émotions, des situations, le dédoublement par la présence du chœur, le « je » lancinant, tout cela opère une transformation : la douleur du trouble se mue en une des vibrations possibles de la difficulté à exister.
Corps d’os entre terre et lune.
Corps chaud et froid, si froid les soirs de lune pleine.
Je veux avaler les étoiles pour que brillent en mon centre la clarté de ma pureté et de tous mes renoncements.
Grand trou noir.
J’avale les levers du soleil.
Le froid se glisse le long des parois de mon esprit.
Il fait noir dedans.
J’avale le noir.
C’est le silence. 60
Malgré la dureté du sujet, ce qui est étonnant dans ce livre de Christine Durif-Bruckert, c’est qu’on ne sort pas du tout abattu par cette friction avec la réalité de l’anorexie. C’est âpre mais c’est également vivifiant.
Je veux exister
ne plus être l’ombre de moi-même dans la transparence d’un destin brouillé
sens dessus dessous.
Les arbres déracinés.
Le corps frissonnant
en perte de sa matière première.
Que prévoir sans le corps ? 19
Il est question d’anorexie, certes, mais on y retrouve les affres décrits dans la dépression sévère, ou dans la schizophrénie, dans toute maladie qui enferme et tourmente, fricote avec le fait d’entendre des voix, avec la tentation du vide, avec l’angoisse, la phobie.
La voix, elle est toujours là.
Elle me souffle.
Je la suis.
Du fond des forêts, je l’entends venir
comme un bruit de feuillages.
Ma propre voix en une autre.
...
Elle écrase mon histoire
tous les reliefs de ma vie.
Je la supplie.
Elle me dissout. 33
Ou même tout simplement on sent, juste exacerbé par la dimension pathologique, quelque chose qui ressemble fort aux moments malades ou lucides de notre existence dans le face à face avec la « vérité » de la vie.
Vide béant de mes pensées.
Le jour tombe bien au-delà du trait de mes ombres.
Ça marche si bien de se perdre. (...) 41
Le vent, encore
et le monde, de l’autre côté.
Quelle est cette voix qui parle si fort au fond de moi
et qui ne m’entend pas ?
De quelle vérité veut-elle me parler ? 73
Si pour moi vient l’heure de reposer ce recueil dans ma bibliothèque « foutraque » et hétéroclite, ce sera pour vous, celle de le prendre et de suivre l’itinéraire bouleversant de l’héroïne de Elle avale les levers du soleil.