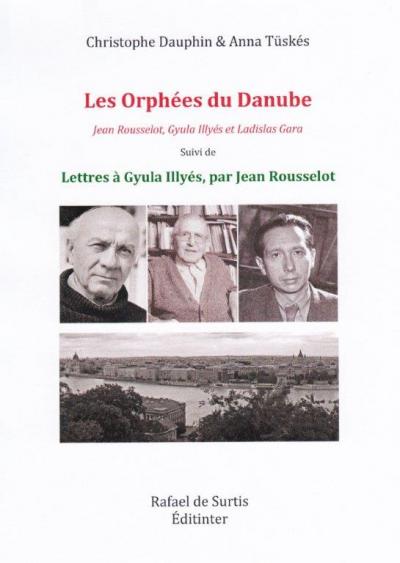TROIS POÈTES POLYNÉSIENS (1) : HENRI HIRO

HENRI HIRO, POÈTE MĀ’ÒHI
Poète et militant emblématique, Henri Hiro s’inscrit dans ce vaste mouvement qui se manifeste à Tahiti à partir de la fin des années 1970, pour une défense des racines, s’exprimant au moyen de l’appellation « ma’ohi », qui qualifie ce qui est autochtone, originaire des îles polynésiennes. Figure de proue du discours identitaire ma’ohi, Henri Hiro accorde une grande place à la terre et à la langue dans la définition de l’identité, de l’appartenance. Henri Hiro a lutté toute sa vie pour la sauvegarde et la réhabilitation de la culture ma’ohi, dont il a contribué à revaloriser les fondements identitaires dissipés. Son engagement total a fait de lui un leader incontestable de la cause au XXème siècle.
Henri Hiro est fondateur et pionnier dans de nombreux domaines culturels, écrit son ami et biographie Jean-Marc Pambrun, qui fut notamment directeur de la Maison de la Culture de 1998 à 2000 et commissaire de l’exposition consacré au poète pour le vingtième anniversaire de sa disparition au Musée de Tahiti et des Îles : « En 2000, alors à la tête de l’établissement qu’Henri avait lui-même dirigé de 1976 à mai 1979, j’ai souhaité m’intéresser davantage au personnage en organisant un Farereiraa1 autour des dix ans de sa disparition. C’est là que je me suis réellement rendu compte qu’Henri Hiro était omniprésent dans toutes les activités culturelles polynésiennes – cinéma, théâtre, littérature, chant traditionnel -, qu’il avait marqué tous ces modes d’expression de son empreinte. Bien sûr, il y en a eu d’autres avant lui : Maco Tevane, cheville ouvrière des établissements culturels en Polynésie, Eugène Pambrun, Tearapo….
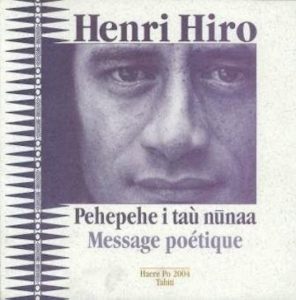
Henri Hiro, Message poétique, Editions Haere Po, 2004, 96 pages, 35 € 91.
Mais Henri Hiro est le fondateur de la littérature, du cinéma et du théâtre polynésien contemporain. Il a été plus loin que les autres à un moment donné… Henri Hiro était contre le salariat dans tout ce qu’il induit d’inégalités, il a voulu tout abandonner pour retourner à un mode de vie traditionnel. Déjà à son époque, cette démarche semblait difficile, la machine moderne étant déjà bien en marche, mais aujourd’hui, ce serait presque illusoire ! Malgré tout, j’estime que les réflexions de Henri Hiro restent d’actualité alors même que l’on a l’impression de s’en éloigner… Je crois qu’il est un exemple possible à donner à la jeunesse en manque de repères dans le sens où il était « un jeune comme les autres », qui a vécu la vie que beaucoup connaissent. Ni privilégié, ni fortuné, en situation d’échec scolaire (il s’est fait virer au collège !), qui cumule des petits boulots… Aujourd’hui, je ne vois pas de leader culturel aussi remarquable que lui, aussi impliqué. Henri Hiro se réalisait dans la création sans avoir peur de montrer ses engagements. Il a défilé tous les mercredis pendant des mois avec un pu pour dire non aux essais nucléaires ! Il était presque seul, puis d’autres se sont greffés (Oscar Temaru, Green Peace). Beaucoup se méfiaient de lui car il était subversif dans la pensée de son époque. Pourtant, son objectif n’était ni le pouvoir, ni l’argent En fait, il ne se contentait pas d’avoir des idées, il les mettait en pratique ! Il disait : « personne ne m’écoute quand je parle, alors je vais parler avec les mains ». En clair : « C’est mon travail qui va parler ». Henri Hiro séduisait autant qu’il dérangeait. »
Tahitien au destin peu ordinaire, Henri Hiro, en l’espace de quinze ans, a bousculé sur son passage le paysage politique, culturel et religieux polynésien, pour le marquer durablement de son empreinte et le transformer.
Né à Moorea, le 1er janvier 1944, Henri Hiro est élevé à Punaauia par des parents ne parlant que le tahitien. En 1967, grâce à l’aide financière de sa paroisse, il accomplit des études de théologie à la faculté libre de l’Église réformée de Montpellier, dont il revient diplômé en Polynésie, en décembre 1972.
Sa prise de conscience de l’identité polynésienne tout comme ses revendications le conduisent à quitter l’Église et à s’impliquer intensément au sein de la vie culturelle tahitienne, pour sa réhabilitation. Il y a que Hiro est revenu de la métropole, contestataire ; un contestataire qui dénonce le tort fait aux Polynésiens durant l’évangélisation. Il n’a, alors, de cesse, de raviver les traditions occultées pendant plus d’un siècle et demi.

Hiro nous dit : « Si tu étais venu chez nous, nous t’aurions accueilli à bras ouverts. Mais tu es venu ici chez toi, et on ne sait comment t’accueillir chez toi », ou encore : « Lorsque quelque chose est abandonné, c’est qu’il y a eu des préjugés, qu’une dévalorisation s’est produite. »
Cet engouement l’amènera, en 1981, à créer le mouvement politique Hau Maohi (Paix Maohi) et même, en 1987, à se rapprocher d’Oscar Temaru, en étant nommé vice-président du parti indépendantiste Tavini Huiraatira.
Le 15 novembre 1975, un nouveau parti politique voit le jour auquel Henri Hiro donne le nom de Ia mana te nuna’a (« Que le peuple prenne le pouvoir »). Le 17 novembre, les sept fondateurs signent un manifeste qui dénonce le manquement grave des hommes et des partis politiques « aux règles élémentaires de l’honnêteté politique et de la probité. » En 1979, la question nucléaire est de plus en plus cruciale.
Le 13 février Henri Hiro est élu président de l’association écologiste Ia ora te natura qui vote une motion proclamant son opposition à toute expérimentation nucléaire2 dans le Pacifique. Il restera à la tête de l’organisation jusqu’en 1981. Henri Hiro qui a été nommé directeur de la Maison des Jeunes de Tipaerui en 1974, prend la tête, à partir de 1980, du département recherche et création de l’Office Territorial d’Action Culturelle (OTAC). Par ces fonctions institutionnelles, il milite pour la reconnaissance du patrimoine culturel polynésien et s’efforce d’y insuffler un dynamisme nouveau. Sous son impulsion et celle d’autres jeunes étudiants ayant également étudiés en métropole, l’Académie tahitienne est créée, et des concours littéraires sont institués.
Henri Hiro engage notamment un travail de recueil des traditions orales tahitiennes, et encourage la jeunesse polynésienne à s’exprimer par le biais de la culture, et en particulier à écrire, quelle que soit la langue choisie (le français l’anglais ou le reo ma'ohi). Par ses fonctions institutionnelles, il milite pour la reconnaissance du patrimoine culturel polynésien et s’efforce d’y insuffler un dynamisme nouveau. Henri Hiro encourage la jeunesse polynésienne à s’exprimer par le biais de la culture, à travers la langue, la poésie, la danse, les chants, l’expression théâtrale et le cinéma.
Il devient lui-même réalisateur, acteur, metteur en scène et comédien. Il traduit des pièces de théâtre du français au reo ma’ohi. Son œuvre est profondément habitée par la culture spirituelle traditionnelle ma’ohi, tout en exprimant une révolte contre les maux contemporains de la société polynésienne.
En 1985, il démissionne simultanément de tous ses postes « en ville » et se retire, avec femme et enfants, dans sa vallée nourricière de Arei, sur l’île de Huahine. Il estime qu’en tant que Polynésien, la ville fait de lui un captif. Henri Hiro s’est éteint le 10 mars 1990, à Huahine.
À lire : Pehepehe i tau nunaa/Message poétique (Éditions Tupuna, 1985. Rééd. Haere Po, 2004), Taaroa (OTAC, 1984). Filmographie : Le Château (1979), Marae (1983), Te ora (1988), série télévisée écrite par Henri Hiro et réalisée par Bruno Tetaria ; quinze films pour enfants consacrés aux différents arbres de Polynésie. À consulter : Jean-Marc Tera’ituatini Pambrun, Henri Hiro, héros polynésien (éditions Puna Hono, 2010).
TON DEMAIN, C’EST TA MAIN
À chaque jour faut-il sa peine ?
Le soir où la lune porte le nom de Turu.
il faut fouetter Ruahatu, attraper,
secouer Tahauru3,
chercher Matatini4.
Tutru5 est étendu, immobile,
Ruahatu reste muet,
Matatini garde les yeux fermés,
il faut les trouver,
les réveiller de leur sommeil.
les dieux se prélassent étendus,
ils se tournent
et se retournent dans leurs vomissures,
transis de froid par la faute de Māraì6
Ils sont repus de la graisse du mara.
Ils ne lèvent la tête que pour une caresse
des alizés.
Ils sont indifférents au temps qui passe,
insensibles aux gémissements
Ils restent sourds face aux insultes,
ils se moquent des agonies.
Ils gisent la bouche ouverte, repus,
déféquant, leur seule tâche est le pet,
ils craquent de graisse.
Et trouvant la force d’ouvrir un œil,
tout ce qu’ils trouvent à te dire c’est :
« Va ramasser des coquillages
et des crustacées : des crabes de mer,
des conques à cinq doigts, des conques
allongées, des bigorneaux
et des crabes de terre.
Voilà ta pèche, voilà tes aliments
de subsistance ! »
Celui qui appelle les dieux à son aide
ne reçoit-il que peines en retour ?
Est-il condamné à ne manger
que des coquilles ?
C’est ta main, et ta main seule
qui est en mesure de te faire vivre.
Cette main bonne retourneuse de terre,
une main courageuse, une main délicate
et pleine de soins, cette main fertile.
Car ne dit-on pas :
« Le soir de Turu est une bonne nuit
Pour toutes tes plantations ? »
Henri HIRO
(Poème extrait de Pehepehe i tau nunaa/Message poétique (Éditions Tupuna, 1985. Rééd. Haere Po, 2004).