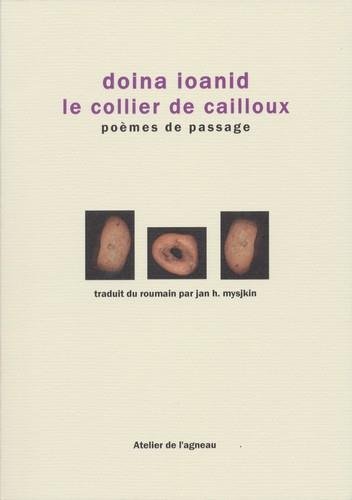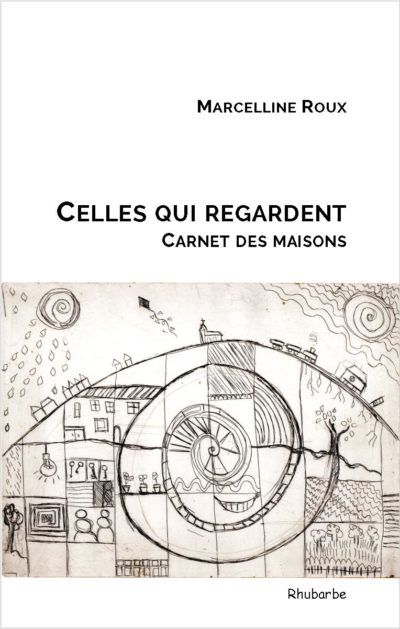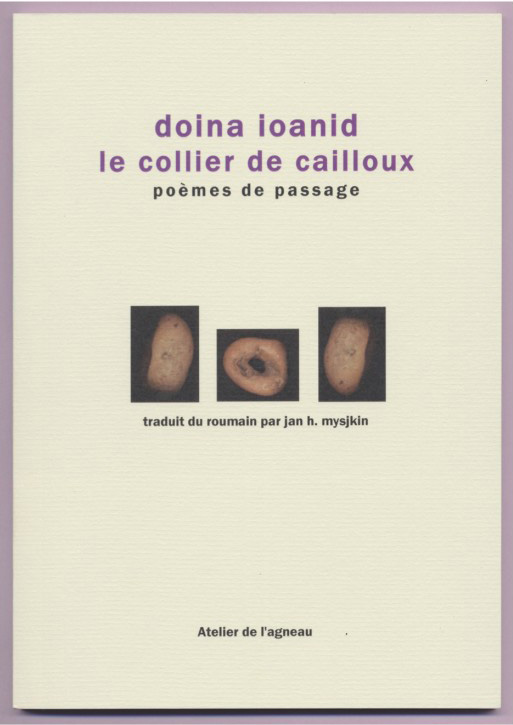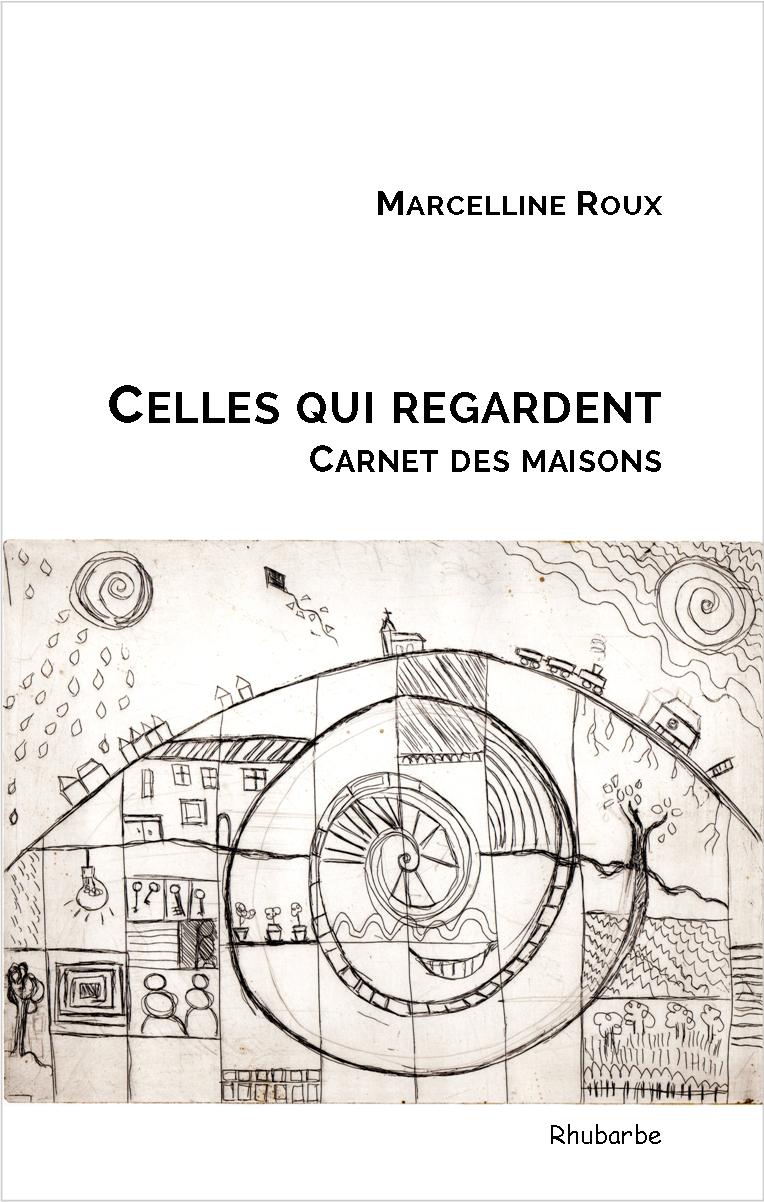Doina Ioanid: Histoires du Pays des Babouches
Doina Ioanid: Histoires du Pays des Babouches (le titre en français du recueil Cele mai mici proze, Editura Nemira, București, 2017)
Traduit du roumain par
Jan H. Mysjkin
Préambule – PoèmAnvers
Une veilleuse qui peut prendre les formes d’une cache-abri. Deux pigeons blottis à côté d’un tuyau de descente. Un plancher blanc où glissent un cheveu et un harmonica dans l’appartement au-dessous. Des persiennes rouge brique esquissant un sourire de loin. Et puis les quiétudes. Les quiétudes du soir. Les quiétudes alléchées. Tu écoutes comme elles se meuvent, comme elles sonnent. Tu les vois briller sur un ongle. Quiétudes du soir. Une veilleuse. Un visage sous une veilleuse. Des polders traversés par le vent. Les quiétudes volant comme des foulques au-dessus de moi. Je me souviens de ton baiser bien ajusté à mon pied, le bas le plus fin, dans un ici, dans un ailleurs.
Je me tiens dans une main et je mendie l’histoire de quelqu’un d’autre. Un après-midi d’été indien. Un café, je me dirige vers une table. Un homme se dirige vers la même table. C’est une grande table ronde. Partageons-la, dit-il. Un moment de gêne. Il s’appelle Lemi, il fume des Marlboro. Il habite tout près, il n’avait plus de sucre. Peut-être juste un prétexte pour un café, un après-midi d’été indien. Lui, un café, moi, une bière. Il est venu à Anvers quand il avait dix-sept ans, de l’ex-Yougoslavie. Le hasard : un régisseur l’avait remarqué dans une discothèque, il cherchait quelqu’un avec l’accent et une gueule de l’Est pour jouer un KGB-iste. Il est parti spontanément. Le sort. Il a ensuite joué dans d’autres films. Il est spontané. Spontané et direct. Il a un nez de boxeur et ressemble à Robert De Niro. Maintenant, il est dans le business, quelque chose avec la mode, l’art. Il cuisine bien la paella. Mais il est seul, divorcé. Une femme marocaine. Deux enfants. Les enfants te coûtent une fortune en Belgique. Le soleil sur le plateau de la table. Quelques feuilles qui froufroutent. Au départ, un bras sur mon épaule. Nous, gens de l’Est, nous devons nous soutenir les uns les autres. Je me promène dans la vieille ville, parmi des immeubles givrés. Je fais des photos, je bois une bière. Je me mets de nouveau en route. Un œil s’ouvre dans mon dos, un œil avec un doigt sur ses lèvres. Ensuite, je longe le jardin du béguinage, là où l’oignon donne des fleurs violettes. Et je me tiens de nouveau dans une main et je mendie l’histoire de quelqu’un d’autre. En fait, mon histoire, en quelque sorte. L’histoire d’une main mise dans une autre main.
Une image pivotant sur un tambour, une apparition dans une tour à Bruges. Autour de moi, sept lits, et dessus, sept femmes en blanc, avec un turban orange. La réalité du jour commence avec un battement d’ailes contre la fenêtre à côté de mon lit. Un vitrail sonore. L’aile ouverte d’un oiseau m’habille discrètement à l’intérieur. Mes membranes matinales. Membranes protectrices.
Good morning sur un escalier bleuâtre aux taches de café. L’homme au sushi me sourit. Des propos recueillis dans la rue aux massettes. En face de moi, un cygne blanc, les ailes grandes ouvertes. Le tramway fait revenir sur ses rails toutes sortes de souvenirs avoisinants. Puis, je fais la cuisine pour quelqu’un d’autre que celui en face de moi. Quelqu’un qui essaie de m’entrevoir au-dessus de la tête des autres.
Te déplacer avec une chaise. Reculer avec une chaise. De combien de manières ? Jusqu’à ce que mes yeux dépassent les autres et s’assoient à ta table. Jusqu’à ce que tes yeux secouent les griffes de ton épaule, au détour d’une rue. Juste un regard parlant.
Les lignes d’un plancher blanc que tu suis des soirées entières. Le plancher blanc, rayé comme un cahier réglé. Réglé, réglé, feuilles rayées. Garde, regarde les lignes de ta paume ! Un arbre entouré de chrysanthèmes et une bicyclette posée contre lui. Je ne sais pas rouler à bicyclette. Alors ce sera taxiclette ou pédalo.
Sel et poivre. Prendre le chemin du poivre et du sel. Leurs histoires te rassemblent comme les doigts d’une main. Et de nouveau cette musique d’un tram qui ramène des souvenirs sur ses rails. Sel et poivre, le chemin de tes pas sur le plancher blanc.