Joël Bastard, Entre deux livres, François Cheng, Enfin le royaume, quatrains, Jacques Ancet, Image et récit de l’arbre et des saisons
Joël Bastard, c’est avant tout une écriture et une vision de poète au service de cette écriture. Dans ce livre relativement mince, (70 pages environ) on prend plaisir à rencontrer toutes sortes de paragraphes de poèmes en prose, dont chaque ligne abonde de trouvailles, d’images ravissantes sans qu’elles soient pour autant à prendre à la légère. « Je respire par petites images » écrit-il d’emblée. Je relèverai quelques unes de ces images aussitôt : c’est la colombe dont « le collier blanc annonce et retient l’espace » , « entre deux livres nous sommes au vent » , « les nénuphars se vautrent à l’eau plane. » , « à l’ombre du verger une pleine lune nous fait baisser les yeux » , « la mer se démaille sous les yeux excités ».
.
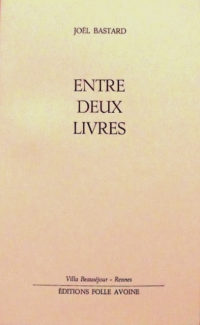
Joël Bastard, Entre deux livres, Editions Folle Avoine.
L’intéressant, dans ces textes où nature et réalités quotidiennes sont toujours présentes, soit explicitement soit implicitement selon les formulations, c’est que leur force poétique tire sa beauté davantage des mots en eux-mêmes, par leur proximité, par l’économie de leur agencement, que d’une tentative d’expression qui chercherait à construire une fiction de profondeur, une incarnation d’un « au-delà » de la langue poétisante. Cette poésie ne nous fait pas la morale, ne nous fait pas « la religion », si elle relie, si elle recèle une sagesse c’est spontanément, à son insu, car elle ne prétend pas à autre chose qu’elle-même. Il ne s’agit donc pas de l’usage surréaliste du « stupéfiant image », mais de visions en mots, de visions terrestres, qui inspirent, qui suggèrent. L’imagination du lecteur épouse leurs ondes en élargissement, comme le nénuphar, lors d’une risée provoquée par le vent, « se prend pour une vague » . Ondes qui sont réveillées par le mouvement de la lecture. Et c’est de cette conjonction de l’écrit statique, qui s’épanouit brièvement sous le parcours du regard, et de l’imagination mobile qui pensivement déchiffre, que surgit une beauté propre à Joël Bastard, beauté simple, discrète, non ostensible, à la fugacité constamment renouvelée. Ce livre, où l’on retrouve la veine du fameux « Beule » , ou du « Sentiment du lièvre » , nous réserve ce que la poésie de Joël Bastard offre de plus réussi, parce que de plus inépuisable. Je conseillerais, du reste, à ceux qui ne connaissent pas ce poète, de commencer par ce livre-ci. Sa richesse et les réflexions auxquelles il nous incite, introduisent directement et simplement à un univers qui est aussi le nôtre, vu à travers une parole qui le rafraîchit, le rénove grâce à un éclairage poétique attachant. Sortir de l’habitude qui effac eest une cure de poésie. Joël Bastard enchante la réalité sans l’abandonner. Son livre « entre deux livres » marie la beauté du signifiant habilement structuré, avec le charme d’un sens dont la limpidité irradie de façon aussi saisissante qu’une vitrine s’étoile après qu’une pierre l’aura percutée. Parole d’argent d’une poésie que je rapprocherais de la modernité essentielle qu’inaugura Marcel Duchamp avec son « Grand Verre ».
François Cheng, Enfin le royaume, quatrains
Avec un laconisme tout oriental, François Cheng, notre académicien venu de Chine, nous offre un recueil de ses quatrains, nourris d’un arrière-plan de sagesse où l’on détecte volontiers quelques traits taoïstes, d’autres confucianistes, associés à une culture issue en particulier des sentences de moralistes français.
Cette fusion conduit à des formules d’une efficace simplicité. On les lira avec le plaisir que produit leur profondeur intuitive, leur force évocatrice, leur point de vue spécifique sur le vécu de l’auteur. Point de vue qui par son recul, sa réflexion incessante et surplombante sur ce qu’est vivre, prend un relief universel.
.
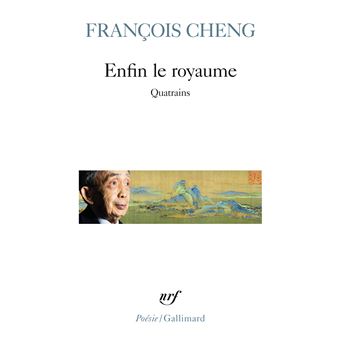
François Cheng, Enfin le royaume – quatrains –(Coll. Poésie/Gallimard NRF)
On ne saurait accueillir avec indifférence cette sorte de « haikai » :
Le centre est là
Où se révèle
Un Oeil qui voit
Un Coeur qui bat
De ce centre la rêverie du poète s’élance à travers l’espace tout à fait comme sont réputés voler les Immortels taoïstes :
Suivre les poissons, suivre les oiseaux.
Envies-tu leur sort ? Suis-les jusqu’au bout,
Jusqu’à te muer en bleu originel,
Terreau du désir même de nage, de vol.
Enfin, voici l’auto-injonction implicite qui constitue la toile de fond pensive de tous ces quatrains qui, dans les dernières de ces quelques deux cent onze pages, dévoile toute son altitude morale et sa noblesse essentielle :
Ne te mens plus ni ne te
Lamentes. L’heure est venue
De faire face, peu te chaut
L’extase ou le désastre
Pour finir, à la dernière page, par un splendide « Envoi » formulé avec une généreuse lucidité, et la magnifique éthique d’un poète dans toute sa grandeur :
Ne quémande rien. N’attends pas
D’être un jour payé de retour.
Ce que tu donnes trace une voie
Menant plus loin que tes pas.
Ces quatrains au quotidien, lus au hasard du livre, sont une richesse pour chacun, une forme exemplaire de la conscience d’être au monde, et j’ai admiré l’humilité insolente du quatrain de la page 95, que je ne déflorerai pas ici, pour aiguillonner la curiosité. Ce livre peut offrir un beau compagnonnage, en ce qu’il est « poéthique », indissolublement associant la sensibilité du poétique, avec l’intelligence de l’éthique, ce qui lui garantit le mérite d’une relecture inusable, infinie.
Jacques Ancet, Image et récit de l’arbre et des saisons
La Revue TRAVERSÉES, depuis bon nombre d’années, suit avec intérêt l’épanouissement de l’oeuvre du poète et traducteur Jacques Ancet.
En un univers de vacarme et de fracas, de mensonge et de violence, ses livres attentifs aux choses naturelles, humbles et belles, sont comme le baume à l’âme qu’apporte un regard profond sur la vie, lorsqu’elle est scrutée dans le tissu d’une « intimité humaine ». « Intimité », en ce que l’écriture d’Ancet se saisit des choses du monde sans perdre jamais sa relation avec la conscience écrivante, relation tout de délicatesse et de justesse. Et « humaine »,parce que l’écriture n’oublie jamais le rapport à l’humain, au sens le plus large.

Jacques Ancet, Image et récit de l'arbre et des saisons, PublieNet, collection Temps réel, Paris, 2019, 160 pages.
Il me semble par exemple dans ce livre, que la relation entre ce qui s’écrit à travers l’image dynamique de l’arbre, qui a, comme disait à peu près le poète Joe Bousquet, sa manière à lui de négocier avec l’espace, et l’image de l’être humain, des corps, de leurs sentiments, est typique : elle dévoile par le jeu alternatif des pages en italiques insérées dans le texte, cette sorte de dialogue qu’entretient « l’arbre-monde-poète » avec la vie des êtres vivants qui l’entourent de près (en « cet espace - intérieur ? extérieur ? déployé entre lui et les choses... »). Le paradoxe est que la figure de cet arbre confine secrètement au mythe de l’Arbre Cosmique. Autrement dit l’arbre est une figure organisatrice du texte, la poussée de sève sur laquelle se greffent les moments successifs de l’écriture, chacun mené vers une question, une description, le vécu d’un personnage, toujours avec bonheur et songeries (ou réflexions) « nutritives ». L’écriture ici, alternativement active ou contemplative, émouvante ou objective, confère à ce texte inclassable un caractère de poésie romanesque, ou de roman poétique, dont une des interrogations les plus centrales est d’explorer ce qui différencie l’image au sens filmique, photographique, affichiste, l’image plastique, de ce qu’on appelle image en poésie, et littérature. Tout au long du livre, en arrière-pensée, le voir immédiat (fonction biologique de la vue au sens quotidien, mais aussi vidéo, télévision, cinéma) implicitement se confronte au développement de la vision « visionnaire », médiate, celle de la littérature, de la langue, du poétique. La part des sens, de tous les sens, dans la seconde vision sollicite l’imagination, les attributions de significations culturelles, symboliques, bien davantage que le donné du « voir » premier. C’est l’expérience (spéculative en quelque manière) que nous transmet le « récit [à propos] de l’arbre » à travers le temps : celui de la lecture et celui d’une image en transformations grâce au prisme des « saisons ». Quel est ce temps et quel est cet espace où se déploie l’image imaginative, celle qui vit en relation avec la conscience ? Où s’avance la pensée, lorsqu’en ses étapes, elle mêle « parti-pris des choses » et « parti-pris des vivants » ? Autant de séquences d’énigmes suggérées, que le lecteur éprouve au cours des pages et qu’il résoudra, à son gré - il se peut momentanément -, par le bonheur d’une lecture pleine de poésie, bien propre à nous initier à une saine façon de nidifier en notre « arbre », d’habiter en ce cosmos qui nous est extérieur, certes, mais tout autant intérieur à travers le langage-pensée, au point que l’intériorité et l’extériorité réduites à ce mince interface sont en vérité indissociables, et au fil des pages se coagulent, disons-le ainsi, « en beauté ».