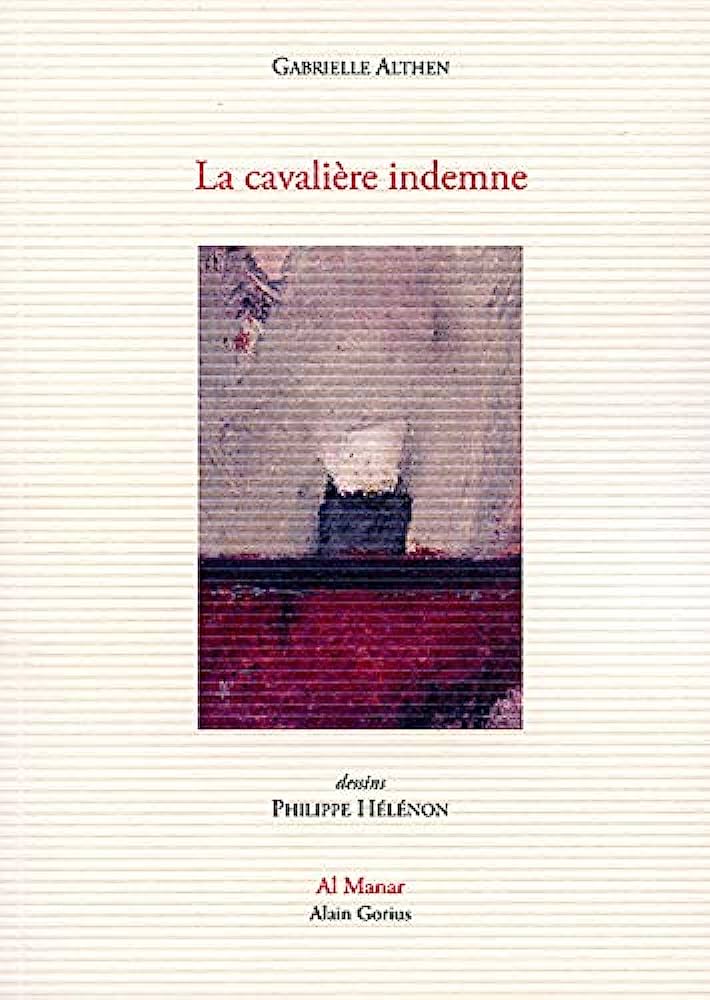Gabrielle Althen, La fête invisible
Arpenter un ouvrage de Gabrielle Althen révèle parfois bien des surprises. Poétesse reconnue au sein de la petite galaxie poétique chloroformée, elle a été notamment professeur des universités (Paris X Nanterre) sous le nom romancé de Colette Astier. Membre de l’Académie Mallarmé et du jury du Prix féminin Louise Labé, avec à son actif une vingtaine d’ouvrages dont certains propices à la promenade intérieure.

Gabrielle Althen, La Fête invisible, Gallimard, 128 pages, 14, 50 euros.
Une centaine de courts poèmes, alliant verticalité et horizontalité dans un jeu transversal et qui délimitée un parcours ou plutôt une cartographie insondable (toute cartographie est un lieu transitoire, inachevé) dans laquelle l’inexprimable côtoie habilement le révélé, à tel point que l’on se demande, s’il n’y a pas derrière ces mots « ouverts » à une plénitude engageante, comme un artifice singulier qui se déploie et se déplace ici et là dans une langue abrupte et lisse à la fois et qui convoite une instance plus souterraine:
Depuis les friches du moment
Car
(L’œil cherchant l’œil où s’inscrire)
J’erre où tu me manques
Bien que je ne sache au juste qui manque (P.13)
Une lumière aussi dont il faut cependant se prémunir de l’incertain éclat qui parfois là encore peut se révéler retors, voire dévastateur, car la poétesse qui tantôt se veut sereine, ou tantôt tourmentée, sait pertinemment que les rayons invisibles du soleil sont parfois meurtriers. A trop vouloir sonder certains objets impalpables pour en percer je ne sais quel étourdissant mystère, on finit par devenir aveugle. Or Gabrielle Althen a toujours été une femme un peu secrète, mais également obstinée. Il n’est donc pas étonnant que :
Le silence a encore les dents jaunes (…) Qui donc avait.. (P.12)
Qui donc avait éteint le jour en se trompant de manque ? (P.13)
Et qui résonne dans le cas présent comme une sorte d’alerte. L’imprévisible est au cœur d’une parole toujours en devenir,
Et le vent fait sonner la couleur de ce vide (13)
Fulgurant cependant et cheminant lentement à travers les masques de la nuit qui corrompent l’âme et la chair en toute impunité. Et on l’aura compris, cette Beauté (est-elle fatale au juste ?) qui semble en apparence explicite et transparente, peut également contenir des aspects plus sombres que la poétesse se garde bien de révéler et d’infléchir au risque de tromper son Esprit. Or ce manque qui s’est naturellement établi dans la conscience (ou l’absence de conscience) se distingue lui –même comme un simple exercice- d’ordre linguistique ? – et mental ; une hyperbole catalysée en quelque sorte, mais d’une plus grande plénitude lorsqu’on va le chercher, Amour ! Ö Amour ! Est-ce bien de toi dont il s’agit lorsque,
Des enfants jouent sous le ciel fastueux (P.27)
Il n’est plus alors certain (mais ?) que le langage comble un vide plus grand encore – comme si la fluidité des mots n’était que le pâle reflet d’un abîme refoulé. Aussi la poétesse se garde bien une fois de plus et ce vraisemblablement pour se protéger (mais de qui ?) de dire et d’écrire, le CORPS qui l’occupe et qui d’une certaine manière la traverse, mais cette fois-ci sans laisser de béantes cicatrices. Gabrielle Althen a force d’efforts et de patience conjugués, a appris au cours du temps à maîtriser le mauvais sort. Comme « l’éclat rétractile » elle ne se confond (se meut) ni dans le bleu du ciel, ni avec le sommet de la montagne, et encore moins dans leur excavation. Tout se joue ailleurs, dans un ailleurs fécond qui fait que « le ciel reste ciel », et que la montagne peut parfois s’effacer miraculeusement;
Le ventre du ciel racle encore la montagne et les points
cardinaux continuent de se taire : (P.35)
Ainsi,
Dans le jardin qui enlaidit
La chose déjà fanée se pose et se repose (P.37)
La chose ? Voilà donc où le regard s’évide (P. 41),, en se perdant vraisemblablement dans un tumulte plus ancien où l’œil n’a plus vraiment de prise sur le dicible/indicible, avec en arrière plan, la folie de croire que la fusion instantanée recouvre l’AMOUR perdu dans les méandres de la terre, ou bien encore dans l’espace/temps,
Falloir ! Mais qu’il y faille, qu’il y faille mériter le désir ! (P.45)
Une véritable et implacable injonction. La poétesse, qui soudain se réveille après une longue et âpre insomnie, entend bien dès lors, ne plus se laisser pervertir, engloutir, par toutes sortes de fadaises, (« La sincérité est une escroquerie »), au contraire elle entend bien lutter contre ce qui depuis tout temps l’obsède :
Beauté : le ciel a forcé les fenêtres. Les phrases sont dissoutes (P.59)
Beauté., nue comme une lame, pur lys de ciel, - et ordre de couteau ! (P.72)
Ainsi toute la force du présent recueil repose t-il principalement et paradoxalement sur cette fragilité acquise au cœur de l’expérience personnelle, et intime, aussi bien que fortement maîtrisée depuis le début d’une longue aventure poétique. Les mots n’ont pas « dévié» de leur lieu originel, et ne s’offrent guère plus à la vue, même si :
La tentation n’est guère ordinaire pour beaucoup de savoir que le monde est une chance (P.86)
Avec l’errance qui se brise contre la promesse, pour finalement s’exclamer :
Suis-je heureuse ? (P.114)