Gérard Mordillat, Le Linceul du vieux monde
Figure-toi, si tu veux bien, une conscience vraiment malheureuse, un désespoir profond, étayé par la raison. Ulysse, par exemple, quand il cherche Ithaque. Nous savons que quelque chose ne va pas dans l’organisation sociale des Hommes.
Nous savons que quelque chose ne va pas dans l’organisation sociale des Hommes. Nous savons que le concept le plus général de travail a été pulvérisé dans la polynésie mondiale de l’emploi et du mini-job : nous savons très bien compter, mais très mal valoriser. Nous savons que la Terre n’est qu’un océan de batailles commerciales opposant des réseaux dont les postes sont des humains numériques (hommes machinées et machines humanisées). Nous savons par ailleurs que certains des derniers métiers libres sont acculés, comme certaines espèces animales, à des territoires si petits et si coupés de toute ressource que l’extinction ou l’insignifiance semblent bientôt la seule issue. La poésie est l’un de ces êtres vivants affaiblis dont l’existence repliée ne nous apparaît que comme une survivance n’ayant plus rien à offrir que la tristesse d’une irréversible stérilité. Le noir de cette conscience malheureuse est lucide, hélas.
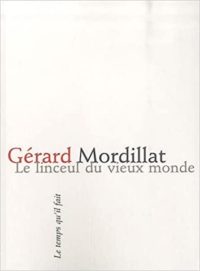
Gérard Mordillat, Le Linceul du
vieux monde, Editions Le temps
qu’il fait, 2011, 80p, 12€.
Gérard Mordillat a choisi de ne rien cacher des « ravages » qui nous alarment :
Regarde bien
C’est ça
Quand le libéralisme passe
Rien ne reste
Plus rien.
Devant des mots que trop de poètes refuseraient, il ne recule pas. L’auteur ne s’en tient pas à la bonne conscience poétique : à force de rester retrancher derrière les frontières du signe, celle-ci a fini par devenir moribonde, pudibonde à l’excès, et du coup la bête ne sait plus mordre. Ce sauvage, au contraire, la fait bondir hors de son territoire, lui fait bander ses muscles et ruer dans les brancards. Le Linceul du vieux monde est un livre de poèmes qui permet de prendre la température de notre longue nuit d’hiver, mais sans complaisance pour elle. Il ne s’agit surtout pas de la jouissance nihiliste d’un vieux bande-mou tiré de Houellebecq, ni du plaisir sénile de quelque décliniste ami des médias. Au contraire, quand le poète Mordillat parle, la bouche de l’enfant se met à parler, et c’est une langue qui vient d’ailleurs : c’est, sinon un espoir, du moins un désir d’espoir, et c’est en cela que le poème mérite que certaines bêtes s’y acharnent, presque à l’insu de tous les civilisés.
Mais c’est si dur, d’écrire des poèmes. Il faut être ou bien terriblement surdoué, ou bien naïf, ou bien outrecuidant pour croire qu’aujourd’hui encore, c’est facile de faire un poème, que c’est nécessaire d’y croire, et que d’emblée on y respire à l’aise. Car il ne s’agit pas simplement de vouloir échapper au néant : cela aussi, l’écrivain néo-libéral le veut ; d’une certaine manière son sens du confort et sa bonne conscience lui dictent son credo moral. Lui aussi veut la vie, la lumière, il veut le droit, en un mot le commerce avec ses « frères humains ». Mais si Le Linceul du vieux monde nous touche à ce point, c’est que l’on y voit bien qu’écrire encore et toujours de la poésie, c’est plus difficile que ça. Qu’est-ce que c’est que cette « cause », celle de l’enfant assassiné qui « pend à la crémone » ? Qu’est-ce que c’est que cet « orage » qui est le gros temps de la poésie ? Que nous disent ces amantes multiples, désirées, désirantes, irradiant sous nos yeux dans l’écriture ? Que nous disent les flammes de ces figures mythiques, portables dans le texte de Mordillat, et qui éclairent nos mains de charbon comme autant de petits foyers ? Et qu’est-ce que c’est que ce mince espoir révolutionnaire contenu dans le poème, cette pâle lueur, transportée de montagne en montagne à travers la nuit, et que l’on se transmet tant bien que mal, génération après génération ?
Chaque jour tu fais l’épreuve de la foule, épaule contre épaule, tu passes par le temps de la foule. Tu vois par exemple ce peuple qui jubile :
Les petits-bourgeois
Français.
Ils étranglent les singes, ils hurlent « mort à l’étranger » ! L’élan fasciste du peuple existe, il se laisse même observer avec une précision toute documentaire : la machine économico-politique fabrique un désir terriblement pervers, une passivité inconsciente face à la puissance de mort qui se développe à tous les étages de la fusée sociale. Sale ivresse, qui n’a rien à voir avec l’enivrement de l’extase ou du gai savoir, mais tout à voir avec une méchante biture, binge drinking ou alcoolisme du misérable. On s’avilit, on s’abrutit, métro-boulot-dodo-rototo, et là-dessus la formation sociale construit la fierté, la morale, les icônes et les dieux. Le poète a la tâche difficile de sortir de l’addiction, de dessoûler son être. Il doit pouvoir écrire à Zeus tout-puissant :
J’arrache le rêve délicieux
D’un Paradis pour tous[…] Les dieux ne sont plus nécessaires
Le livre de Mordillat est l’écrit d’un « réfractaire » qui n’a pas désappris l’art de se mettre en colère. C’est l’acte de résistance d’un enfant pirate contre les saints patrons de la bienveillance et du bien-être, grands contremaître de la performance sociale moyenne, grands managers d’endurance à destination des classes laborieuses et anonymes. Voilà « solo », dur et sec, farouchement indépendant. L’émancipation, c’est comme la pensée, ça commence par un non, et tant pis pour la bonne éducation, et, à tout prendre, tant pis même pour la bonne foi.
L’orage a ses éclairs.
Chaque jour tu te poses ce genre de questions : où vont, coude à coude, ces costumes, ces tailleurs ? Quel est le sens de leurs trajets pendulaires ? Chaque matin, chaque soir, ces femmes « [d]e raison corsetée », ces « employés modèles », ces étudiants, ces écoliers, où peuvent-ils bien aller ? Mordillat documentariste regarde, il note :
Ils vont
Ignorant les leçons de l’histoire
C’est dire qu’ils ne vont nulle part. Pour reprendre le titre du poème, ils vont « Cap aux morts », insouciants, sûrs de leur innocence. Or, toi et moi, nous marchons aussi dans cette foule « au pas cadencé », il est si dur de s’en extraire, nous sommes dedans. Jusqu’au cou ! Et depuis la naissance ! Nous sentons depuis toujours la sueur froide, à la fois fraternelle et rivale, pathétique et odieuse, de ces épaules pressées contre les nôtres, assujetties aux transports, ces épaules employées, entrepreneuses ou ouvrières, épaules creusées par l’airain du marché. On bosse, et on attend de passer à la caisse !
Mais le poète nous dit : jusqu’au cou ce n’est pas jusqu’aux yeux. Ce n’est pas jusqu’aux oreilles. Ce n’est pas jusqu’à la cervelle. Je peux émerger du « silence océanique », je peux reconquérir les traits de ma liberté : le « je » du solitaire, dans l’échange du poème, devient aussi le mien, lire-écrire sur autrui c’est devenir l’enfant qui rêve, devenir poète, devenir « Jacques Prevel », « Paolo Ucello », ou bien d’autres encore, peu importe les noms de ces encagés-vifs :
Comme lui je suis
Seul en compagnie
Une simple comparaison, et peut-être, peut-être que nous sommes sauvés : l’empathie, chez Mordillat, est l’émotion qui rallume le grand feu de la métaphore, c’est-à-dire le grand voyage de la matière jusqu’à la vie.
Faire une métaphore, c’est faire un saut « hors du rang » :
Elle dort enfin. Elle dort enfant.
Elle dort en fa. Elle dort en faon.
Elle dort en fille. Elle dort en fesses.
Émouvant miracle de « L’allitérée ». Jonglerie ? Oui. Virtuosité gratuite des signes ? Non. Le jongleour fait passer les éléments de parole les uns dans les autres, c’est un alchimiste qui intensifie les échanges, un physicien nucléaire qui brise, concasse et réassemble, si bien qu’autre chose rayonne, un animal sauvage frémit en plus d’un corps nu. Mais le processus métaphorique n’est pas qu’un fantasme : c’est une reconfiguration objective de nos désirs. Le moment où l’on se plonge dans la natura naturans des syllabes et dans l’harmonia mundi du chant poétique, le moment où ça nous chauffe au fond du four dantesque, ce n’est pas de l’ordre de la représentation, ce n’est pas du « foutre à blanc » selon l’expression désenchantée de Bernard Noël. C’est un changement révolutionnaire de toute l’économie politique de nos désirs : la chaleur du regard sur « elle » la fond, elle redevient fissible, chantante comme la roche, fragile, sa beauté surgit, fraiche, « tendre et rose », tremblante comme une forêt à l’aube. La poésie enrichit l’expérience concrète du désir. Alors à côté de ça, le grand collisionneur de hadrons n’est qu’une grosse quincaillerie préhistorique ! Et ce serait mal comprendre la puissance poétique que d’imposer là-dessus la question de la fidélité. Écrire un carnet de « Beautés » nues et plurielles n’est pas le symptôme d’une domination donjuanesque, c’est tout aussi bien faire « Retour à la bien-aimée », se retremper dans Pénélope, dans sa singularité, mais à neuf, toujours autrement. C’est casser les habitudes de « la conjugalité », réinventer l’amour contre les habitudes et la routine. Allitérer : réitérer la première fois.
Bien sûr que la poésie transforme objectivement la réalité : pour preuve, l’homme en colère est donc transmué en amoureux Éros, le jongleur en perpétuel e-jaculator !
L’oiseau plaisir
Lui serre le kiki
Mon sexe s’envole à tire d’ange
Lave sa plaie au ciel
Le jongleur Mordillat reprend à son compte le télescopage qui a toujours caractérisé cette parole : une gourmandise dans le maniement des mots, sans distinction de classe ou d’origine (« oiseau », « kiki » et « ange » cohabitent très bien !) vient rencontrer une tendance bouffonne à railler. Le Linceul du vieux monde est le livre d’un satiriste.
Beaucoup d’ouvrages saturent leur texte de mots d’ordre. Le mot « ange », par exemple, ou le mot « ciel », finissent par constituer chez certains auteurs de véritables trous noirs qui surdéterminent toutes les pages, toute l’écriture. Leur redondance monotone semblent annihiler la lecture : ils fascinent, stupéfient, comme les yeux de la Méduse. L’industrie de l’édition adore cet effet : les lecteurs, toujours facilement romantiques ou enclins à la spiritualité, en redemandent encore, et les auteurs, complaisants, sages et fraternels, acceptent timidement d’embobiner l’audience. On appelle ça la grandeur de la littérature, et il paraît qu’en dernier recours, on ne doit pas rire avec ça. Hé bien la contre-grandeur de ce Linceul, c’est de se moquer de cette noblesse angélique, de ces nappes de lumière censées annoncer la présence glorieuse de l’être-au-monde : le joker associe « l’oiseau » et « le kiki », et si ange il y a, ange il tire. Humour cru, peut-être, mais humour tout de même. Mordillat, semble-t-il, fait honneur à son lecteur en lui offrant une variété qui laisse le choix. L’homme du peuple est bigarré. Son poème est ouvert en ce sens simple qu’il n’enferme pas. Il conjure ses propres héros qui disparaissent à mesure qu’ils apparaissent.
Une fois enclenché le processus de la métaphore, né de la colère et de l’empathie, le désir poursuit son envol et la vie reprend son souffle : rythme du poème. Lire ou écrire transforme, intérieurement, objectivement. Avec Mordillat ce mouvement libérateur ne se fige pas. Il peut bien convoquer Ulysse, ce n’est pas le vainqueur de Troie qui l’intéresse : nous savons aujourd’hui que ce que l’on appelle révolutionnaire court le risque de tourner à la haine, au dogmatisme, au terrorisme. Mai 68 comme mythe, Deleuze comme icône, Marx comme statue : danger du glacis autoritaire et conservateur. Par bonheur, la temporalité des poèmes de Mordillat n’est pas linéaire. Comment l’écriture pourrait-elle séparer les époques comme s’il s’agissait de stations qui seraient quittes les unes des autres ? Le joueur de lettres en costume à losanges révèle le « magma incandescent » qui forme la pâte du monde : les « pôles », les « jours » et les « nuits » se rejoignent, « les mois, les saisons » se « rapprochent » :
Il n’y eut plus qu’un temps
Le temps T
La croix des amants terrassés
Le poète partage la même intuition que l’historien matérialiste dont Benjamin fait le portrait dans ses Thèses. Le temps n’est pas une frise, il n’est pas un anneau serpentiforme car chaque présent n’en a jamais fini de bondir sur le passé et le passé n’en a jamais fini d’appeler le présent. Le temps est plutôt une étoile dont les couches ne cessent de glisser l’une sur l’autre et de fluer l’une dans l’autre. Ce sont des énergies qui font l’amour, qui font la vie. Et c’est ainsi que le fauve aux milles tours ne cesse, depuis son profond navire, de tracer son parcours propre, et de nous mordre le cœur – rapide comme la lettre, à la vitesse d’un esprit qui s’efforce de ne pas oublier son histoire.
