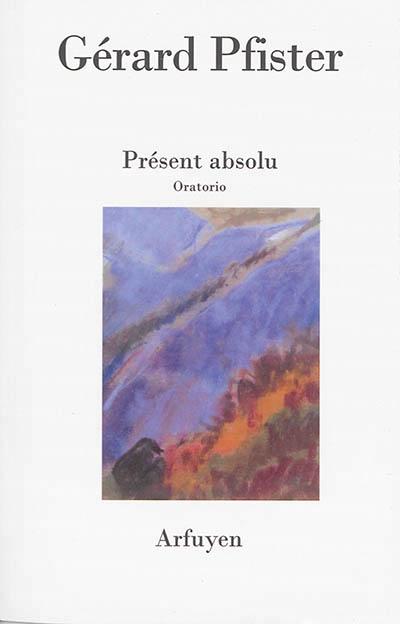propos recueillis par Jean-Claude Walter
Poète, traducteur de Maître Eckhart et de tant de poètes, éditeur de nombreux mystiques rhénans dans votre collection des Carnets spirituels, vous faites référence à leurs écrits dans votre roman Le Livre des sources. Pourquoi cet actuel retour aux textes mystiques du XIVe siècle ?
Maître Eckhart représente l’accomplissement de ce que le Moyen Âge a apporté à la civilisation. Son œuvre réalise une géniale synthèse des courants philosophiques et spirituels les plus divers, du néo-platonisme à l’aristotélisme redécouvert à travers les textes conservés par la tradition arabo-islamique. C’est un esprit ouvert sur l’universel, épris de liberté et, en même temps, profondément enraciné dans une expérience intense et singulière. Sa pensée dépasse les clivages entre philosophie et spiritualité, Occident et Orient, action et contemplation, et on peut se prendre à rêver ce qu’il serait advenu si la condamnation de 17 propositions extraites de son œuvre ne l’avait tout entière reléguée dans l’ombre jusqu’au siècle dernier. Nietzsche énumérait toutes les chances manquées qui ont conduit l’Europe à s’enfermer dans des névroses nationalistes dont on a vu encore au XXe siècle les conséquences meurtrières et dont elle n’est aujourd’hui pas vraiment sortie. L’occultation de la pensée de Maître Eckhart est certainement la première de ces occasions ratées. Là précisément se situe le point de départ de mon roman.
On trouve dans votre livre, selon vos propres dires « documents, lettres, témoignages » entretiens et citations. Pourquoi avoir choisi d’écrire ce roman – imposant par sa vision, son érudition et sa dimension (425 pages), si ce n’est pour favoriser l’accès aux grands mystiques des lettres européennes ?
Choisit-on vraiment d’écrire ce qu’on écrit ? Le premier texte que j’ai publié était un long poème, intitulé Faux. Dans cette suite de distiques brefs et heurtés étaient mis en relation la fausseté de notre rapport au monde – et à la langue même – et la faux sans cesse suspendue sur le fil de nos jours. D’autres formes d’écriture poétique sont apparues ensuite, en vers ou en prose. D’autres genres se sont présentés comme l’essai ou le théâtre. Avec Le grand silence, oratorio (2011), puis Le temps ouvre les yeux, oratorio (2013), une expérience très inattendue s’est fait jour, un mode de composition typiquement musical ouvrant à la langue de nouvelles possibilités d’exploration de notre présence au monde. Écrire, c’est découvrir sans cesse des formes, des rythmes neufs. Mais l’homme ne change guère, ni ses obsessions. Ce Livre des sources, est-il dans son secret propos si différent des premières lignes publiées en 1975 ? Eckhart, Tauler et les mystiques rhénans sont avant tout pour moi les figures d’une réflexion qui concerne notre époque, cette terrible et passionnante fin d’un monde à laquelle nous assistons, et participons.
Vous montrez, textes à l’appui, cette double utilisation d’un même langage : d’une part les écrits des Sages du XIVe siècle, authentiques et confirmés, sur lesquels repose votre démonstration ; d’autre part ce qu’en a fait la propagande d’intellectuels inféodés à la politique du pire – celle de Hitler. Comment cela fut-il possible ?
Les écrivains sont bien placés pour savoir l’extraordinaire plasticité de la langue, et particulièrement les poètes dont l’oreille est attentive aux infinies possibilités de chaque mot, chaque phrase – connotations, références, accentuations, sonorités – et qui, d’en faire usage avec lucidité, aident leurs lecteurs à en prendre conscience et en désamorcer les maléfices. « Donner un sens plus pur aux mots de la tribu » : c’est ainsi que Mallarmé voyait le rôle du poète. On en voit aujourd’hui plus que jamais l’urgence, dans une société où la langue est à tout moment prostituée au service des idéologies, des religions, des groupes de pression et de tant d’entreprises qui ont des produits miracles à nous vendre… On a vu bien des fois au cours des années récentes de solides intérêts économiques se parer de justifications humanitaires. Mais le pire est atteint, on le constate aujourd’hui à nouveau, lorsque des visées politiques se masquent d’un langage religieux. Car sont touchés alors des ressorts psychiques tellement profonds que tous les fanatismes apparaissent possibles.
Entre la communauté du Haut-Pays, et les mystiques, les manuscrits du philosophe Serge Bermont – personnage central de votre récit – et les commentaires de sa veuve, servent-ils de guide et de relais entre Histoire et fiction ?
Où est l’Histoire ? Où est la fiction ? On a pensé pendant des siècles que la communauté des Hautes-Terres avait réellement existé et, du jour au lendemain, sur la foi des travaux d’un philologue de la fin du XIXe siècle, on se convainc que tout cela n’a pas eu lieu Après la bulle pontificale de 1329, la philosophie d’Eckhart est oubliée pendant des siècles, et lorsqu’elle réapparait au XXe siècles elle est presque aussitôt récupérée par des idéologues totalitaires. Chaque époque écrit son présent et réécrit son passé selon l’image qu’elle souhaite avoir d’elle-même, et l’ « Histoire » n’est que la somme de ces constructions et ces réécritures. En mai 1968, je venais d’avoir 17 ans et j’étais au Quartier Latin comme tous mes camarades : qu’en ai-je vu de plus que Fabrice à Waterloo ? Le regard est partiel et passionnel, les souvenirs imprécis et biaisés, les documents douteux et lacunaires. Événements, légendes, fictions se mêlent de manière inextricable. Et, à tout prendre, sans doute le « mentir-vrai » du romancier, en montrant comment se tissent les récits, permet-il de mieux comprendre les frontières dangereusement mouvantes entre ce qui fait le quotidien et ce dont l’Histoire se souvient.
Et l’Ami de Dieu ? A-t-on des textes, preuves de son rayonnement ? Et Rulman Merswin ? Vous soulignez l’ambiguïté du personnage… Peut-on se fier à ses écrits, en particulier son Livre des neuf rochers que vous avez publié, traduit du moyen haut-allemand, dans les « Carnets spirituels » ?
Le corpus littéraire que nous ont laissé l’Ami de Dieu et Rulman Merswin est abondant et accessible. Il a eu au XIVe siècle un bien réel et très large rayonnement. J’en donne la liste complète en annexe de mon roman. Une partie de ces textes a été traduit en allemand moderne. Seulement deux d’entre eux ont été traduits en français, grâce au Jury du Prix du Patrimoine Nathan Katz, qui a attribué sa Bourse de Traduction 2010 à Jean Moncelon et Éliane Bouchery pour l’édition française du Livre des cinq hommes, de l’Ami de Dieu de l’Oberland, et du Livre des neuf rochers, de Rulman Merswin. L’ensemble des textes de l’Ami de Dieu est actuellement en cours de traduction et sera publié en un seul volume à la fin de l’an prochain. Sur la base du travail accompli, il sera possible alors de mieux comprendre ce qui s’est réellement passé et quel a été le rôle de l’étrange banquier Merswin dans cette aventure. Mais, là encore, il est probable que la part de réalité, de légende et de fiction reste longtemps indémêlable…
A travers ce foisonnement de personnages – réels ou fictifs – que vous animez ou à qui vous donnez la parole, citant les textes et les commentant, peut-on dire du Livre des sources qu’il s’agit d’un roman historique ?
Tout roman est historique. La Princesse de Clèves (1678), qui se passe à la cour d’Henri II, est un roman historique. Et La Chartreuse de Parme (1839) tout autant, dont l’action se déroule entre 1796 et 1815. Et pareillement La Recherche du temps perdu, même si le temps de l’action et le présent du narrateur finissent par se rejoindre. Tout roman est nécessairement inscrit dans une époque, ancienne, récente ou contemporaine, qui lui donne forme et couleur. Dans le Livre des sources, les personnages appartiennent à trois époques très différentes, dont le contexte politique et social est à chaque fois évoqué de manière bien précise. D’une époque à l’autre pourtant, les lieux sont les mêmes, dans une lumière inchangée, et les destins des personnages présentent souvent de telles similitudes que l’histoire semble bégayer. Comme le rappelait le neveu du prince Salina dans le Guépard de Lampedusa, « il faut que tout change pour que rien ne change ». Les cavaliers de l’Apocalypse parcourent l’Histoire en semant la frayeur et la mort, mais sur leur pesant heaume est posé immobile un oiseau bleu. C’est le sens que je donne à l’image de couverture représentant le minnesänger Goesli d’Ehenheim (aujourd’hui Obernai), si fameux en son temps et aujourd’hui oublié…
Dans votre « Note finale » vous posez la question : « Ont-ils existé ces hommes des Hautes-Terres, ou ne sont-ils que la projection de notre désir ? Ont-ils habité ces lieux terribles, ces repaires de solitude et de splendeur, ou bien les avons-nous rêvés pour eux, pour nous, comme un choix nécessaire, l’horizon inaccessible du livre ? » Par votre vision, érudition, écriture poétique, connaissance des textes fondateurs, vos personnages mis en scène et cet entraînant tempo romanesque, votre Livre des sources apparaît comme un guide indispensable pour affronter tant de problèmes en nos sociétés inquiètes, en ébullition ou profondément désorientées.
Gérard Pfister, Le Livre des sources,
éditions Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2013.
Entretien paru dans la Revue Élan, 3e Trimestre, septembre 2013, Strasbourg.
Jean-Claude Walter a publié des romans et récits, des recueils de poésie ainsi qu’une étude sur Léon-Paul Fargue (Gallimard, 1973). Il a récemment donné un essai intitulé Le Rhin : un voyage littéraire de Jules César à Guillaume Apollinaire (Place Stanislas, 2011). Cofondateur de la Revue Alsacienne de Littérature, il est l’auteur de trois anthologies sur les poésie alsacienne d’expression française. Il a reçu de nombreuses distinctions parmi lesquelles les prix Charles Vildrac et Cesare Pavese.