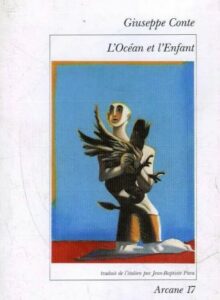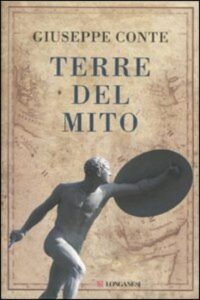Apporte-moi tes chants, Ô mer… : notes sur l’oeuvre romanesque de Giuseppe Conte
De Giuseppe Conte, poète ligure né à Porto Maurizio en 1945, le lecteur français connait peut-être davantage les œuvres poétiques que les romans. C’est ainsi que depuis la découverte des recueils disponibles en langue française L’Océan et l’Enfant (1983) et l’anthologie Villa Hanbury & autres poèmes (2002) traduite par Jean-Baptiste Para, j’en suis arrivée à m’intéresser à l’univers romanesque de Giuseppe Conte avec la lecture du Troisième officier (2007) et de La femme adultère (2008).

Il se pourrait que ces univers soient intimement liés. D’autant qu’au cours de ces années vient s’insérer la publication de Terres du Mythe (1994, « Arcane 17 »).
Le lecteur attentif retrouvera sans doute dans chacun de ces ouvrages ce qui fait la particularité de l’œuvre de Giuseppe Conte et l’originalité de l’univers dans lequel elle prend vie. Univers ancré dans la passion ternaire de la mer, des voyages et des mythes. Cette triple alliance a irrigué continûment lecture et écriture du poète. Ainsi découvre-t-on que les paysages d’Irlande ou d’Écosse ont donné au méditerranéen Giuseppe Conte la possibilité d’aborder aux mythes celtiques et scandinaves et de les accueillir au même titre et avec le même engouement que d’autres grands mythes issus de civilisations disparues. « Le mythe m’est de plus en plus clairement apparu comme étant une forme de connaissance », écrit le poète dans l’introduction de Terres du Mythe. Ainsi après Galway et les îles d’Aran en Irlande, suivent les Orcades d’Écosse et le mythe d’Odin, puis celui d’Aphrodite à Paphos. Viennent ensuite les mythes liés aux dieux de la Haute Égypte, ceux de l’Inde du Sud et enfin ceux des Indiens du Nouveau Mexique.
Voyager a toujours été pour moi l’expérience la plus forte et la plus stimulante, celle se rapprochant le plus du véritable sens de l’amour, symbolisant le mieux le processus mort-renaissance, celle la plus à même de m’entraîner aux frontières de l’invisible et du visible, du fini et de l’infini. Les plus grands livres à mes yeux ont été de véritables voyages…
De sorte que les livres assument « une fonction irremplaçable ». Celle de « portes, de fenêtres ouvertes sur la connaissance, sur l’essence même de l’univers, mémoire historique, mémoire mythique, Puits de tous les courants, de toutes les mers, cavernes, forêts, herbe et mousse, Menhir, Obélisque et Gratte-ciel […] » Ce n’est pas un hasard si « "liber" est à l’origine "la pellicule entre le bois et l’écorce des arbres"… (p.21)
Giuseppe Conte est donc aussi ce voyageur immobile que les livres accompagnent. Les siens, bien sûr et ceux des grands auteurs, ses maîtres. D.H. Lawrence, Henry Miller, Ernst Jünger… et les poètes. Le Montale di Ossi di seppia, mais aussi Yeats, Shelley, Blake, Whitman dont Giuseppe Conte a été le traducteur, et tant d’autres encore. Tous ont contribué à pousser le poète ligure vers l’exploration de rivages différents de ceux qui l’ont vu naître et vers lesquels, pourtant, sans cesse il revient. Porto Maurizio, l’éternelle Ithaque de Giuseppe Conte.
Ainsi peut-on lire dans une note du poète à l’édition de 2002 de L’Océan et l’Enfant (in Poesie 1983-2005, Oscar Mondadori, p.79), ces mots qui rendent compte du syncrétisme culturel et philosophique qui irrigue l’œuvre de Giuseppe Conte :
J’étais possédé par l’énergie implacable du chant, du recommencement, de la découverte, des symboles. Tout m’apparaissait comme la métaphore de quelque chose d’autre, à l’infini. Je découvrais que l’archétype éternel de la ville était pour moi Porto Maurizio, la petite cité ligure toute escarpée et hérissée de clochers, demeures et jardins parmi lesquels j’étais né et où j’avais grandi et je la retrouvais tandis que j’admirais les fortifications de Mycènes et de Tirynthe ou bien je m’extasiais de voir les surfaces miroitantes des gratte-ciels de Manhattan se dissoudre en fantasmagories de lumières, de fleurs, de feux sous la pression du couchant.
À partir de 1980, création romanesque et création poétique vont de pair. Primavera incendiata, son premier roman, voit le jour chez Feltrinelli cette année-là. De 1983 date la publication de L’Océan et l’Enfant dont Italo Calvino souligne l’importance quant aux nouvelles voies poétiques que l’œuvre explore.
Comment situer sur une carte des antécédents et des tendances la présence de ce poète que l’on dirait orgueilleusement solitaire et hors du temps ? » Quant à Jean-Baptiste Para, grand admirateur de l’œuvre de Giuseppe Conte, il souligne dans son introduction à Villa Hanbury & autres poèmes que la poésie du poète ligure « accueille en elle des figures du mythe, comme si les puissances numineuses des Grecs, des Celtes ou des Aztèques étaient des feux que les siècles avaient mal éteints.
Plongée dans la lecture de Terres du Mythe, je perçois comme une évidence la similitude qui existe entre la figure du poète et le saumon d’Irlande dont il découvre les rituels à Galway. Quel lien le saumon d’Irlande, « animal clé de la science sacrée de l’âme », peut-il avoir avec le poète ? Tout comme les saumons de Galway remontant le cours du fleuve Corrib jusqu’à sa source afin de renouer avec le principe de leur existence, le poète remonte le cours de la Voie de la connaissance ouverte par le mythe. Et d’aller ainsi à la rencontre du Chaos dans lequel s’origine le monde.
À la fascination éprouvée en Irlande (1981) devant « les murailles du château de Dun Aengus » vient s’ajouter la fascination exercée sur le poète par les alignements de Carnac. Laquelle ranime et augmente les souvenirs des îles d’Aran. C’est peut-être son long séjour en Bretagne – de 1987 à 1989, Giuseppe Conte vit et travaille à Saint-Nazaire à la Maison des Écrivains – qui inspirera au poète quelques années plus tard, l’écriture du roman Le Troisième Officier (2002). Roman qui se déroule dans un premier temps sur un voilier.
Ma lecture dans Terres du Mythe du chapitre premier consacré à l’Irlande, me le confirme. Lors d’une randonnée dans le Morbihan (« petite mer » en breton), Giuseppe Conte découvre les sites mégalithiques de Le Ménec et de Kermario, qui font partie des fameux alignements de Carnac.
Onze rangées de pierres alignées à perte de vue sur un terrain parfaitement plat qu’on dirait labouré par des dents de dragon, selon une absurde et précise géométrie » … « Le secret de cette forêt géométrique a sûrement un rapport avec le soleil. Chaque alignement délimitait peut-être le tracé de pistes magiques qui le guidait peut-être dans sa course, pour que du lever au coucher, il ne s’égare pas.

L’écrivain se souviendra sans doute de ce moment lorsqu’il rédigera le chapitre premier du Troisième Officier. Voici ce que dit le narrateur, Yann Kerguennec, quelques heures avent d’embarquer sur le Sainte-Anne.
J’étais parti de mon village proche de Carnac, bien décidé à trouver du travail en ville, avec un balluchon que je portais sur l’épaule– je ne me rappelle pas ce qu’il y avait dedans, c’était ma mère qui l’avait préparé. Je me promenais sans but, en attendant, et la ville me paraissait beaucoup plus grande que je ne l’avais imaginée ; la cathédrale était très haute, bien autre chose que les pierres alignées de Carnac, celles qui deviennent petit à petit plus hautes et plus grosses, et qui m’avaient déjà donné l’impression de se tendre vers le ciel avec la prétention, peut-être, de le rejoindre et d’aller toucher le soleil.
Roman d’aventures maritimes et roman de formation, Le Troisième Officier est aussi un roman d’idées qui se déroule sur fond de vérité historique. Quelle que soit la forme que prend la narration et où que se déroule l’action, sur mer et sur terre, l’idée majeure qui relie les trois parties du récit est celle de la liberté. Lutter contre les injustices, lutter contre l’esclavage, lutter pour que puisse advenir la liberté, telle est la quête poursuivie par Giuseppe Conte dans ce roman qui oppose en combat permanent le Bien et le Mal.
Rien de tel en effet que le huis clos d’un voilier pour voir se profiler le spectre des mutineries ; rien de tel pour des naufragés que la découverte d’une bande de terre pour inventer une utopie dont les contours s’effondreront sous les coups de butoir de la réalité.
Giuseppe Conte remet la narration de son récit entre les mains de Yann Kerguennec. Un demi-siècle s’est écoulé, qui sépare le petit paysan breton – qui embarque à Nantes à bord du Sainte-Anne à la veille de la Révolution, un 3 mai 1789 – du maître-charpentier adulte qui entreprend son récit dans une France sur le point de se soulever :
aujourd’hui 24 février 1848, où j’entends hurler et tirer dans les rues, et Dieu sait ce qui peut arriver… Elle renaît, la liberté et jamais aucun aspirant tyran ne réussira à l’ensevelir.
Le roman est une longue rétrospective narrative. Il s’ouvre sur un prologue en italiques. Yann Kerguennec brosse à grands traits l’aventure qu’il lui a été donné de vivre au cours de sa vie. Il conclut cet incipit par ces mots : « Je ne suis pas le personnage central de cette histoire. Ce n’est pas mon histoire que je veux vous raconter. »
« La République Libre d’Aldébaran » tombe dans l’anarchie avant d’être anéantie dans le sang.
S’il est vrai que le mot de liberté est dans toutes les bouches, il est parfois bon de « signaler que la nature humaine, par sottise et cruauté, peut transformer la liberté en crime et en infamie. »
Libertaire et utopiste dans ses romans, Giuseppe Conte peut être défini en poésie comme un antimoderne. La raison de pareil positionnement se trouve explicitée dans Manuele di poesia (1995). Car pour le poète ligure, « la disparition de la poésie des sociétés occidentales ne témoigne pas tant d’une crise de la poésie que d’une pathologie de ces sociétés mêmes. »
Viscéralement attaché à la pensée mythique, Giuseppe Conte n’a d’autre conception poétique que de commercer avec les Muses. Elles lui inspirent une poésie éminemment lyrique. En témoignent ces quelques vers, choisis dans le dernier quatrain du poème « Fidélité à la mer » :
Apporte-moi les chants, ô mer, fais que je
Trouve tes daims, tes pommes d’argent
Les touffes de bruyère sous le vent
L’abri de lune de ton dieu, Manannan
Mac Lir.
In L’Océan et l’Enfant, Traduction de Jean-Baptiste Para, Arcane 17, 1989, p.153