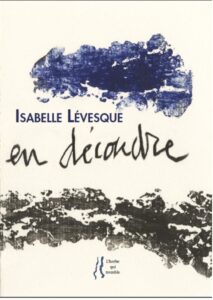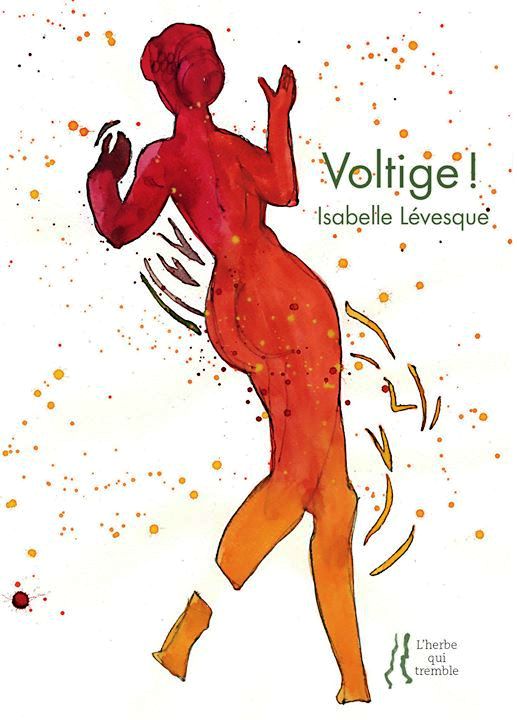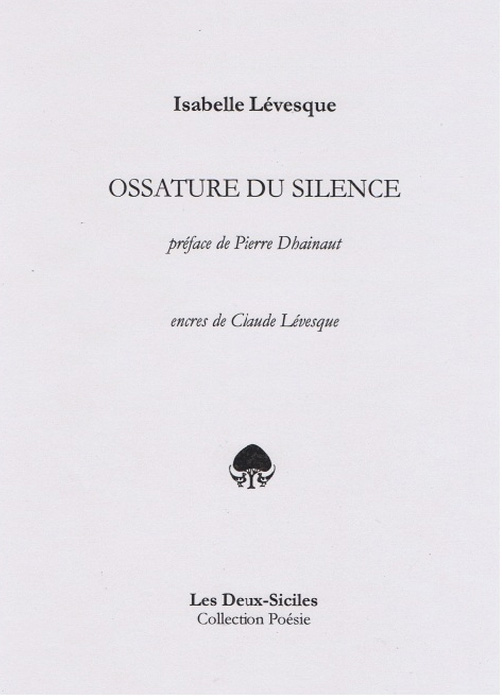La poétesse ne désire pas cristalliser le fil, à sceller le givre en glace immuable, d’une solidité confortable, peut-être. Elle cherche à puiser la force nécessaire à son poème dans la lecture qu’elle fait du givre, son regard glissant le long de sa sinueuse écriture primitive, son œil faisant du fil de givre un fil de lecture, compréhensible, déchiffrable, potentiellement transmissible et partageable.
Où la parole première ?
Flocon magnétique. (p. 53)
Le fil de givre tiré, fait fil de lecture, a naturellement pour vocation d’être partagé : de donner un livre, comme le présent recueil, bien sûr, mais préalablement, d’être conçu ensemble. Ainsi, la poétesse n’est pas seule dans ce travail. Du moins désire-t-elle le croire, se savoir vraiment épaulée, cheminant main dans la main dans une direction commune. Mais le plus souvent, la collaboration prendre la forme d’un corps à corps avec l’homme aimé. Solitaire corps à corps (cosmique) autour du duel corps à corps (amoureux). Le corps à corps épuise corps et âme.
Tu es en fleur
ou
presque
déjà
là
– tu es partout (p. 12)
Dans les 9 courts vers du poème suivant (p. 13), nous comptons 4 « tu » et un seul « nous » final. Effectivement, la présence sensuelle de l’être aimé envahit tout, perturbe davantage l’ouvrage (poétique et mémoriel) qu’il ne le favorise. Ainsi les écrivains sont-ils accompagnés, le plus souvent, eux qui se consacrent à un travail très solitaire.
Néanmoins, c’est le propre de l’amour de sublimer le temps en intensifiant l’expérience, quitte à se croire capable de « retenir le monde » ou d’ « attraper le soir. Rien n’est moins sûr. » (p. 14, là encore, l’auteure souligne). « Tu courais contre le temps », lisons-nous p. 18. La « lutte contre le temps » ne peut durer qu’un temps.
« Rien n’est moins sûr. » Après cette précoce prise de conscience, le nuage de « tu » se mue en un nuage de « il » (5 occurrences dans les 9 petits vers du poème suivant, p. 15), un pronom déjà plus distant, ou plus lucide.
Le pouvoir de l’amour devient ainsi une force ambiguë, contre laquelle la poétesse va devoir lutter, et déterminer si elle peut composer avec lui. Lutter pour le temps, restaurer sa place dans la vie. Ce faisant, comment ne pas lutter contre l’amour ? Question douloureuse et délicate, qui est peut-être au cœur du livre.
*
Comment retisser l’assise du temps pour refaire le monde, lorsque nous l’avons « défait » (p. 18), et que l’amour continue d’entretenir le désir, et réciproquement ? « Ce que nous fûmes résonne » (p. 19). Dans la relation amoureuse, si rapidement blesse la nostalgie !
Désir omniprésent, polymorphe, puisqu’il est semé par l’être aimé, lui-même « partout » (p. 12, déjà cité). Forme ignée, aérienne, gazeuse, ou aquatique, comme dans le poème de la page 20, teinté de mélancolie.
Les points écartés
à la surface changent l’écume en sel.
Comme en chemin retour vers son origine, l’éros perd de sa fertilité, et du sel naît une écume sans Aphrodite. Plus tard, il sera à nouveau associé à l’élément minéral :
Marche dans l’eau claire,
contre la pierre. Le sel (jadis : relief du ciel). (p. 53)
Mais l’élément aquatique est des plus mobiles (« L’eau des métamorphoses », écrit l’auteure, p. 52), car il sait se mêler aux autres :
Pour qu’une humide escale prenne terre
et féconde. (ibid.)
L’omniprésence de l’être aimé transforme la contemplation avec la matière mémorielle en confrontation avec lui et ses multiples traces, par lesquelles proprement il s’inscrit partout, et persiste longtemps, sans que l’amante ne parvienne véritablement à décider si elle désire ou non cette perturbation, puisque cette dernière est inhérente à la relation amoureuse. Les choses résonnent de sa présence, même s’il est absent.
Tu es passé, le bord-fossé discourt et
falaise, moitié craie, silex en aparté. La voix,
l’inaudible couché au pied du vaillant. (p. 21)
Là encore, le temps, réalisant la complicité entre les éléments, sera un puissant viatique. Car l’aquatique et la terrestre donnent le minéral : celui des falaises calcaire (cette eau solidifiée, un peu friable) auprès desquelles vit l’auteure.
L’eau prise en sortilège.
L’érosion n’a rien suivi
du maritime attrait d’un massif poli. (p. 53)
*
Écrire, si c’est pour relancer le mouvement entraînant de la vie pour réconcilier ses aspects, passe désormais par la lutte. Oui, la danse s’est faite lutte.
« J’oublie, je cogne. » (ibid.). Il faut oublier pour mieux écrire, mais il est impossible d’oublier lorsque l’autre vous rappelle sans cesse à son souvenir, contrariant et favorisant en même temps la volonté poétique. « Portant haut les mots, tu lisais les poèmes. Tu secouais mes ombres » (ibid.). Si bien que l’amante entend « un mot cogne pour conjurer l’oubli ».
Or, écrire de la poésie n’est possible qu’à partir d’une dilatation silencieuse des sens, ouverts sur le monde et ses manifestations. La poétesse se retrouve ainsi à combattre sur tous les fronts, entre voix et silence, activité et passivité : préservant sa capacité contemplative (les poèmes sont marqués, par exemple, par de nombreux marqueurs saisonniers, jusqu’à l’hiver, et au-delà – p. 25), méditant sur le rôle de sa relation amoureuse, débusquant les ombres pour mieux les accueillir en son sein (p. 23). Autant d’aspects qu’elle composera en un bouquet subtil – « fleur » du sexe masculin (p. 12), « coquelicots » fétiches follement cueillis (p. 18 et p. 34), « jacinthe » et « jonquille » annonçant le printemps (p. 25), « lys immaculé » enluminant le recueil de poésie –, avant que ne prenne le pas, jusqu’à la fin du livre, un herbier plus primitif, composé de simples – « feuilles », « herbes », « lierre ».
*
L’auteure « cogne » pour oublier, afin d’écrire. À l’approche de la fin de l’hiver, c’est-à-dire à l’approche d’un nouveau cycle vital, pour espérer elle aussi participer au nouveau printemps qui doit venir, elle doit
Battre le vent
Frapper fort » (p. 25),
jusqu’à trancher l’hiver.
Pour que le soir ne soit pas
la fin. (p. 48).
Mais alors, c’est elle qui « saigne, flanc touché » (ibid.). Dans le danger de l’extinction, la possibilité d’être non seulement traquée mais chassée, l’idée du « fil de givre » (p. 39), aussi précaire paraisse-t-elle, ne peut pas encore émerger. Dans ce poème, la métaphore cynégétique pour évoquer la relation amoureuse prend tout son sens. « J’écris je saigne ici, flanc touché, le chasseur et sa proie. » (p. 25).
Nous comprenons aussi que deux amours s’opposent, cherchent à cohabiter : celui de l’homme et celui de l’écriture (d’où naîtra l’idée de co-écriture).
Le printemps renaît, comme doit revenir l’écriture.
Elle écrit. C’est sa vie[…]
Ce qui cesse commence. (p. 62)
Ce mouvement cyclique positif s’oppose au cycle négatif de l’éternel retour, pas celui de Nietzsche, celui des mensonges. Celui-ci, par exemple :
[…] au risque du songe, nous écrivons
l’histoire qui n’a pas commencé. Éternel aveu fossoyé par le passé. » (p. 60)
Il apparaît alors que le recueil retrace à sa manière, comme une histoire, la dialectique de l’élaboration poétique, faite de moments négatifs et de dépassements successifs. La proie seule n’est jamais chantée, elle l’est avec le prédateur. L’hiver n’est pas vainqueur, sans la tiédeur future du printemps. Etc. Et réciproquement. Dans un poème, « je saigne », le vent battu et la « flamme » de l’ « ici » (p. 25) donnent dans un autre en écho le « tu saignes », le « Il bat » et le « nous brûlons » (p. 40).
*
Après cette acmé des poèmes des pages 24 et 25, un pas est franchi, la violence retombe.
Pas de taille
à regarder venir
le pire. (p. 26)
Les amants ont « trop filé le noir » (p. 28), il faut se confier à « la graine promise » (p. 27) de l’espoir d’un printemps. La nuit embrassée au début du recueil, du moins honorée (p. 14), cède du terrain au jour, au supposé « Matin clair, dis-tu » (p. 30). « Braise effraie. Rompt la nuit. » (ibid.).
C’est dans ce contexte plus favorable, mais avec la blessure au flanc, que doit se recomposer, à nouveau frais, le tissage de la langue poétique, sa laine nuageuse.
Pour l’heure, « Rien de plus indicible que le mot sans lettre en gorge. » (p. 25). C’est que la douleur est un savoir, fait de « silence », ce précieux « secours » (p. 30). Mutique, « Sans question » le poète reçoit « Réponse » (ibid.).
Ainsi, l’aventure se poursuit depuis le « Silence plus grand que l’ombre » (p. 36), depuis une sorte de tabula rasa du langage. Silence, puis « murmures » (ibid.). Tout est à recomposer, il s’agit de « relire notre histoire » (p. 32). Mais rien n’est à créer, car tout est déjà présent, sous les cendres ou la neige : il ne s’agit pas tant de créer que de ramasser et rassembler auprès de soi.
La poétesse reprend d’abord la conjugaison et ses groupes (verbes des trois groupes, verbes réfléchis et irréfléchis) :
Les murmures épellent les verbes par groupes :
se blottir arriver joindre.
Puis elle rassemble autour d’elle les lettres, « voyelle » et « consonnes », pour susciter la renaissance du « son » (ibid.), le son articulé né de leur alliance.
Sur cette base fragile, dans le lexique du lien qui est au cœur du recueil, il est possible d’envisager encore l’être ensemble, le « nous », et son homonyme à l’impératif, « Noue » (p. 33), qui est aussi son quasi synonyme.
Nous sommes,
loin d’une apparence trompeuse,
noués à l’herbe. (p. 37)
*
Avec cette laine cardée, cette relation rafraîchie du langage, le mystère de la réalité sensible, « indéchiffrable » (p. 38), revient envahir la poétesse. Elle l’avait effrayé avec ses frasques, trop loin de lui, « Comme et si loin. » (p. 24). C’est par lui seul que peut se nouer le fil de givre, car il se manifeste sous la forme d’un « paysage nu confondu [qui] brusque notre mémoire. » (p. 38) : un poète n’est relié avec lui-même que lorsqu’il est relié au mystère de l’être.
La relation amoureuse, quant à elle, peut à nouveau s’écrire, redevenir l’apparence d’une écriture, une histoire commune, avec son langage propre, mutique lui aussi. « Je t’embrasse. » (p. 39). Le « Fil de givre » serait-il cet invisible dans la relation, qui relie, la Relation même, impalpable, qui entoure (ibid.) ? L’amour dit avoir retrouvé son vrai mystère.
*
Pourtant, un nouveau moment négatif survient par surprise. Le retour de la force amoureuse se fait à nouveau au détriment des conditions du travail poétique : « j’ai perdu le fil. » (p. 40).
Et le jeu reprend entre l’amour de l’homme et celui de l’écriture, un jeu douloureux, laborieux, beau, presque jamais simple, puisque en même temps l’autre, qui aime le poème (qui aime l’amante au travers de ses poèmes ?) lui aussi (« lisait les poèmes », p. 22), peut encourager à écrire :
Tu veux. Des poèmes.
Je m’attelle. Tu souris. Alorspossible. (p. 31)
*
Les termes de la réconciliation doivent à nouveau être posés. Comment approcher une « guerre vaincue » (p. 47), quand « les armes cesseront leur fracas » (p. 49) ? À ce stade, la solution semble se situer dans l’invention d’une forme de co-écriture. Celle-ci existait déjà, mais sous le mode plus distendu, moins construit, voire ambivalent, de l’incitation à écrire. Une écriture à deux mains serait possible, comme nous parlons de « piano à quatre mains ».
Nous écrirons
la fortune faite du songe.[…]
Tu caresseras le projet, corps
vestige, nous serons singuliers. (p. 46)
Et plus loin :
Et nous ferons poèmes par bribes (p. 48)
Écriture volumineuse, patiente, douce, déjà plus picturale, car elle a le goût des couleurs, au-delà des nuances du gris, que l’on pose par touches successives, à commencer par le « bleu », cousin du noir d’encre :
Nous poserons le bleu, ses gouttes vives
étonneront la braise (ibid.)
Écriture où chacun doit trouver, avec et grâce à la tolérance de l’autre, sa pleine place. Situation presque impossible, soumise à la vive menace d’être « l’indistinct » (p. 50), une menace que lance l’être aimé aux pires moments, ou créant ces moments les pires, comme une malédiction, revenant « sans fin » (ibid.).
« Le bleu » juste posé disparaît alors (« – Où est ce bleu, nuance du soir […] ? », p. 51). Par amour, la poétesse ne cesse de tenter de faire entrer la voix aimée dans son chœur, tantôt avec tous les outils poétiques, tantôt en s’en débarrassant – dans les deux cas, par amour. Si bien que se construit un grand poème amoureux, un courageux hommage. Un poème courtois écrit pour son guerrier par sa dame. « Chagrin des heures, portant belles phrases – poèmes mêlés, pas de roman. » (p. 55).
*
« Aimer tient en un verbe rond. » (p. 62). Finalement, ce rêve d’un accord entre les deux amours (l’homme et de l’écriture) s’avère comme tel impossible, car il ne constitue pas une réconciliation – comme s’il y avait une paix initiale –, mais un contrat soumis aux aléas de la vie. Il s’agit d’un ouvrage toujours à reprendre, et donc à confier à l’espérance, à l’ « escale » à venir : « ils deviendront. » (p. 52).
De sorte que la dialectique de négociation, rang après rang, a tramé toute une écriture, généré tout ce beau livre – a été porteur de poésie. N’est-ce pas l’essentiel ? La poésie n’est pas aussi vive que lorsqu’elle est inquiète.
« Rassembler les ténèbres feintes ». (p. 58) Le poème se hâte de tout rassembler autour de lui, à largeur humaine des bras, espérant l’apaisement universel. « La pensée des feuilles nous rassemble » (p. 59). Le recueil en dépend. Il n’a pas d’autre sens. Mais lui aussi doit avoir un terme (« Trop vécu le livre », p. 58), et l’inventaire s’impose :
Je n’oublie ni la mer
ni la roche,
je n’oublie pas le chemin[…].
Je n’oublie aucun geste. (p. 57)
*
En dépit de ses secrets, le livre d’Isabelle Lévesque déjoue pleinement le mythe fallacieux de l’absence de capacité narrative de la poésie. Son livre est un livre d’aventure, un conte lyrique (p. 56), une fable amoureuse, un poème biographique, un récit initiatique, un livre proposant naturellement plusieurs niveaux de lecture, où chacun peut trouver un fil à lui, à tirer vers lui, mystère à la clé.
C’est un don qui nous est fait, celui de l’espoir lucide de demeurer ensemble tout en restant soi-même, encore et malgré tout ; d’aimer sans démesure (« Nous ne graverons aucun signe pour durer », p. 63), mais infiniment. « Nous resterons unis. » (p. 59).
Oui, de vivre ainsi, avec, rassemblés et mêlés, ces trois aspects : aimer et écrire ensemble, cheminant à deux vers l’origine, qui n’est que lettre, aussi première soit-elle : « nous rejoignons l’initiale » (p. 62, dernier poème).