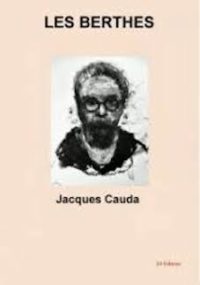Jacques CAUDA, Fête la mort !
Quelle légèreté (pourquoi pas) inventer à la mort -ce boulet chevillé à nos corps périssables-, bravant l’idée d’une éternité post-mortem, franchi le sas d’un purgatoire inutile ? (comment pourrions-nous confesser nos éclats obscurs, nous pauvres barboteurs peu aptes à nous connaître nous-mêmes et, dans quel intérêt ?).
Fête la mort ! déjoue avec jubilation l’idée « théseuse » que l’on veut bien nous faire, à nous communs des mortels, d’une vie dont le postulat serait un memento mori tragique ; la déjoue pour nous rejouer la mort comme une fin de partie festive. Cauda ne nous emmène pas ici au Mexique ni au sud-ouest des États-Unis pour une Día de los Muertos (Fête des Morts) ni ne nous invite à courir l’Halloween, mais tous saints et diables(ses) confondus (nettoyés de leurs oripeaux culturels) nous plonge « sans crispation » dans une contrée où la vacuité (et non la vanité) de notre vie terrestre fête la mort et (se) la fait. À l’instar de Petit Muscle ami d’enfance du Gilles (de Watteau, auquel l’adolescent narrateur se plaît à ressembler dans son accoutrement vestimentaire), lors de célébrations masturbatoires. Saucisson, Petit Muscle et le narrateur habitent la Cité (alors que « le monstre prenait forme ») et se donnent à cul joie pour transgresser les interdits de toutes sortes, brutes, « assassin(s) en devenir » ; pour défrayer la routine en révolutionnaires jusqu’au-boutistes non effrayés par les « pendus à la lanterne ». Fête la mort ! croque la vie : la mort, nue, « le cul bien ouvert », en célèbre les délices : les supplices (« divin supplice ! ») avec une jouissance transgressive promue comme un art de vivre (ou de mourir ! ).

Jacques CAUDA, Fête la mort !, éditions sans crispation en partenariat avec le magazine Litzic ; 2020, 144 p., 14€.
La blancheur immaculée du drôle de Gilles (Cauda ? ) injecte son venin dans toutes les ouvertures du monde en pinçant les cœurs pour tenter d’en extraire le jus (de viande) et l’agonisante extase fiévreuse.
D’une plume assumant la perversité (à la G. Bataille ou Sadique) de ses délits livrés au Dire (maux dire), le narrateur fait son Jacques et décharge avec son humour coruscant le venin débordant de Cauda, en brouillant les pistes du « grand tapis de la vie », déroulant simultanément celui de la mort sous ses propres pas de course narratifs amorcés demain, relayés hier : « Ce fut une journée merveilleuse que je ne raconterais pas aujourd’hui. Non. Je la raconterais hier, avant-hier même (…) ».
Fête la mort ! « mécrit » d’entrée une journée particulière « comme si elle avait lieu la veille » : celle où le trio dévoyé pose ses bombes « chez une jolie russe prénommée Sonia », à la Noël 1972. Une journée particulière où la fête chez Sonia devient une fête (de/pour) la mort, « immonde et magnifique ». Le lecteur retrouve le sublime caudesque. La fusion des extrêmes ouvre la brèche des ténèbres et de l’extase, Cauda pratiquant ce rituel expiatoire et infernal comme il trucide de ses pastels gras ou de son outil la blancheur d’une réalité en perpétuelle recréation, qu’il Sur-figure, chevauche et éclaire d’un jour nouveau en y injectant « par simultanéité d’actions » « les meilleures peintures d’histoires » (Nicolas Poussin, Brueghel, Le Brun, Renoir, Vermeer, Goya, … passent sur cette toile scripturale, table de travail du « Peindrécrire »). Sur la table de crucifixion Cauda peint/écrit croque ses histoires ses personnages la vie la mort « pris sur le vif », évidés de leurs viscères… Provoquant antipathie ou sympathie, Fête la mort ! agit comme l’œuvre caudesque telle la ronce sur la morsure des vipères, telle la mort sur les morsures de la vie. Elle darde, décharge son venin, âmes sensibles faire face !
Lorsqu’on fait un portrait, et a fortiori le sien propre, il y a trois manières
de poser un visage : ou de face, ou de trois-quarts, ou de profil. De face,
le portrait regarde son semblable, c’est-à-dire la mort droit dans les yeux.
De trois-quarts, il regarde Dieu, l’éternité, l’infini. Et de profil, sa
postérité, comme Érasme peint par Holbein regarde son acte d’écrire .
Via ses 10 récits ― celui du trio Petit Muscle-Saucisson-le narrateur ; celui de Paul -mise en abyme du geste créatif (« la porte n’étant jamais complètement fermée, c’était pour moi une invitation » comme le Paul ou les oiseaux d’Artaud ou Le chef-d’œuvre inconnu de Balzac) ; celui du cru bouillon de l’enfance mettant en scène Simone/Pierrette et Mèrepute-Crevette-Salope et où les survivants sont « destinés à peupler l’âme » du narrateur (« J’étais contraint à assister à leur horrible souffrance menée longuement jusqu’à leur mort »), … autant d’histoires que de personnages dégoulinant les uns sur les autres, voyous, « filles sans être », … ― Fête la mort ! constitue une Ovation créatrice faite à la mort : à la vie. « Sois ta propre ovation ! Ordonne-toi et frappe ! », lit-on page 42. Cauda frappe dans la grande lessiveuse du Vivre, insatiable. Métamorphique. Effroyable. Passage réversible du « rêve apollinien » à « l’émotion dionysiaque ». Orgiaque. Surfiguratif !