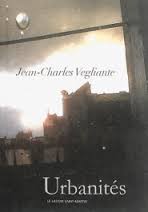Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant…
Nous savons que le mot « rose » peut éveiller, mieux que sa savante description, au delà même de sa « réminiscence » plus ou moins sentimentale, la surprise neuve de « l’absente de tous bouquets ». C’est que sa « presque disparition vibratoire », le quasi-mutisme du mot – conformément ici à l’étymologie – va (re)créer une réalité différente, immatérielle et efficace pour qui veut bien la lire, agissante, plus durable enfin que les êtres et les objets caducs qui nous entourent et parfois nous rassurent. Le poème « fait » (réalise), dans tous les sens, précisément ce qu’il « dit » (énonce) : souveraine présence au monde alors, que son énergie interne continue de soutenir. De ranimer pour chaque nouvelle lecture. Il est, affirmait déjà Dante Alighieri, une pure invention, une fiction, certes, mais construite, fabriquée, forgée (poïta) avec musicalité et suivant les règles esthétiques (alogiques) du langage : « fictio rhetoricâ musicâque poïta » (De Vulgari Eloquentia, II, iv, 2). Touchant donc à l’action, et même à l’action future « en avant » (Rimbaud), que l’on pourra reconnaître ensuite sans l’avoir jamais rencontrée ni conçue. « Je suis une flamme qui attend », écrivait Palazzeschi en 1910, alors que la folie guerrière couvait déjà. Fragile action, compromise parfois par l’ivresse du jeu, mais jamais abolie ; du moins lorsque l’invention est soutenue par l’enérgeia et le rhuthmós, ces ingrédients internes pour une « présence » manifeste – que la traduction (texte de destination) s’efforce non pas de singer, de réinventer à sa manière.
- La poésie, le disparaissant…
(Ballade)
Ah larmes, ah douleur :
la vie passe et se dissout et s’enfuit,
comme glace aux chaleurs.
Toute hauteur s’incline et rend à terre
tout solide soutien ;
tout royaume puissant
en paix enfin tomba, grandi en guerre,
et comme rais l’hiver ternit, et meurt
la gloire des splendeurs.
Et comme alpestre rapide torrent,
comme un éclair soudain
en nocturne serein,
comme brise, fumée ou dard filant
s’envole renommée, et chaque honneur
semble fragile fleur.
Qu’espère-t-on, qu’attend-on désormais ?
Après triomphe et palmes
ne reste plus à l’âme
que deuil, plaintes et larmes désolées.
De quoi sert l’amitié, de quoi l’amour ?
Ah larmes, ah douleur.
T. Tasso, Torrismondo [1586]
Horloges à roues, à poussière et à soleil
Celui qui vole et trahit la vie des autres,
le voilà tournant, condamné sur cent roues ;
lui qui transforme les hommes en poussière,
d’un peu de poussière on le mesure et noue.
Et s’il assombrit de ses ombres nos jours,
lui-même au soleil en ombre se résout ;
apprends par là, mortel, comment sur la terre
dissolvent toutes choses Temps et Nature.
Sur ces roues-là il triomphe et il glisse ;
de sa poussière il voudrait t’aveugler ;
et parmi cette ombre il médite ta perte.
Sur ces roues-là il torture tes pensées ;
dans sa poussière il inscrit tes délices ;
parmi cette ombre, ombres de mort il verse.
Giovan Leone Sempronio, La Selva poetica (1633)
Stabat nuda aestas
En premier j’entrevis son pied mince
glisser sur les aiguilles sèches des pins
où bouillonnait l’air avec un grand
frisson, comme une flamme blanche diffuse.
Les cigales se turent. Plus rauques
se firent les ruisseaux. À foison
la résine suinta par les fûts.
Je reconnus le serpent à son odeur.
Dans le bois d’oliviers je la rejoignis.
J’ai vu les ombres bleuâtres des rameaux
sur le dos sinueux, et les cheveux fauves
onduler dans l’argent de Pallas
sans un bruit. Dans les chaumes, plus loin,
l’alouette bondit du sillon fauché,
l’appela, l’appela par son nom là-haut.
Alors moi aussi je dis son nom.
Je la vis se tourner, vers les oléandres.
Elle entra comme en des moissons brunes
au milieu des joncs, vivement refermés.
Plus loin, vers le rivage, parmi la paille
marine, un faux pas lui fit tordre le pied,
tomber étendue entre le sable et l’eau.
Le couchant moussa dans ses cheveux.
Immense elle parut, nudité immense.
Gabriele D’Annunzio, Alcione, 1903 (une version
légèrement différente dans Po&sie 56, 1991)
Le port enseveli
Mariano, 29 juin 1916
Là parvient le poète
puis il retourne à la lumière avec ses chants
et les disperse
De cette poésie
me reste
ce rien
d’inépuisable secret
G. Ungaretti, Il Porto Sepolto, 1916
Mais c’est vrai pourtant qu’aux vieux,
dépouillés de la beauté,
reste ce signe, dans l’âme,
de son rapide apparaître
et disparaître, ce sillon de chose
qui a été, qui saigne encore,
lourde, dans la conscience ;
mais qui, goutte à goutte, ensuite
va lentement s’enfonçant dans une presque,
dans une presque rancœur
de blanche innocence…
C. Betocchi, Poèmes épars [1965-70]
Le froid ça fait peur et le sang aussi
la mer a des sources empaillées dans la secrète
splendeur de son écroulement : le froid
ça fait froid et le chaud ne se montre pas pour
trahir ses camarades.
Esseulé le froid adore la chaude
saison mais sévèrement est interdit de se crever
par les choses basses et c’est pourquoi éclairante
se fait la ressource du pauvre : tamiser
l’univers en vue d’un repas.
J’ai froid aujourd’hui et je ne sais pourquoi dans le
cœur se tamise une nouvelle aptitude :
celle de s’en ficher du lendemain : mais
il n’est pas vrai que le lendemain soit sûr
et il n’est pas vrai que l’aujourd’hui est calme.
Amelia Rosselli, Documento, 1976
Morts
J’ai écrasé des herbes plutôt tendres,
j’ai livré passage à des voix diverses,
et j’ai vu
avec quel sacrifice nous peuplons nos corps
et nos pas qui diminuent.
Attirés par quelques mots et insouciants
comme si nous étions déjà les autres parmi eux,
comme si nous étions loin
de tout avertissement et de toute étreinte.
Nicola Ghiglione, Ritmi (éd. F. De Nicola, 1983)
La voix des ancêtres
1.
Le soleil d’hiver fait obstacle au chant
qui se brise contre sa barrière
tiède. Comme dans le désert tu attends
la nuit glaciale, c’est du froid
que renaissent les chants assoupis
dans le tiède hiver de Rome.
Comme du désert dans le froid
avant la nuit se chuchotent des chants
plus hauts peu à peu, miaulements
sur les violons des femmes.
28.12.1987
2.
Affleure dans l’Europe de mars
après plusieurs naufrages
après avoir perdu ses dents sur les rochers
jaillissent les notes et puis s’abattent.
28.12.1987
3.
Aimée, je veux qu’ils nous écoutent
qu’ils entendent le gargouillis que je ne retiens pas,
comment se forme le chant
comment il se calme dans la poitrine
comment il peut sectionner la gorge,
comment la langue s’est épluchée.
28.12.1987
Antonio Porta, Yellow (2002, version rectifiée)
(un inédit)
Le marchand de fruits pouillais
célèbre dans le quartier
pour rester ouvert même en août
s’en est allé, je ne sais si dans l’autre monde
ou aux Seychelles ou aux Maldives,
en tout cas pour jouir du très mérité
fruit de sa sueur.
Jusqu’aujourd’hui le trou de sa boutique
n’a pas été obturé
si bien que ce tronçon de la rue Tadino
où Clemente Rèbora a habité
avant de devenir prêtre
a quelque chose d’incertain, d’inachevé,
de mélancoliquement hésitant
comme le sourire d’un brèche-dents.
G. Raboni, Altri versi [2006]
Augenlicht
... miro este querido
mundo que se deforma y que se apaga
en una pálida ceniza vaga…
J.L. Borges, Poema de los dones
I.
C’est comme de se trouver à l’intérieur d’un jeu vidéo
et d’être l’ours, le grizzly que l’on vise ;
à chaque coup du laser qui rapièce,
un éclair vert, un élancement subtil.
Le microscope fouille, met au point
la rétine déchirée, et tu contemples
une lande lunaire, une plaine toute fendillée :
tu peux penser, si tu veux, aux Fissures de Burri.
II.
« L’œil est un organe clos, mais keine Angst,
la légère hémorragie devrait se résorber. »
Elle ne se résorbe pas, non, et voici alors
des hippocampes, des ombres chinoises,
de volantes figures noires et étranges.
Mouches volantes ? Tu parles,
plutôt de gros corbeaux aux ailes déployées.
Techniquement, eine massive Blutung.
III.
Une poix tenace
bleuâtre et jaune encrasse le cristallin :
si tu bouges la tête, si tu tournes le regard
tout dans l’œil se met à mixer
et une partie du monde se dérobe.
Quand apparaît un nuage
très noir, effiloché,
et dessous, le long du bord,
des éclairs qui fusent
en lignes horizontales,
il n’y a pas de temps à perdre
c’est au chirurgien d’intervenir.
IV.
Avec grâce l’Augenschwester
libère ta joue des pansements, soulève
la coquille en plastique, la gaze, entrouvre
les cils encombrés de pommade et de sang :
merveilleusement
tout retrouve sa place, le plafond,
la fenêtre, les maisons, les collines
là derrière la haute tour qui se dresse
vers le ciel, à Züri West.
Pietro De Marchi, La carta delle arance, Bellinzona, 2016.
- Et son énigme
Peut-être un matin allant dans un air de verre,
aride, me retournant, je verrai se produire le miracle :
le néant dans mon dos, le vide derrière
moi, avec une terreur d'ivrogne.
Puis comme sur un écran se camperont d'un jet
arbres maisons collines pour la duperie habituelle.
Mais ce sera trop tard ; et je m'en irai en silence
parmi les hommes qui ne se tournent pas, avec mon secret.
(E. Montale, Ossi di seppia, 1925)
. . .
Qu’est-il arrivé, la plage était vide et maintenant
je vois quelqu’un assis, là là sur une pierre.
Un dieu y est assis et il regarde la mer en silence.
Et c’est tout.
[1911-12 ?]
Giorgio de Chirico, Poèmes Poesie (éd. 1981),
écrit directement en français
toi !
réentrai née parla main(on)
Giancarlo Majorino, Provvisorio, 1984
* * *
un dieu se jette continûment sur nous.
Pour cela tu pleures, tu ne dors pas la nuit,
tu vois les champs par les files de vitres botaniques
se défigurer, le blé transformé en sombre tabac,
des sables soulevés en amas pour couvrir l’azur
très tendre.
– Grand Jardinier, chef (instamment je demande),
Étant donné l’irrécupérabilité de tout ça, sera-ce possible
De le changer en un futur d’eaux et de plantes pérennes…… –
Remo Pagnanelli, Le Poesie, 2000 (posthume)
pour une poétesse analphabète
Maintenant dans sa vieillesse
la tension des vers
enfermés entre les parois des os
augmente. Vivante est l’image
des lettres tracées il y a une vie.
Mais le crayon se brise
sous l’étreinte des doigts enflés.
Qui n’obéissent pas.
Autres étaient les devoirs
des filles des paysans
et durant des siècles l’écriture
privilège de quelques-uns.
Claire est la poésie
dans l’enclos de la mémoire.
Elle y restera encore un peu
puis s’en ira en même temps qu’elle.
Barbara Pumhösel, Prugni, 2008
ils s’orientent
apparemment
à l’intuition
sans cartes ou croquis
ne demandent pas
d’indications
flegmatiques
ne donnent jamais l’impression
de se perdre
maîtres d’eux-mêmes
et sur leurs gardes
en chaque situation
ils errent
dans les zones industrielles
aux marges
des habitations
apparaissent
dans la brume épaisse
sur les berges
hauts sur l’horizon
défilent
sombres et solennels
par les nuits claires
on les voit
sortir des wagons
qui gisent
abandonnés
aux dépôts
des gares
ils s’engagent
le long des voies
et disparaissent
dans le lointain
on les aperçoit
ensuite des trains qui passent
apparaissent
dans la vision
et en un instant
comme animaux sauvages
s’évanouissent
Italo Testa, i camminatori, 2013
____________________________________