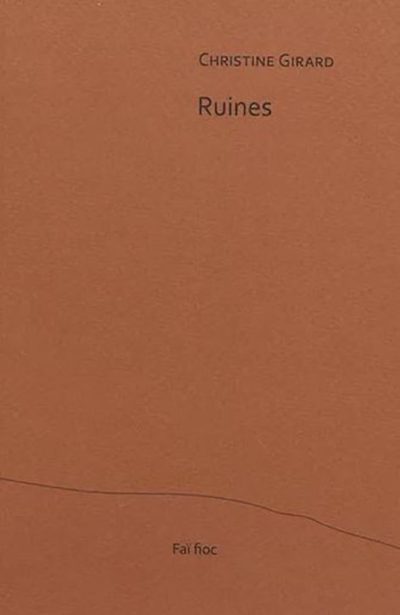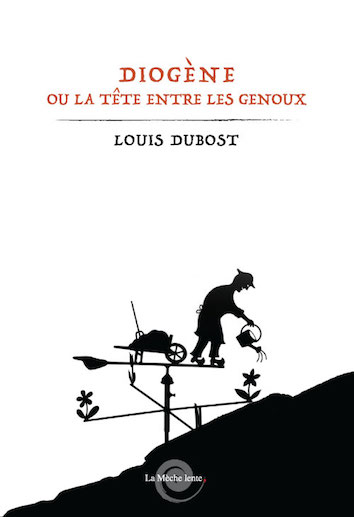Chronique du veilleur (47) : Jean-François Mathé
« Les mots, souvent, sont des yeux fermés / qui regardent la nuit en eux », écrivait Jean-François Mathé dans son très beau petit livre : Vu, vécu, approuvé, paru en 2019 aux éditions Le Silence qui roule. C'est dans cette nuit que le poète s'aventure, en appréhendant la nuit du dernier soir, celle qui clôt les paupières pour toujours.
Ainsi va est écrit dans la même tonalité. Le regret traverse les jours qui restent, avec le consentement que le titre même évoque. Ce sont, dit le poète, « les jours de rien », « de rien sans l’amour qui naguère ouvrait au matin fenêtres, volets, paupières, pour que puisse entrer plus d’amour encore. »
Mais le poète ne reste pas refermé sur lui-même. Il embrasse cette humanité qui l’entoure et qui vit, comme lui, comme nous, la soif de l’inconnu ou de l’invisible. A l’intersection « de tous les chemins », se tient l’auberge du poète et sa table ouverte, « rendez-vous des vagabonds, des égarés, des errants. »
Agrandissement des détails (extraits), recueil de poèmes de Jean-François Mathé publié aux éditions Rougerie (2007). Textes lus par Guy Allix.
Ils disent que tout est du vent, tout est changeant, qu’après les ruelles vient la plaine où l’on peut marcher en dormant avec les rêves de la nuit d’avant, qu’on est plus rêvé que vivant et qu’un jour, tout un chacun s’efface de la vitre où une main lasse esquisse un adieu sans émoi.
Mais il y a des « miettes de mystères et d’évidences », titre de l’avant-dernière partie, à recueillir encore. Jean-François Mathé aime cette heure où la nuit n’est pas encore tout à fait noire, ce « gué » où il faut se risquer chaque soir. Sa poésie suggère une atmosphère d’attente et d’imminence avec les mots les plus simples, une retenue qui frôle des présences sans pouvoir les cerner vraiment.
Chaque soir est un gué entre une berge abandonnée
une autre qui attend.
Au milieu du gué on rassemble les ombres
en un seul vêtement dont il faut s’habiller
pour épouser la nuit,puis on avance
comme si c’était soi qu’on allait quitter.
« Le seuil, on y est seul », dit un émouvant poème du début du livre. C’est la solitude devenue chant secret, parfois presque étouffé, que nous entendons dans cette voix. Elle résonne gravement, mais elle a cette chaleur, cette ardeur contenue, qui sont le signe du poète frère de tous.
Attendez, dit-on sur le seuil. Mais on voit que ce n’est qu’au soleil qu’on a parlé, à lui qui a fermé à clé sa porte sur les départs puis la rouvre sur les absences. Le seuil, on y est moins seul.
La poésie crépusculaire de Jean-François Mathé nous accueille sur ce beau seuil et accomplit le miracle dont seul le véritable poète est capable : nous faire entrer dans le partage, souvent poignant, du plus libre et du plus lumineux, malgré la nuit.
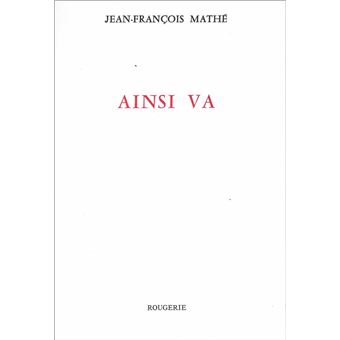
Jean-François Mathé, Ainsi va,
Rougerie, 2022, 13 euros.