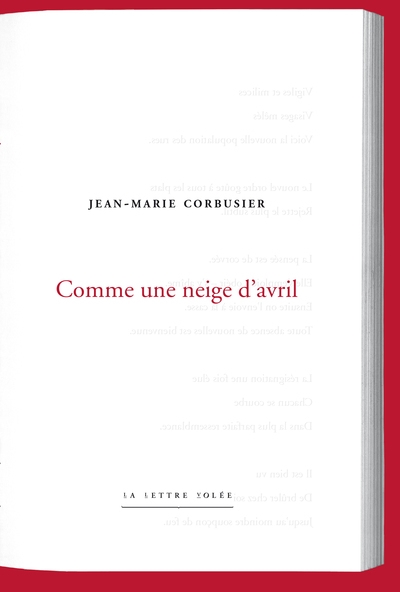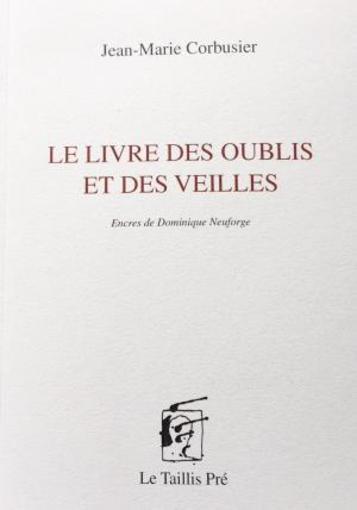Chronique du veilleur (54) : Jean-Marie Corbusier
« Le mouvement poétique est un acte, un acte exclusivement intérieur et secret », écrit Pierre Reverdy. Cet acte, Jean-Marie Corbusier le pratique à un degré remarquablement élevé.
Il témoigne d'une exigence de lucidité singulière. A ras du réel et au profond de la conscience. Il s'exprime par images sobres, silencieuses, comme si le poète voulait coïncider avec le plus réel de ce monde et de lui-même, en un face-à-face dont aucun divertissement ne semble pouvoir le détourner.
Le face-à-face
pour que tu existes
mur
comme un baiser
inapprochable
un rien
où cogner fort
un espace qui réponde
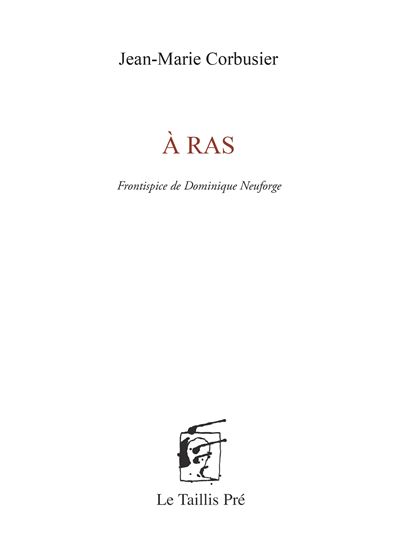
Jean-Marie Corbusier, A ras, Le Taillis Pré, 17 euros.
Car le réel extérieur et la conscience se trouvent dans un rapport souvent oppressant : « Ciel autant que sol / froids / noués à la terre / au piétinement. » Le titre A ras dit bien cette sorte de servitude, sinon de résignation. Le poème éprouve cela et s'efforce de surmonter cette condition, par les mots, par les silences :
Silence
au bord des choses
amassé
pantelant
Le malaise peut parfois s'alléger, Jean-Marie Corbusier en regarde les répits, le sursis. En s'interrogeant sur le pouvoir et la fonction de la poésie, peut-être parvient-il à une forme d'assise, d'apaisement.
Où le souffle noue
le mot déteint
langue sifflant
dans son silence
plus loin que moi
elle s'accomplit
seule
s'active
je reste présent
« Etreindre ou étouffer », tel serait le dilemme. Peu d'oeuvres contemporaines se concentrent à ce point aigu sur lui. La véritable importance de la poésie est « vitale », écrivait encore Pierre Reverdy. Jean-Marie Corbusier le sait et sait transmettre cette essentielle vérité. Chaque poème reprend cette infatigable lutte, dont la défaite grandit celui qui la mène avec une si pure intégrité.
Sans issue
ce sol
tient lieu d'issue
d'empreintes
où trébucher
le mode d'emploi perdu
aller suffit
rien n'est dit
n'est fait
vraiment