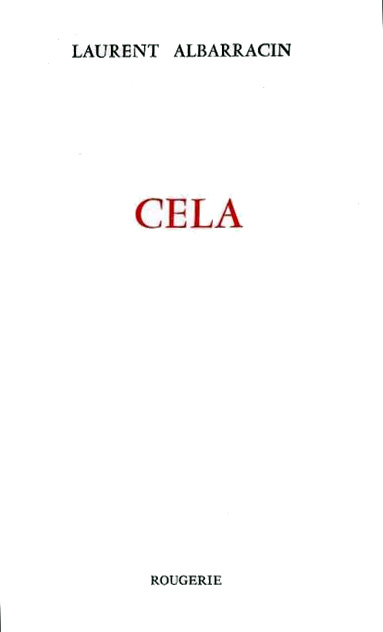A propos de Contrebande, de Laurent Albarracin
Des sonnets que Laurent Albarracin a réunis dans Contrebande, on pourrait dire, comme le fait Pierre Vinclair dans sa préface à ce même livre, qu’ils sont sentimentaux aussi bien que naïfs, au sens de Schiller. Ces poèmes jouent en effet d’un ensemble d’échos et de distorsions qui, outre le plaisir qu’ils visent à procurer, nous ramènent à une autre sorte de naïveté, celle de l’enfance – qu’on aurait envie de prendre pour définition de l’attitude poétique.
Mais regardons de plus près. Fidèle à sa manière depuis longtemps, et ici à sa filiation revendiquée à Ponge, Albarracin joue avec les mots, pour mieux tenter de s’approcher des choses. Les jeux de la tautologie qu’il affectionne particulièrement sont certes encore présents, mais de moins en moins (semble-t-il), et les textes montrent les signes d’une ouverture à un panel élargi de techniques : paronomases, jeu sur les homonymes et homophones, etc. Car outre le langage qui nous permet de dire la chose, et qui nous y donne un accès biaisé, il y a tout ce bruit qui entoure la saisie de l’objet, images adventices, souvenirs, échos formels dans la perception, qu’Albarracin tisse en une sorte d’auréole de sens, par un jeu sur les aspects sensoriels et affectifs sous lesquels les choses se présentent à nous. Jeux de l’imagination visuelle (« L’art de bien se tromper », par exemple), contiguïtés et associations d’idées, antagonismes, odeurs (« La rue après la pluie ») sons (« La chamade »), etc. Je n’en citerai qu’un seul exemple (le livre en est plein), « La lune » : où l’on voit bien le poème passer de la lune au ballon par contiguïté formelle, puis au mouvement vertical (rebond du ballon / à quoi bon / bondit / àquoibondit), la lumière et la forme pour ainsi dire oculaire de la lune fournit les thèmes du deuxième quatrain (miroir, réflexion, dont le double sens permet des rêveries quant à nos actes sous son regard), la rondeur du cèpe fait écho à celle de la lune autant qu’à la crêpe et à la poêle où elle cuit, et la crêpe par homonymie fournit le crêpe couvrant la lune ;
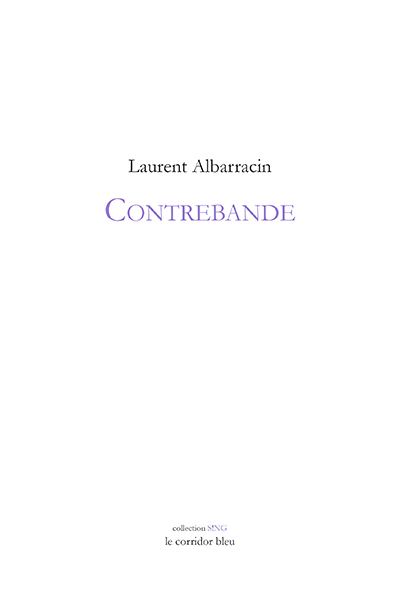
Laurent Albarracin, Contrebande, le corridor bleu, coll. S!NG, 2021, 96 pages, 12 €.
ce qui permet à son tour le jeu sur un voile/une voile ; la rime fournit comme à rebours le jeu avec phases/phrases, qui semble avoir suggéré, devant le caractère imperturbable des cycles lunaires (où la hauteur de l’astre devient son caractère « hautain »), l’avant-dernier vers.
La lune
La lune àquoibondit au moindre des sursauts.
L’indifférent ballon au taquet réagit
Et hausse son épaule à la splendeur d’un fruit
Ou bien lève un sourcil pour l’accrocher là-hautElle est comme un miroir, une glace sans tain,
Depuis où observer à discrétion nos actes
Et ne nous renvoie rien dans un tacite pacte,
Juste nous réfléchit, nous couvre de dédain.Mangée par son éclipse et ronde comme un cèpe,
Rien ne se tient longtemps dans cette foutue poêle.
La lune est une crêpe entamée par un voileEt elle est une voile endeuillée par un crêpe.
Devant l’astre hautain on peut tenter des phrases,
Il ne répondra pas : la lune fait ses phases.
Un autre trait de l’écriture albarracinienne joue ici à plein. Dans l’art du sonnet, la pointe finale doit venir donner une forme de morale, une formule élégante qui en un sens, par sa beauté, nous arrache un consentement que la froide logique ne donnerait pas. Mais dans ces poèmes, on dirait parfois que la machine à pointes est devenue folle, qu’elle darde ses traits à répétition, jusqu’à presque faire éclater la forme sonnet, en variant sans cesse les angles, pour atteindre au cœur de la cible : la chose elle-même ? Ou bien la formule qui, la disant avec apparemment le plus de cette nécessité construite par l’image et le jeu sur le langage dont je parlais plus haut, la créera autant qu’elle en décèlera la vérité ? Ainsi par exemple le « Blason de la cheville », et « Le café ».
De ces rapprochements parfaitement contingents, on ne devrait a priori pouvoir rien tirer de significatif, sinon un petit plaisir sans conséquence. Mais il y a bien chez Albarracin la tentation de rémunérer le défaut originel des langues par un travail de l’image qui, construisant dans l’espace du poème les conditions de son évidence, transforment cette contingence en nécessité : et l’image semble alors dire le vrai – rien de moins : « Il faut souvent bercer l’illusion qui nous berne » (p.38)… Albarracin construit en effet une sorte de phénoménologie folle – et pour cette raison plus vraie ? – où ce qui se donne à voir, ce sont les choses telles qu’elles sont pour nous, et d’autant plus qu’on se laisse un peu secouer par elles ; autrement dit, quand on rêvasse suffisamment longtemps pour les laisser pénétrer en nous, avec leur cortège d’idées associées, de souvenirs, de formes. C’est aussi pour cela que, même si « Le premier vers nous coûte alors qu’il est fortuit », le même « Art poétique » poursuit plus loin :
Le reste se poursuit sans obstacle majeur,
Il suffit de se faire un tantinet songeur.
Et la suite explique le processus, tout en l’illustrant par les résultats qu’il peut produire :
L’eau s’enchaîne en versant de l’eau à ses maillons.
Ainsi coule le fleuve en liquidant sa pâte
Dans le gaufreur de l’eau où se forge sans hâte
Le doux miel du soleil dans chacun des rayons.
Albarracin rêve ainsi constamment entre deux eaux, entre le langage et les formes sensibles, entre les mots arbitraires que la langue nous lègue pour dire les choses, et les formes phénoménales dans lesquelles elles se présentent à nous. C’est dans cet entre-deux que se joue sans doute notre rapport le plus juste à ce qui est.
Il me semble qu’ici s’éclaire le sens du titre. La contrebande, l’art du passage de l’autre côté, en toute discrétion, c’est un peu ce que fait Albarracin ici : en travaillant sur ces petits jeux de mots, sur ces choses sans importance (sur le plan des thèmes abordés), on peut s’approcher de l’autre côté, traverser la frontière du langage pour retrouver, sinon les choses mêmes, un peu de leur premier apparaître.
Ce premier apparaître des choses, il me semble qu’il a à voir, chez Albarracin, avec l’enfance. Si le poème joue sur les mots, avec les images et associations d’idées gratuites du rêveur (et l’enfant en est l’archétype), il peut reconfigurer, remonter, presque, le réel : ainsi des grues (p43), entre l’oiseau et l’engin de chantier, qui semblent presque montrer un réel entre destruction et reconstruction. C’est ainsi que l’on pourrait aller jusqu’à « parfaire les choses » (p. 60) en prenant exemple sur les mots. L’enfant, parce qu’il ne sépare pas la rêverie de la perception sensible, parce que pour lui l’imagination est aussi puissante dans les mots qu’elle l’est dans le regard et le jeu de tous les sens, parce que pour lui les choses sont pour la première fois, vit cet âge du surgissement dans lequel les choses sont plus claires, plus puissantes, cet âge où ne sont pas séparés les choses, les mots qui les disent, les sensations et les idées qu’elles évoquent – où ce qui est se donne dans sa plus grande vérité, qui est rythme, et musique. Dans la naïveté retrouvée des premières années, les sonnets d’Albarracin tentent de saisir la musique de cette enfance, celle qui bat la chamade dans le galop des chevaux, pour peu qu’on sache écouter (p.89) :
Chaque fois que j’entends le galop qui martèle,
L’enfance me revient au rythme qui m’appelle.