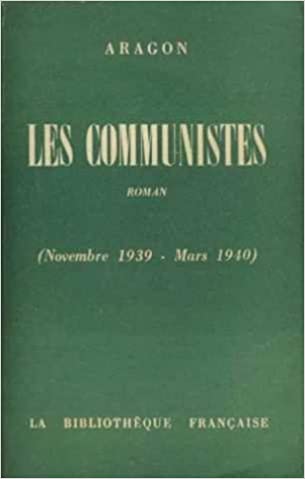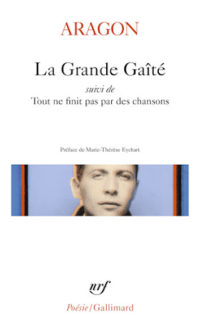La grâce éparse ou le poète Aragon
« À peine un feu s’éteint qu’un feu s’embrase »
Louis Aragon[1]
C’est du poète Aragon que je tiens à parler, et d’abord du premier Aragon. De celui qui publie Feu de joie, en 1920, un recueil initial qui passa presque inaperçu, à celui qui par antiphrase et dérision écrit et publie La Grande gaîté, avant d’ouvrir sa deuxième période avec Le Crève-cœur et de retrouver une autre gaîté, amère quoique véritable en dépit des noires circonstances de la Deuxième Guerre mondiale. La période s’étend donc de 1920 à 1940. Il est bien, avec des traits constants que je dirais de nature, deux poètes distincts, les exégètes le marquent de manière souvent implicite. Par ailleurs, ce qui pour l’instant m’empêche d’entrer dans la poésie du second Aragon (peut-être du troisième, etc., et il faudrait pour ce faire rechercher sa poésie, ou le poétique aragonien, partout dans l’œuvre, y compris dans la prose et les romans) c’est, confrontée à la brièveté d’un article, l’immensité océanique de l’œuvre elle-même qui, à cet égard, pourrait s’apparenter à celle de Hugo.
Qui plus est, je n’ai rien d’un critique littéraire et n’y prétends pas. Rien ne me conduit que le désir d’admirer et de trouver quelques raisons à mon admiration. Il n’en manque pas avec Aragon. Cependant, avant de me livrer à mon exercice de prédilection, allons à ce qui a gêné, à ce qui gêne encore, à ce qui, un temps, diminua « l’émerveillement » d’un André Gide [2] par exemple… Il ne faut rien vouloir ignorer.
« Je n’irai pas cracher sur sa tombe. », annonce Jean Pérol. Moi non plus. Et Jean Pérol d’ajouter : « …m’importent seuls les vers de ses poèmes à fissurer le cristal de l’âme, à fissurer l’éternité. M’importent seuls ces mercis d’amour que lui envoie la langue française.[3] » J’applaudis, mais la restriction m’interroge. Non, ces mercis d’amour ne peuvent « seuls » m’importer. Nous le savons, Aragon n’est pas à sa place dans le paysage de notre littérature, trop de controverses, de sous-entendus, de dits et de non-dits, de mensonges, de vérités et demi-vérités, de haines ouvertes ou cachées, empêchent qu’on lise le poète notamment, mais aussi le romancier, sans qu’une interrogation ici, un doute là, un désaccord ailleurs suspende la pensée. J’ai voulu en avoir le cœur net, et pour ce faire suis entré dans sa poésie par la porte la plus ouverte, non celle des automaticités poétiques et des décalcomanies des temps du surréalisme, mais par celle, concomitante, de l’adhésion aux thèses du communisme, de l’affiliation au Parti (en 1927) et du désir jamais démenti chez Aragon de se lier, en tant qu’homme et poète, à la défense des intérêts si malmenés des classes populaires, et surtout d’ancrer sa poésie dans le monde réel, dans le camp de la justice et du « progrès » social. Quels qu’aient été les enthousiasmes, illusions, succès et échecs ultérieurs de cette voie de combat, il est à noter qu’Aragon, en dépit des critiques et anathèmes, n’a jamais joué sa fidélité à ce choix décisif contre quelque intérêt personnel. Il s’est furieusement défendu, souvent, et il s’est aussi désespéré de n’être pas compris dans ce choix définitoire. La fidélité est l’une des marques de l’homme et du poète, et aussi son honneur. Sa conduite durant la Deuxième Guerre mondiale est irréprochable et fidèle : pas d’exil confortable ou inconfortable sur les rives de l’Hudson ou dans les bras de la Métro-Goldwin-Mayer… Ce trait de tempérament et de personnalité suscitera toujours le respect. Il suscita pourtant les sarcasmes des exilés volontaires et anciens amis, Breton et Péret notamment.
C’est pourquoi je croirai respecter encore Aragon en le lisant dans son entière dimension poétique, dont il ne nous a rien dissimulé par ailleurs des moments les plus contestables[4]. Allons autant qu’il nous est possible au fond des choses, quoique sans nous appesantir outre mesure.
Ainsi, le recueil Persécuté persécuteur (1931)[5], dans Front rouge notamment, en contrepoint d’un éloge unidimensionnel de l’U.R.S.S. lié à une condamnation à mort sans appel de la répugnante bourgeoisie, condamnation ironique et parodique sans doute, mais à mort, comporte-t-il des vers qui ne sont que des slogans – « Mettez votre talon sur ces vipères qui se réveillent / Secouez ces maisons […] / Qu’il est doux qu’il est doux le gémissement qui sort des ruines » –, et, de la même eau sale, l’éloge du meurtre politiquement justifié : – « L’éclat des fusillades ajoute au paysage une gaîté jusqu’alors inconnue / Ce sont des ingénieurs des médecins qu’on exécute […] / À vous Jeunesses communistes / balayez les débris humains où s’attarde / l’araignée incantatoire du signe de croix […] Dressez-vous contre vos mères… ». Dieu sait si j’exècre certaine bourgeoisie, son égoïsme, sa cupidité, la connaissant assez d’en être issu, et Dieu sait si peu me chaut Dieu et non moins sa ridicule et si souvent malfaisante Église, mais tout de même, ce dont Aragon, même jeune encore, même souhaitant donner des gages, même animé par l’élan ébloui du néophyte, eût dû avoir l’intuition, la prémonition, c’est bien ce que, de Moscou à Phnom-Penh, nous révélèrent les années qui suivirent. Certes, je ne fais que deviner l’énorme pression que le P.C.F. pouvait exercer sur les esprits, mais encore une fois, le poète quel qu’il soit, quelle que soit la conviction qui l’emporte, peut-il donner dans cette faiblesse de l’esprit qui ne conduit qu’à changer de religion et à s’affilier à la mort[6]… Et tout cela pour que Front rouge, à la fin, sombre dans les ridicules de la propagande, dans des images d’Épinal aux couleurs soviétiques : « Le mai socialiste est annoncé par mille hirondelles / Dans les champs une grande lutte est ouverte […] Les coquelicots sont devenus des drapeaux rouges et des monstres nouveaux mâchonnent les épis ». Les moyens se justifiant par la fin n’ont jamais été de ma philosophie : « En marche soldats de Boudienny / Vous êtes la conscience en marche du Prolétariat / Vous savez en portant la mort à quelle vie admirable vous faites une route… » – Non, décidément, je ne puis ! Mon cœur se soulève, Louis ! – Ton cœur est bien faible, mon ami…, m’aurait-il, à l’époque, rétorqué. – Et toi, ton esprit ? – lui aurais-je demandé.
Ferai-je un pas de plus sur la pente où nous descendons ? Oui, un seul. Il est d’autres « beautés » de ce style. Même les kangourous surréalistes boxent mal dans cette confuse nécessité : – « …des lèvres artificielles d’une chanteuse pour la première fois a pris son vol comme un canard le kangourou langoureux de cette mélodie… » (in Je ne sais pas jouer au golf) ; et il est d’autres horreurs[7] (de celles que le poète reniera et dont Maurice Thorez lui-même lui fera grief), entre autres cette allusion qui figure dans Vains regrets d’un temps disparu (in Hourra l’Oural) nous rappelant le massacre d’Ekaterinbourg, le sous-sol de la Maison Ipatiev : « C’est là qu’ils ont fait dans une cave / fait un cadavre avec un tzar / et la tzarine et ses petits… » Cela ne « passe » pas en dépit qu’il n’y ait mention que d’un cadavre unique, celui d’un empire. Comme avec Louis XVI on mit au panier le cadavre de la royauté. Voilà, rien de tout cela, et surtout pas les « petits », n’entre dans ma conscience admirative. Mais parce qu’Aragon n’a pas dissimulé, parce qu’il est au fond d’une nature plus profonde et élevée (certaines images rabaissent l’humain, ne croyez-vous pas ?), parce que de la disgrâce peut naître l’irrésistible grâce et que plus tard le poète confessera que l’ «On ne fait pas un poème avec / De la boue[8] », eh bien, relevons, plus loin, ces émergences allitératives se résolvant en visions de beauté jusque dans l’exécration anti-coloniale, telles ces : «Palmes pâles matins sur les Îles Heureuses / palmes pâles paumes des femmes de couleur / Palmes huiles qui calmiez les mers…»[9], ou cette simple image, peut-être prémonitoire : « Je traîne à mes pas le manteau fantomatique des arrière-pensées »[10]. Relevons encore cette déchirure d’un ciel d’orage, rayons nés de l’ultraviolence de la juste colère, crevant les nuées de leur arc-en-ciel révolutionnaire dans « Prélude au temps des cerises » où l’on voit et entend les fusées s’éjectant des rampes de lancement de la Terreur et même d’une sorte d’hymne au Guépéou – « J’appelle la Terreur du fond de mes poumons… »,[11] –, fusées tirées contre ce monde bourgeois à vomir de l’avant-guerre et son inconsciente bonne conscience : « Mesdames et Messieurs La valse / a trois temps / l’argent l’oubli l’art / le triple menton / l’art l’argent l’oubli… » « Vos tableaux vivants soulèvent le cœur / par leur bêtise atroce et la bassesse incroyable de vos désirs / Ta gueule ô Lakmé / Vous êtes la honte des miroirs »[12]. Cela est de l’ordre des grâces terribles, et il ne faudra pas creuser longtemps – cherchez donc ! – pour en dénicher d’autres dans Hourra l’Oural, entre quelque éloge de Staline et l’exaltation des prouesses stakhanovistes prolétariennes… Certes, Aragon s’ennuya-t-il à ce point dans cette fête du muscle travailleur ? Y crut-il, ou y perdit-il jusqu’à cette ironie qu’il mania ailleurs comme rapière mortelle ? Je ne sais, je suis d’un autre temps égaré dans de si étranges vulgarités que je le vomis chaque soir et chaque matin. D’Aragon, ses exégètes ne savent pas tout, ni moi non plus. Mais ces octosyllabes en distiques, avec leurs Démons et leur Dame Démence, n’ouvrent-ils pas le passage à un génie tout autre ? Ne trouvent-ils pas l’air dans un autre air, fût-il ancien, pareil à une chanson, et pour cela quelque peu suspect… je veux dire à l’époque, et même à toute époque… :
L’orchestre reprend la romance
qui grisait le monde aboli
Dans mes bras Madame Ô Démence
Démon que vous êtes joli
Au cœur même de la cadence
Qu’est-ce qui bat comme un tambour
C’est cependant la même danse
mais ce n’est plus le même amour [13]
Le génie ne peut se dissimuler sous aucune sorte d’oripeau. Il éclate, et déjà sur tant de pages… Venons-y. C’est, dans Feu de joie, la rimbaldienne ouverture souvent relevée : « Rues, campagnes, où courais-je ? Les glaces me chassaient vers d’autres mares. / Les boulevards verts ! Jadis, j’admirais sans baisser les paupières, mais le soleil n’est plus un hortensia. » (O.P.C., I, p. 4.) Déjà, selon moi, dans ce « soleil », qui est fleur des jardins née au pays du soleil levant et ici ne l’est plus, s’éveille, discret, l’art de la « déviation » aragonienne, bifurcation douce, brutale, inattendue, comme si les routes du poétique ne pouvaient mener aux ports attendus. Comme si, au jour, surgissaient d’emblée les questions : « Le jour me pénètre. Que me veulent les miroirs blancs et ces femmes croisées ? Mensonge ou jeu ? Mon sang n’a pas cette couleur. » Rimbaud, oui, mais aussi Apollinaire, Baudelaire parfois, ailleurs Villon, Saint-Amant (moins aperçu, celui de La Crevaille… etc.), Chénier, d’autres encore… affleurent et sont en quelque sorte « cités » par Aragon, jalons de son admiration des classiques, appuis de mémoire, aliments, routes à suivre, à poursuivre autrement. L’errance perpétuelle (il en imagina le « mouvement », je crois !) est son signe : errance non seulement topographique, mais liée aux sources et aux souffles intérieurs qu’il dévie, détourne sans cesse : « Dans l’État de Michigan / justement quatre-vingt-trois jours / après la mort de quelqu’un / trois joyeux garçons de velours / dansèrent entre eux un quadrille / avec le défunt… »… « À l’Hôtel de l’Univers et de l’Aveyron / le Métropolitain passe par la fenêtre / La fille aux-yeux-de-sol m’y rejoindra peut-être/ Mon cœur / que lui dirons-nous quand nous la verrons »… (O.P.C., I, p. 5.) Le cœur, chez Aragon, est la basse continue, la porte à franchir vers les débordements illimités. Non pour des sentimentalités, mais pour des émotions qui vont de l’effleurement lumineux aux creusements profonds. Aragon, nous l’éprouvons dès ses premiers poèmes, ne s’interdira rien dans le domaine de « sa » liberté d’être au monde, ou, si l’on veut, il nous dira tout ce qu’il pourra en dire, y compris, formule frappante et vraie, claire et mystérieuse, que « Le jour est gorge-de-pigeon ». Il va, non sans une fière assurance, sur tous les chemins qui se présentent à lui[14] : « Plus léger que l’argent de l’air où je me love / Je file au ras des rets et m’évade du rêve // La Nature se plie et sait ce que je vaux ». (O.P.C., I, p. 9.) Il ne s’agit pas ici de construire par artifice un poème dans le poème, ou le poème du poème – risque d’un article –, mais de dire cette élégance très singulière qui frappe l’œil et l’oreille aux vers (comme aux proses) d’Aragon. André Gide, nous l’avons dit, en fut « enchanté ». Il n’est question que de cet enchantement. Fraîcheur des kaléidoscopies, sauts d’images et de sens, naturelles discontinuités d’une poésie joyeuse, effervescente, avec, prête à sourdre ou jaillir, l’insolente volonté de contester de ce qui est, la volonté d’embraser les choses (le titre de ce premier recueil en fait foi) : « Que la vie est étroite / Tout de même j’en ai assez / Sortira-t-on / Je suis à bout / Casser cet univers sur le genou ployé / Bois sec dont on ferait des flammes singulières ». (O.P.C., I, p. 19.)
Je ne m’arrêterai pas à ces textes « épars » qu’Aragon produisit entre 1917 et 1922 (O.P.C., I, pp. 31-78.). Ils apportent peu d’audaces personnelles, livrés qu’ils sont à l’aléatoire d’éphémères expérimentations dadaïstes. Ils précèdent le long passage du poète sur le territoire surréaliste. On saisit bien cela dans les pages de Une vague de rêves (publiées en 1924 et précédant de peu le premier Manifeste de Breton), pages qui reflètent les déchirements internes du mouvement, les débats sur les places distinctes, voire opposées, qui doivent être celles de la poésie et de la littérature selon Breton, pour qui il y va de l’honneur personnel, de celui du mouvement et de sa cohérence. Aragon s’y montre spécialement déchiré qui commençait alors simultanément la rédaction d’un roman – La Défense de l’infini – et celle de la prose multiple du Paysan de Paris. Or le mouvement condamne le roman. Aragon résistera. Reprenons cet avis de Marie-Thérèse Eychart : « Ce qui n’est pour Breton qu’une confusion des genres devient pour Aragon une méthode de travail embrassant tous les possibles et échappant par un mouvement dialectique qui lui est cher aux contradictions stérilisantes. » (O.P.C., I, p. 1220.) Reconnaissons donc la nature proprement aragonienne dans cette échappée vers l’extension, les syncrétismes, plutôt que vers la réduction des possibles, et aussi ses choix à venir, ce goût des vertiges, des chutes irrémédiables qu’il évoque dans l’image de Phaéton… tout cela saisi parmi ses formulations libres et belles : « … je saisis en moi l’occasionnel, je saisis tout à coup comment je me dépasse : l’occasionnel c’est moi, et cette proposition formée je ris à la mémoire de toute l’activité humaine. » « Qui est là ? Ah très bien : faites entrer l’infini. ». (O.P.C., I, pp. 83 et 97.)
Le recueil Le Mouvement perpétuel, publié en 1926, nous propose le surréalisme à l’essai (je veux dire ne pouvoir me convaincre ici d’un sérieux profond et définitif) dans le laboratoire d’Aragon. (O.P.C., I, pp. 100 à 142.) On s’y plaira à des images souhaitées surprenantes et tirant peu à conséquence : « Sacrifions les bœufs sur les arbres / Les corps des femmes dans les champs / Sont de jolis pommiers touchants… » On s’y amusera de manière plutôt convenue : « Mercredi me fait un signe de croix / Mercredi menteur veux-tu que je croie… » Et dans la section Les Destinées de la poésie je cueille quelque tendre et trompeuse Villanelle - « Au bord des fontaines // Sous les clairs ormeaux… » -, repos du guerrier, étape aux rivages du classicisme que le poète ne répudiera jamais, ou encore, d’une même eau, sans façons, cette éclatante respiration dans les paysages de quelque mythologie, Atalante ou la Dame à la Licorne feraient l’affaire, ou mieux encore le regard d’Ulysse s’ouvrant sur Nausicaa :
« Elle s’arrête au bord des ruisseaux. Elle chante / Elle court / Elle pousse un long cri vers le ciel / Sa robe est ouverte sur le paradis / Elle est tout à fait charmante / Elle agite un feuillard au-dessus des vaguelettes / Elle passe avec lenteur sa main blanche sur son front pur / Entre ses pieds fuient les belettes / Dans son chapeau s’assied l’azur ». (O.P.C., I, p. 133.)
Excusez du peu ! Exercices ? Pauses ? Qu’importe, Aragon s’essaye à tout et nous offre les parfums du charme et de grâces éparses bien que profuses, traces déjà visibles d’un génie poétique qui ne demande qu’à s’échapper de toutes les bouteilles imaginables. Cette « perte du sens », en marge du Mouvement perpétuel, n’en témoigne-t-elle pas aussi, qui pourtant ne satisfaisait pas Aragon :
« Défis à l’amour dans des maisons de fil de fer / Nous aimons les filles de sel / Lents baisers des démons couleur de la mer / Oiseaux-femmes beaux oiseaux déments / La valence la voulez-vous la valence / C’est le désir qu’il est léger dans la balance… ». (O.P.C., I, p. 141.)
Le Paysan de Paris (1926) est à lui seul tout un monde poétique et spéculatif, un chef-d’œuvre reconnu et célébré, dont nous devrions traiter simultanément avec d’autres livres plus anciens – avec quelque Télémaque, voire quelques déambulations parisiennes de Restif, et, dans tous les cas, la Nadja d’André Breton. Nous ne pouvons à l’évidence nous y lancer dans ce cadre limité[15]. Selon la vision de Daniel Bougnoux, « La poésie surgit ici du concassage des formes, qui répriment l’essor ou le développement du roman… […] La poésie ne relève pas d’une forme métrique (qui fige le genre), mais d’une forme de vie… » (O.P.C., I, p. 1254.) : inversons le regard, et sans doute nous pourrons juger que dans Le Paysan s’articule de flagrante façon le romanesque sur le poétique ou le poétique sur le romanesque avec, pour ressort décisif, pour socle constant de tout écrit d’Aragon, la vie, sa vie, intérieur-extérieur, extérieur-intérieur en perpétuelle osmose.
Il pourrait sembler regrettable de clore ces quelques lignes par un regard trop rapide sur les poèmes de La Grande Gaîté, écrits en 1927 et 1928, publiés une seule fois en 1929. Le recueil – qui n’a pas vraiment bonne presse – croise l’histoire difficile du surréalisme, celle très complexe des relations entre le communisme français et le mouvement, sans oublier le grand virage que va prendre l’existence d’Aragon sur tous ces plans, y compris celui du franchissement décisif des amours de Nancy Cunard à celles d’Elsa Triolet. Or, nous verrons qu’en l’occurrence il n’est rien à regretter nulle part. La Grande Gaîté (O.P.C., I, pp. 401-451), certes, est un livre méconnu ; c’est un Aragon déchiré qui l’écrivit, pire encore, un Aragon désabusé, voire « mutilé de toute élégance, de la virtuosité, de l’aisance qui le caractérisent généralement », selon Olivier Barbarant. (O.P.C., I, p. 1335). Un Aragon qui sans aucun doute se trouve pour un temps déstabilisé en raison des insatisfactions engendrées par ses relations avec le groupe surréaliste, les limites qu’il perçoit très bien de la recherche poétique menée par le groupe, les inquiétudes de son entrée en politique jointes à celles de ses évolutions amoureuses… Heures difficiles auxquelles il répond soudain par une sorte de rage destructrice de l’instrument poétique classique comme du sien propre, une autre mise à mort en somme. Le recueil n’a rien d’accueillant à dire vrai, sa poésie bouchère découpée au feuillard, décapée jusqu’à l’os, faisant irrésistiblement penser à la table rase sur laquelle peut-être on reconstruira, ouvrira d’autres horizons, d’autres musiques, d’autres rythmes, avec ceux d’abord que lui inspirera le militantisme. N’oublions pas que parallèlement Aragon travaille à son œuvre romanesque contestée par Breton au point qu’il en détruira la presque totalité des prémices (affaire de La Défense de l’infini). Une berceuse scatologique est la quatrième pièce de La Grande Gaîté, avec, un peu plus loin, une nasarde à soi-même en « ancien combattant » du Mouvement Dada, une pensée au « sale con » que l’on pourrait être, et bien des thèmes à l’avenant qui nous disent que le fond de l’impasse est atteint avec un écœurement mêlé du désir de trouver d’autres voies, de partir ailleurs. L’envie de poursuivre la lecture aura dû quitter bien des lecteurs. On les comprend. Cependant, ultimes grâces en décomposition ou affleurements malgré tout de nouvelles promesses, je les cherche encore ces grâces, et les trouve au-delà ou hors de la substance même du recueil. Ce qui ne se conçoit que difficilement peut-il s’énoncer de claire façon ? C’est, ici, l’ironie anti-valéryenne d’un portrait dérisoire, la griffe rapide et blessante du chat : « […] Pour l’apéritif lu La Jeune Parque […] Je suis M. Faralicq le commissaire bien connu », et là, un « Tango folie » qui ne manque pas de l’instinct des fatales oppositions : « Toutes toutes toutes / S’il en reste encore / Toutes toutes toutes / Je n’ai pourtant rien compris à ce qu’elles nommaient l’amour ». Dans le sentiment d’humiliation masculine extrême de « Tel que », je lis, grâce encore, mais essentielle chez Aragon, celle du dire intègre : « Quand je vois des femmes comme ça […] Ce n’est pas leur faute mais / La mienne / Je ne me sens pas un homme / Je me sens / Un pauvre déchet pas très propre… », etc. Les cinq vers de « Poids » sonnent à mon oreille comme du plus fantaisiste Desnos, et telle « Fillette », hors sa crudité, a des nuances valéryennes : « Je voudrais lécher ton masque ô statue / Saphir blanc / […] Ô sacré nom de Dieu de rouge aux lèvres / Murmure / Exquise enfant bleu pâle… ». Raclant l’abject dans « Angélus », Aragon détecte d’étranges beautés qui ne sont qu’à lui et à Paris : « La boue avec ses vieux tickets de métro […] La boue / Avec ses numéros d’autobus / Ses vieux débris ses déchets de l’instant … », cela allant à l’indicible, à l’affolement du discours avec ces « vieillards » qui pelotent et reluquent ce à quoi ils veulent prétendre encore : « Regardez dans leurs doigts les putains qu’ils manient / Leurs yeux comme des loteries / Leurs yeux immenses où sautent à la corde / Un cygne noir devenu fou / Il va chanter… ». Dans l’anti-chant sont enfouis des gemmes admirables. Qu’on les cherche, on les trouvera. Aragon l’enchanté-l’enchanteur ne peut se nier longtemps, fût-il plongé au plus loin dans les désaveux, côtoyant les « monstres négatifs » de sa « Lettre au commissaire ». Le verbe alors s’exaspère et renoue avec d’autres violences qui sont encore de ces grâces noires que l’on traque aussitôt : « Les gens voyez-vous ont un idéal / Mourir dans leur lit Drôle d’avantage / Mourir tranquillement dans l’urine et le papier d’Arménie / Mourir comme un robinet dans un tiroir / Comme une crécelle dans la moutarde… ». Dérision du dérisoire, parfois au bord de l’anéantissement, de l’insensé - Excès ! Côtoiement des frontières de l’audible ! - tellement que se lèvent des beautés neuves, de celles qui affleurent et ouvrent au futur : « Les femmes soudain dans cette neige se levèrent… […] Puis dans la robe de la ville / Roulèrent leurs corps comme des larmes / Comme les diamants tombés d’un diadème… » (in Transfiguration de Paris).
N’oublions pas : – « Faites entrer l’infini ! » Un ordre qui ne pourra longtemps sonner dans le vide.
La Grande Gaîté, si elle n’offre pas une entrée facile dans son corps dur et sec, ne mérite pas les jugements le plus souvent négatifs qui lui ont été réservés, ni la méconnaissance relative qui l’entoure. C’est un recueil qui ouvre plus qu’il ne ferme, une étape. Aragon chante encore après avoir voulu dé-chanter, et propose une poésie antiparticulaire au sens de la seule physique poétique qui me soit à portée, s’annihilant pour « libérer de l’énergie sous forme de photons ». Il faudrait aller ensuite à l’Aragon poète renouvelé, à celui qui poursuivit son voyage, ouvrit la prose au poétique, et l’inverse. Il faudrait pouvoir dire : à suivre.
texte paru dans la revue Faites entrer l’Infini, n° 54, décembre 2012disponible auprès de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, 58 rue d'Hauteville, 75010 Paris, 14 euros.
[1] In En marge du roman inachevé, Petit morceau pour… (Aragon, Œuvres Poétiques Complètes, O.P.C., vol. II, p. 272, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade.)
[2] « Aragon dont les premiers écrits nous émerveillèrent, dont les suivants et les avant-derniers nous plurent moins ou pas du tout, et même certains nous consternèrent… ». (A. Gide, avant de parler en bien du recueil Le Crève-cœur. Cité par Olivier Barbarant, op. cit. vol. I, p. 1435, note 1.)
[3] In Le siècle d’Aragon, Textes publiés sous l’égide du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, 1997, pp. 38-39.
[4] La récente édition de ses Œuvres Poétiques complètes, préfacée par Jean Ristat, dirigée et annotée par Olivier Barbarant, (Gallimard, Pléiade, 2 vol., 2007) démontre que le poète ne fut pas homme à dissimuler, en les écartant de la publication, des poèmes qu’il regretta explicitement d’avoir écrits, et dont il eut honte. Dans la langue de notre temps, cela s’appelle « assumer » et « s’assumer ». Ainsi, selon O. Barbarant, Aragon ne se pardonnait-il pas « ce ton de cruauté » de son recueil Persécuté persécuteur », de 1931 ; ce qu’il dira, certes tardivement, en termes presque identiques de certains passages de Hourra l’Oural. (Cf. O.P.C., vol. I, pp. 1368 et 1386.) On en trouve une preuve supplémentaire dans les commentaires sur ces recueils et sur d’autres de ses textes et articles, qu’Aragon a écrits en 1974 pour la première édition en 15 volumes, chez Messidor, de ce qu’il intitule alors son Œuvre poétique. (Ces commentaires n’ont pas été repris dans l’édition de la Pléiade.)
[5] À juste titre, François Eychart me rappelle ici que la facture poétique du recueil Persécuté persécuteur est presque entièrement issue de l’esthétique surréaliste d’Aragon alors que politiquement il est en train de quitter le surréalisme, la rupture publique intervenant quelques mois plus tard, au début de 1932.
[6] Durant la guerre d’Espagne, Miguel de Unamuno, à Salamanque, dénonça la répugnante devise du général fasciste Millán Astray : « Vive la mort ! » Comment la tolérer chez les anti-fascistes ?
[7] Ou de splendides niaiseries comme seule la foi, quelle qu’elle soit, sait en inspirer. Ainsi ces vers : « Vous ne souillerez pas les marches de la collectivisation / Vous mourrez au seuil brûlant de la dialectique ». In Persécuté persécuteur, O.P.C., vol. I, p. 500.
[8] Le Treizième apôtre, in Les Adieux, O.P.C., II, p. 1199.
[9] Mars à Vincennes, in Persécuté persécuteur, O.P.C., I, p. 516.
[10] Lycanthropie contemporaine, in Persécuté persécuteur, O.P.C., I, p. 525.
[11] Prélude au temps des cerises, in Persécuté persécuteur, O.P.C., I, pp. 534 à 538.
[12] Ibid.
[13] In Hourra l’Oural, Le Capital volant, IV : Valse du Tcheliabtraktrostroï, O.P.C., I, p. 555.
[14] Quelque chose de quichottesque, sans doute…
[15] J’aurai encore laissé s’échapper des textes « automatiques » publiés entre 1920 et 1927 (O.P.C., I, pp. 303-374) qui démontrent que la trace surréaliste fut plus marquée chez Aragon que je n’ai pu l’imaginer ; et l’hommage que rendit Aragon à Lewis Carroll dans une « traduction » qu’en 1928 il fit de La Chasse au Snark, avec pour sous-titre Une agonie en huit crises. (O.P.C., I, pp. 375-397.)