Pascal Boulanger — Trame : Anthologie 1991–2018, suivie de L’Amour là, Lydia Padellec, Cicatrice de l’Avant-jour
Pascal Boulanger en son Anthologie poétique vivante
Septembre s’allonge sur la ville est le premier vers édité de Pascal Boulanger dans Septembre, déjà, publié chez Messidor en 1991. C’est important le jet initial : cette première pierre lancée dans le jardin de lecture est une forme oblongue couvrant le mystère de l’Unité métaphoriquement présentée comme une ville.
Septembre, déjà… déjà l’automne à l’aube des saisons. Déjà, poser nos sacs dans l’or du jour écrit le poète nouveau de 1991.
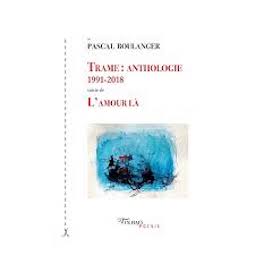
Pascal Boulanger, Trame : Anthologie 1991-2018, suivie de L’Amour là, TINBAD collection POÉSIE, 2018, 30 euros. Illustration de couverture, Sophie Brassard.
J’aime l’idée que la vie commençant est automnale. Toutes les limites se confondent, s’anéantissent dans cette cité bleue où Pascal Boulanger, poète de l’incendie, connaît les filles passantes jetant leurs robes sur les clôtures. Ainsi allons-nous nus.
Laissez-moi me perdre dans la foule poursuit Pascal Boulanger dans Martingale où se découvre la plage d’Ostie, la plage du crime, du corps offert. Toujours cette quête de l’unité, la soif de l’autre qui abreuve. Dans cette Martingale apparaît la figure de Clément Rosset, elle claque comme un coup de fusil. Où chercher la balle ? Pascal Boulanger distille son secret dans l’entretien partagé avec Gwen Garnier- Duguy en 2014 pour Recours au poème (texte figurant en clôture de l’ouvrage ici recensé) ; je le cite : « À une physique de la finitude, il faut opposer une métaphysique de la sensation ». Après sa conversion au catholicisme, lui, l’ancien militant communiste, en vient à convoquer l’enfer de ce qui se dévoile et aussi le paradis qui oppose l’amour au nihilisme.
Le voilà frère de Pasolini, communiste, marxiste en économie, catholique, le voilà, je le suppose, d’accord avec Kierkegaard énonçant que l’homme vient au monde pour vivre, non pour comprendre. La foi vive ne se commande pas, il faut la vivre au monde, et le monde se vit en réalité. Retour à Clément Rosset qui approuve le réel dans la joie sans en gommer les aspérités désastreuses. Ainsi raisonne Boulanger, il le rappelle, toujours dans ce même entretien : « Clément Rosset, c’est le philosophe du tragique et de l’allégresse, c’est celui qui accueille l’offrande du réel et qui (…), d’un livre à l’autre, déjoue la pensée systématique promettant une vie meilleure, différée, illusoire. » Le double que décrit Rosset jusque dans son dernier souffle, son compagnon en humanité, cherche des faux-semblants dans le nihilisme ambiant, espérant ainsi échapper à son destin tragique. Le fantasme du double est une fuite en avant, une faute contre le réel. Rosset est en empathie avec celui qui passe le miroir mais lui reste debout, face contre face.
En quoi Boulanger diffère-t-il de Rosset ? C’est qu’il croit (et le verbe croire est important) que la Chute a bien eu lieu et que l’histoire est toujours la reconduction de l’enfer. Mais, je le répète, le poète Pascal Boulanger pose son sac dans l’or du jour. Comme Rosset tombé dans le réel, si ténu soit-il, dit le vrai dans la joie du peu, Boulanger est dans la sensation au monde, le tremblement de l’amour guerroyant le nihilisme. C’est Alléluia encore un été ! avec torrents lumineux & vibrations dans l’air, comme le pose le poème Le bel endormi. S’il fallait ne retenir qu’un seul vers de toute cette anthologie, pourquoi pas celui-ci ?
L’image du monde est une paroi surchargée de gravures qui se recouvrent, lit-on dans Tacite, mais aussi ils se frottent (les hommes) les yeux en fixant la lumière électrique d’un monde dissous. Revoici le double de Clément Rosset, celui de René Girard aussi.
Voilà, la poésie est philosophie, et même philosophie première comme l’est celle d’Héraclite. Pour Héraclite, le commencement ne diffère pas de la fin. La poésie d’Héraclite ignore la musique de la stance, celle de Pascal Boulanger l’approche mais ne s’y noie pas. Elle préfère sculpter les images, les idées, elle préfère peindre. La poésie est palimpseste : elle gratte, régurgite, nettoie, réécrit ce qui est écrit. Elle va, forcément, du chaos au logos, au cosmos organisé.
C’est ce que dit le recueil Cherchant ce que je sais déjà. Pur joyaux. Quel besoin de connaître, je sais, je sais déjà sourit le poète. Noli me tangere.
Me voici
Ici
Mais pas ici même
Ailleurs
En partance
Mais ici
Avec moi-même
Sans être le même
Cherchant ce que je sais déjà est le recueil que je préfère de Pascal Boulanger. Il est celui du dévoilement, de la solitude, de la vie intérieure où toujours la révolution commence, pour paraphraser Pasolini.
Même si ma chance
n’est plus qu’une flamme de la mort
Je goûte encore
la présence d’instants dans l’instant
J’efface le jour en me jouant des bornes
et je cueille les roses qui m’absorbent
lentement dans le vide.
Ce besoin de joindre Pasolini et Boulanger peut sembler étrange car l’un est l’homme du passé, mal dans son présent, l’autre celui du présent assumé, incontournable. La présence goûtée d’instants dans l’instant signale cette force de Boulanger, force qui lui permet d’effacer le jour, c’est à dire de prendre le jour à son compte. Le poète s’habille des roses offertes pour affronter le réel absorbant. C’est le rythme, le phrasé, la profondeur des vues, l’engagement politique en poésie, le rejet de la « religion » égalitaire qui rapprochent les deux hommes. Les deux, le nostalgique et l’ouvrier des jours, sont pertinents, éclairants, proches dans le style.
Une fois né, on n’a jamais tort de vivre, énonce le recueil Un ciel ouvert en toute saison, recueil dédié aux deux filles du poète. Dans l’émeute du cœur se construit la vie vraie et la prolifération inattendue du simple. Ainsi le Chaos des origines s’effondre dans l’Amour, ainsi se construit le cosmos. Le fils de l’ouvrier couronné d’épines (Le lierre la foudre), se cache sous le manteau du poète (entre autre vêtements). C’est dire l’engagement de Pascal Boulanger pour sauver ce qui peut être sauvé dans l’enfer des jours. Par l’Amour mais conscient que la ville brûle.
Nous disions Cosmos, disons cosmologie, qui est une métaphysique. Mourir ne me suffit pas, écrit l’Anthologiste voyageur du réel. Une Anthologie voulue par lui « de son vivant », construite, cosmique littéralement et littérairement. Il faut bien en venir à l’essentiel de Pascal Boulanger :
Les douze pierres
Ils jouent la tunique au dés
près de la croix que chevauchent les oiseaux du ciel
mais l’habitant des tentes sommeille avec candeur
sur les douze pierres éparses& les anges qui montent et qui descendent
sur la terre noyée et sans contour
bruissent dans son oreille.
La parole des anges construit le sens de la poétique de Pascal Boulanger, qui, constructeur cosmologique, crée le monde comme sumbolon (ce qui rassemble les deux parts du tout) opposé au diaballein (la division). Le poème titre de l’Anthologie, qu’il faut bien dévoiler, est Trame, texte de Jean Follain repris dans Mourir ne me suffit pas. Voici ce fulgurant quatrain, pris à un autre car tout est transmission :
La même lettre de plomb
sert pour imprimer
l’infâme décret mortel
et la prière au ciel chrétien.Jean Follain
TOUT EST DIT de l’œuvre poétique de Pascal Boulanger (une vie pour le dire). Non… car, auteur d’un dernier recueil, L’amour là, hors Trame mais quand même dans l’ouvrage ! Pascal Boulanger, en un sursaut du sexe ravageur, rassemble les deux parts du sumbolon dans un hymne d’amour à la femme, la femme porteuse du monde, dans les sens propre et figuré, comme réponse possible au chaos.
*
Lydia Padellec, Cicatrice de l’Avant-jour
L’avant-jour est l’ultime chant de la nuit blanche. Lydia Padellec, poète, auteure notamment de Et ce n’est pas la nuit, paru aux éditions Henri en 2013, signe aujourd’hui un recueil des moments suspendus d’une nuit d’été finissant entre musique et musique : celle d’un groupe de rock se produisant au Bataclan le 13 novembre 2015, celle de la mitraille d’un groupe armé semant la désolation parmi les spectateurs et flâneurs. Impactée, Lydia Padellec décrit l’obscur, force du réveil, dans un recueil superbe, Cicatrice de l’Avant-Jour, qu’Al Manar édite, comme le fruit ultime et espéré d’une branche formée des six milliards d’humains.
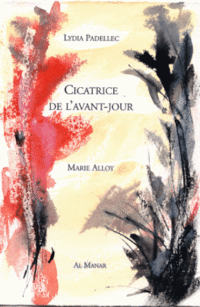
Lydia Padellec, Cicatrice de l’Avant-jour, Al Manar, 17 €
Bien sûr, cet acte d’écriture, qui est une action, répond aussi au besoin de l’auteure de remettre de la chair sur le souvenir de l’autre, afin que chairs et chairs ne forment plus qu’UN.
Nuit blanche. Formée de cinq chants (le premier, Dans la nuit profonde du jour, le second, Chant de la dernière nuit, le quatrième, Nuit de sang, l’ultime, La Brûlure de cendres), cette somme poétique s’articule autour de l’axe formé par le troisième d’entre eux, Cicatrice de l’Avant-jour. Le jour est une parenthèse de la nuit, la porte étroite de la nuit :
Le miroir te regarde
Comme un enfant perdu
Au milieu du noir
(…)
Le miroir comme outil d’un retour de la lumière. C’est ce que raconte 1. Dans la nuit profonde du jour, quasiment comme introït. Et comme pour préciser en quel lieu la nuit agit, éclairons :
(…)
et dans la nuit profonde
du jour qui vient
tu entends encore les mots
frapper la lumière
Ainsi ce sont les mots qui seront révélateurs de la lumière, les mots, cette géométrie de l’âme, l’épée d’argent du poète.
Mais dans ce jour « d’avant », qui oublie qu’il n’est qu’une parenthèse, est rappelé que le reste, soit l’essentiel, est à écrire, toujours :
Assis contre la nuit
tu feuillettes un livre
aux pages blanches
(…)
C’est alors qu’est envisagé le franchissement du seuil du miroir / porte :
(…)
tu attends le signal
pour chausser tes bottes
et fendre la nuit
Mais 2. Chant de la dernière nuit obture le passage, élève un mur. La douleur est trop grande pour penser :
La nuit verse son obole
dans la gamelle du chien
dans la bouche béante
du mort qui s’ignore
(…)
La mort ne se pense pas, elle advient ; et seul l’autre, le rescapé, « sait ». Le 3. Cicatrice de l’Avant-jour ne marque pas une rupture mais une différence d’état, de statut de la nuit. Le rescapé pense la nuit définitive de « l’évanoui » comme noir absolu, et envisage la parenthèse du jour comme la « possibilité d’une île » pour lui-même ; Michel Houellebecq, dans son roman La possibilité d’une île, avance que « le bonheur (n’est) pas un horizon possible », Lydia Padellec, dans 3. Cicatrice de l’Avant-Jour, appelle la venue de l’aube. Celle-ci ne vient pas. Un poème Houellebecquien dans le fond l’énonce, qui forme l’axe du livre :
Replié dans le vent
l’arbre guette
la lueur de la lampe
qui s’évapore
de la fenêtre close –
Je suis dans mon île
halo lumineux
à l’épiderme fragile
île entourée d’ombres
aux grimaces de pierre
Pour parachever le profond désarroi de celui /celle qui reste :
Clair obscur
de ma mélancolie
les mots ont un goût de cendre
Dans ce 3. Cicatrice de l’Avant-jour, Lydia Padellec récuse la possibilité au géomètre / poète de nommer la perte (les mots disparaissent dans le feu). Elle tangue, avoue son ignorance :
J’ignore où me mène
le poème
par le bout du nez
ou en bateau
vers je ne sais
quelle île ou pays
(…)
4. Nuit de sang s’ouvre par une citation de Jean-Marie Kerwich : « On croit que les étoiles sont dans le ciel mais elles sont sous nos pas. On les écrase. Ce qu’on voit briller dans la nuit, ce sont leurs cris. » 4. Nuit de sang, c’est le repentir du poète agissant en peintre, l’irruption du souvenir qu’on voudrait ériger en forme vivante…une transgression. C’est un leurre, peut-être, mais assumé par Lydia Padellec, CONTRE la vérité. Où es-tu mon amour est la question récurrente de celle qui cherche dans Paris vêtu d’un manteau ténébreux, l’ombre du cri fille des étoiles.
Ainsi s’achemine le poème vers sa conclusion livrée dans 5. La brûlure des cendres. La mémoire désigne une clé : la recherche d’une fissure dans la réalité, non pour trouver le bonheur, mais pour briser la peur de rester. Dernier poème dédié à Clara :
Peler nos cicatrices jusqu’à l’os
(…)
nous voulons tous embrasser l’aube
(…)
nous vivons dans des maisons
de pierres et de cendres
nous cherchons la fissure
qui laissera passer
le souffle
le poème
brisant le roc
de nos peurs
S’il est une possibilité d’une île, elle est dans la fissure éclairée par les mots. Et qu’importe la cendre si la brûlure nous consume et nous permet d’embrasser l’aube, même furtivement.
Le recueil Cicatrice de l’Avant-jour est illustré de gravures de Marie Alloy, peintre, graveur et poète. Le rouge éclate partout, sauf dans le cinquième chant, La brûlure des cendres, où la valeur sépia sature l’espace, comme pour rappeler que si le jour est une parenthèse de la nuit rouge et noire, sa lumière reste fragile, obscure. Saluons également la belle mise en page et le parfait travail éditorial d’Al Manar, éditeur précieux.