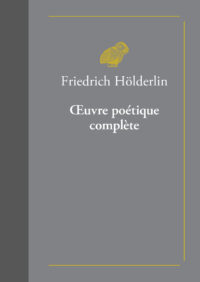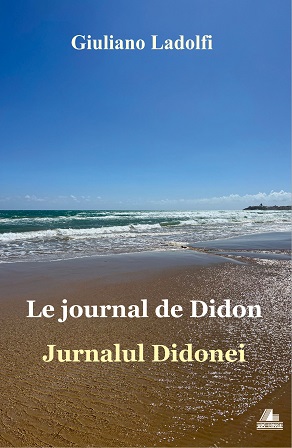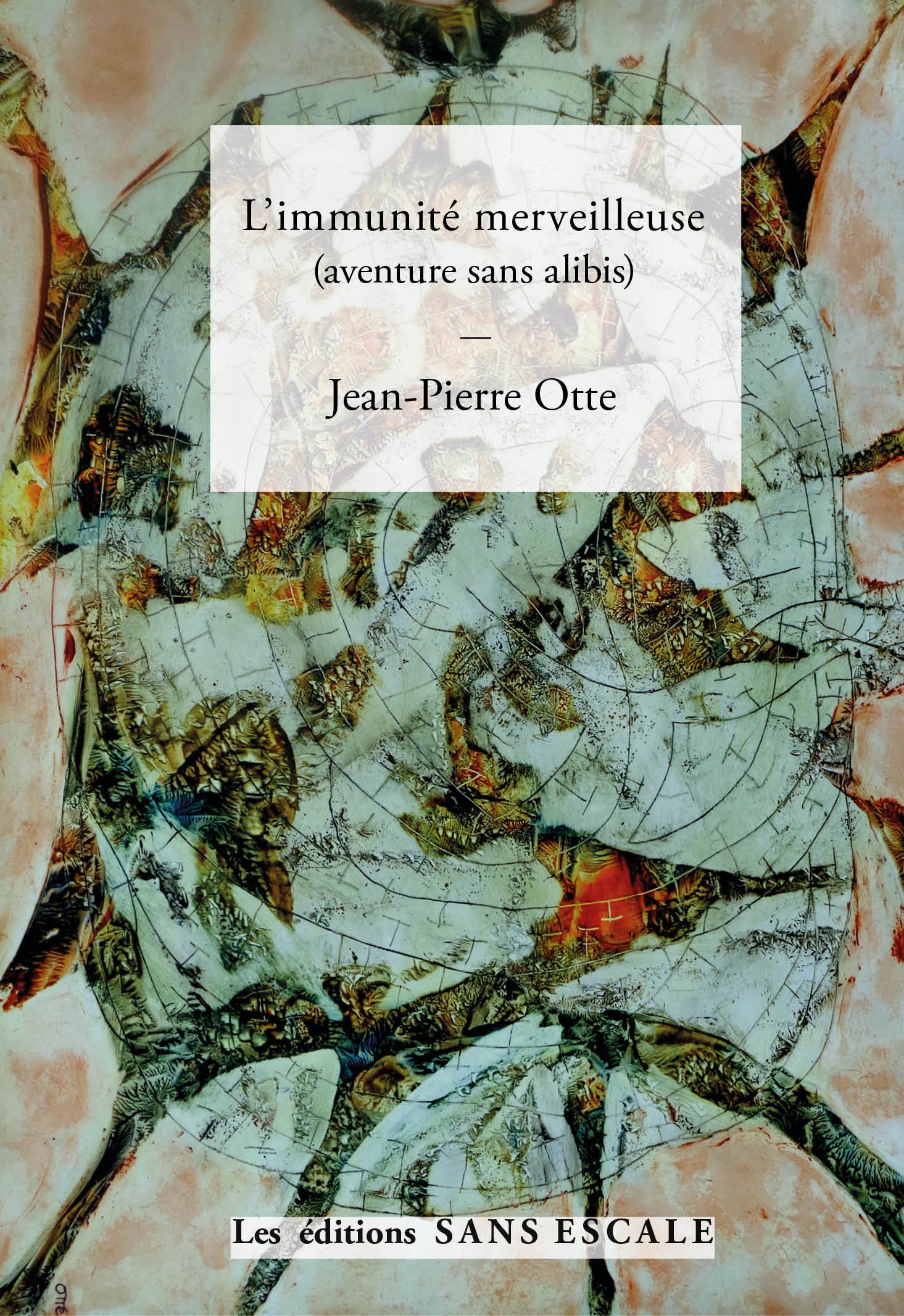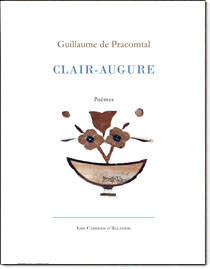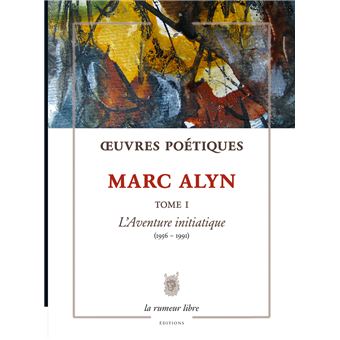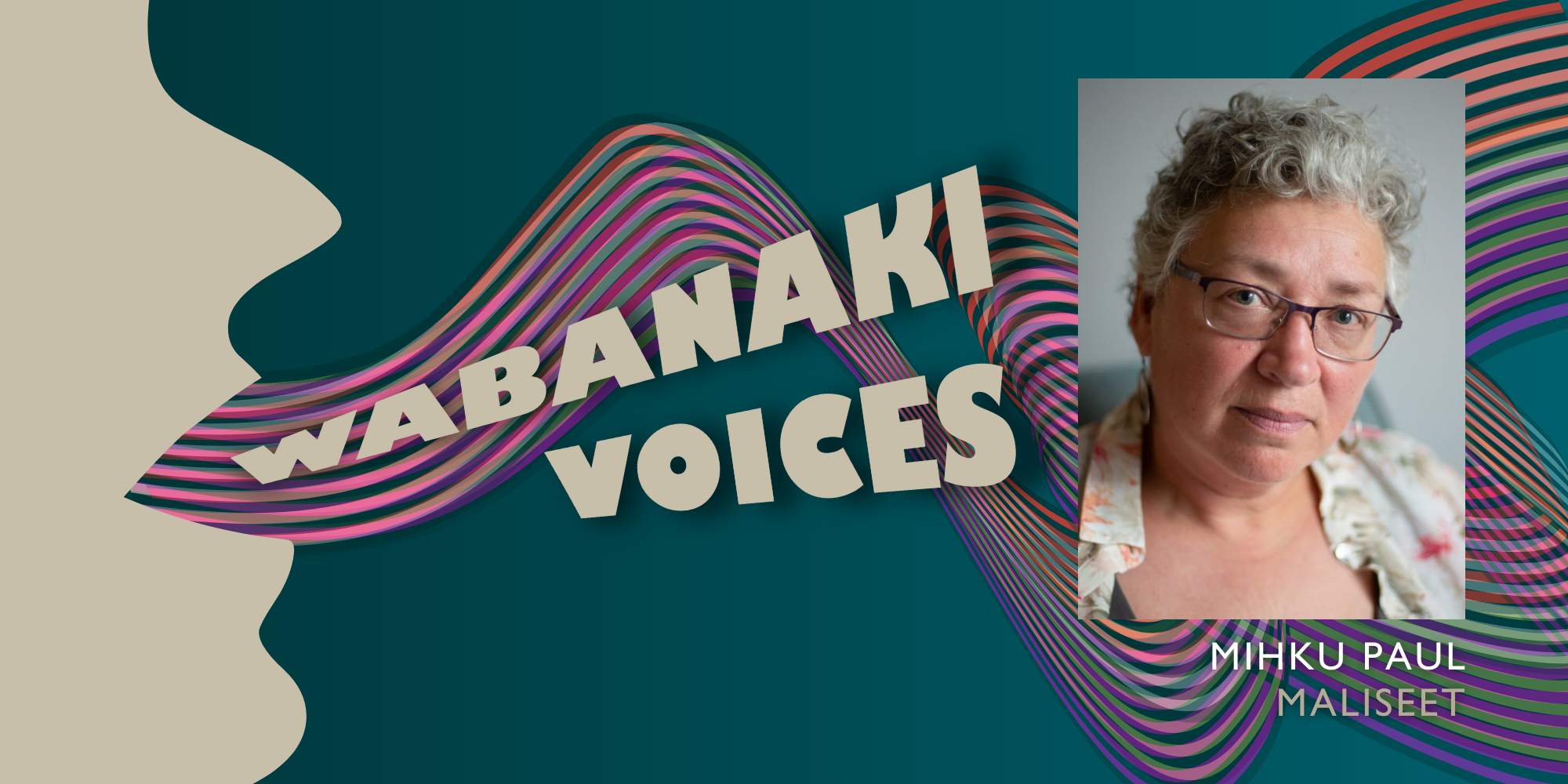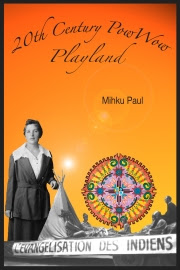Autour des éditions de La Crypte : Romain Frezzato et Benjamin Porquier
∗∗∗
Romain Frezzato, comme un david aux testicules tombés
Les éditions de La Crypte sont des découvreurs et ont l'habitude de publier de jeunes auteurs (j'entends par là de moins de quarante ans). Cela se confirme avec Romain Frezzato, ce jeune enseignant chercheur en littératures comparées publiant là son premier livre de poésie. La majorité des lecteurs sera sans doute désarçonnée, voire outrée par ce livre à cause de la crudité assumée du propos et des mots pour le dire.
On se demandera parfois où est la poésie dans les quarante stations de ce chemin de croix particulier, car il s'agit de cela : la narration d'un quotidien que l'être aimé, désormais absent, imprègne de son fantôme, narration d'une traversée des jours, peut-être dépressive mais surtout pleine de rage, avec sans aucun doute un désir de provocation dans le dire. Alors, il ne faut pas s'attendre à quelque lyrisme que ce soit mais faire appel à l'étymologie, ποίησις , poíêsis (action de faire, création) pour accepter d'étiqueter ce recueil comme poétique. Cet avertissement posé, voyons de plus près. Le titre à lui seul est déjà un signal suffisant. Pour éclairer définitivement, voici le poème qui ouvre le livre :
1. JE N'IGNORAIS PAS
QUE DERRIÈRE LA
PORTE TU TE
FAISAIS VOMIRje n'ignorais pas que derrière la porte tu te faisais vomir
j'imaginais ton corps maigre enlacer comme un amant la cuvette fraîche
tes ongles emportant sans le savoir des particules indétectables
je devinais le flux encore très matériel de ton bœuf rossini
passer en sens contraire
avec patates et beans
à rebours de ton corps nigloland
et personne pour te prendre la tignasse
pas même l'image que tu te fais de toi
tes genoux sur le carrelage
des nuances de pisse imprégnées dans les joints
le spectre des accroupissements qui assiste au spectacle
moi derrière comme un chat qui gratte
muté en boudin de porte
sur lequel tu marches sans t'en apercevoir
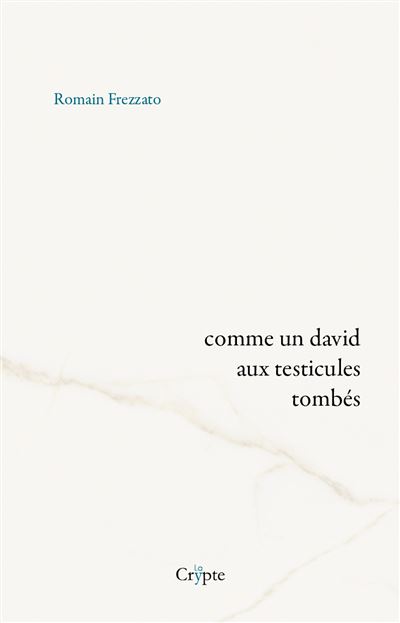
Romain Frezzato, comme un david aux testicules tombés, éditions de La Crypte, 2023, 64 pages, 14 €.
On notera pour ce poème, comme pour tous les autres, le titre en lettres majuscules, ce qui dans un courriel ou un sms signifie que vous criez. Par ailleurs, tous les poèmes sont justifiés à droite, montrant, de mon point de vue, comme un jaillissement (avec écrasement en bout de ligne). Quant à ce que montre le poème en question, le réel le plus cru, dit le plus crûment, c'est une sorte de prélude aux autres poèmes qui seront vomis, criés, sur le même mode.
[…] la couleur excrémentielle de ta tignasse
sur le lait caillé de ton épiderme
tes mains comme des viscères qui poissent
et tout ça quand même vertébré
tes ongles sous lesquels des bactéries prospèrent
[…]
Mais il serait injuste de se focaliser sur la seule forme et son lexique brutal. Cette écriture furieuse trouve son fondement dans des épreuves que la pudeur effleure :
c'était beau de te voir revenir à la vie
lever la tête de la cuvette et en ressortir comme vénus
[…] ce matin pour la dernière fois les portes automatiques du chu
s'étaient ouvertes
puis refermées
sur nous
et l'on a retiré ton cathéter
[…] et puis j'ai embrassé ton crâne
en espérant que ma salive
puisse faire revenir tes cheveux
Des vers disent simplement cette douleur faite de tristesse et de colère :
pourquoi je porte tes pulls
pourquoi je garde tes robes
pour qui je retiens tes colliers
dans le placard de quel pavillon dois-je suspecter le pire
où vont ces escaliers qui grincent
quel volet roule aujourd'hui sur l'obscurité
de ce qui fut jadis ta chambre
et cette jeune mère qui respire dans tes atomes
pourquoi tous les miroirs du monde cherchent-ils
à rendre compte de ton profil
quand ton profil compte ses cendres sous je ne sais quel marbre
Plusieurs poèmes balisent le recueil, de leurs observations acides sur le monde alentour, ce monde propret, terne, dans lequel l'auteur se sent étranger.
des gens qui regardent de la bonne façon
pensent de la bonne façon
sont représentatifs de leur génération
avec des cartes bancaires et des idéaux
Autre exemple :
que se cache-t-il derrière les murs
des pavillons de lotissement
sans doute des couples en crise et des enfants
qui essaient de contourner le contrôle parental sur l'ordinateur du salon
puis quoi encore des électeurs
des garants de la république
des mères de famille
avec des secrets enterrés sous les pétunias
Ou, encore avec ce regard qu'on sent ironique :
sur la banquette de moleskine
deux quadras très tendance
retirent leurs capelines pour me faire de la place
[…] mais les deux queers d'à côté ont commencé leur carrot cake
le premier a dit à l'autre
c'est quand même un peu sec
Cependant, quoi que le texte décrive, c'est toujours la figure en creux de l'être aimé qui traverse ces lignes pleines d'indignation et de mélancolie : il reste un trou à l'endroit où ta langue a percé / des courants d'air s'y précipitent ou en partant tu as oublié de reprendre ton odeur / je crois qu'elle s'est comme incrustée / ton fond de culotte renversé sur ma tête, avec cette prépondérance du corps, quand tu étais sur moi / je me suis réjoui du travail de tes hanches / et puis j'ai hésité entre beauvoir et eva braun / tes prunelles ont viré au blanc / et tu as fait ce truc avec tes fesses / on ne s'est pas endormis aussitôt, le corps donc qui procure la jouissance et nous indique dans le même temps notre finitude.
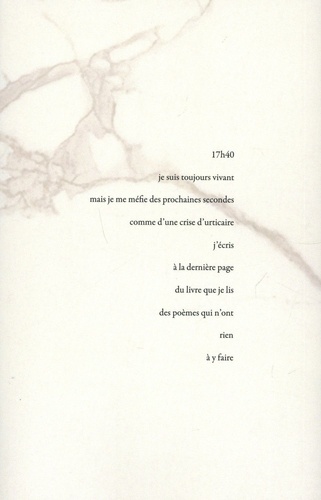
J'évoquais en introduction une traversée des jours, peut-être dépressive et pleine de rage :
[...] fasciné par le spectacle
d'une fille qui réapplique son maquillage devant la vitre du métro
l'ouverture de sa bouche je ne sais pas comment elle fait
[…] je ne m'étonne plus qu'à chaque fois le monde me rate
quand elle redouble sa tête de ce vide étonnant
[…] moi si j'ouvrais ma bouche devant mon miroir
pour y remettre ou non du rouge
j'aurais l'air d'un poisson en sang
Je terminerai (presque) par l'aveu de ce vingt-et-unième poème :
la vie m'est un gris adéquat
à 6h du soir je ferai ton sur ton
en flottant de la gare à chez moi
j'accosterai l'inaperçu
le scrutin européen
les enquêtes d'opinion
tout le territoire de la téléphonie mobile
les passants comme des panneaux
publicitaires
avec leur sac et leur casquette
les appels à témoins
et moi qui m'empresse au silence
le monde me passe
par le côté
ou
tout comme
Pour qui accepte d'être dérouté, voire choqué par moments, pour qui garde un esprit ouvert et désireux d'explorer, il découvrira une langue (qui est aussi le propos de ce livre).
que tu me touches se transforme en syntaxe
que je te sente se fige en grammaire
j'ai fait des accents de tes cils
tu ne sais pas à quoi tu t'exposes
∗∗∗
Benjamin Porquier, Saudade
C'est le deuxième livre que Benjamin Portier publie aux éditions de La Crypte, le premier étant Heimat. Ils ont été conçus comme un diptyque, mais on peut les lire indépendamment l'un de l'autre.
De belles peintures, dues au père de l'auteur, accompagnent les poèmes. Puisque le mot saudade est portugais, on trouve en exergue une étymologie (en portugais) de José Pedro Machado qui nous explique que le mot vient du latin solitate (solitude) et qu'il peut se traduire aujourd'hui par nostalgie. Ainsi, le livre s'ouvre sur ces vers :
il existe un instant qu'en tout lieu
l'on traversera
comme on épluche un oignonchaque strate mère d'un autre oignon
chaque strate chair à pleurer
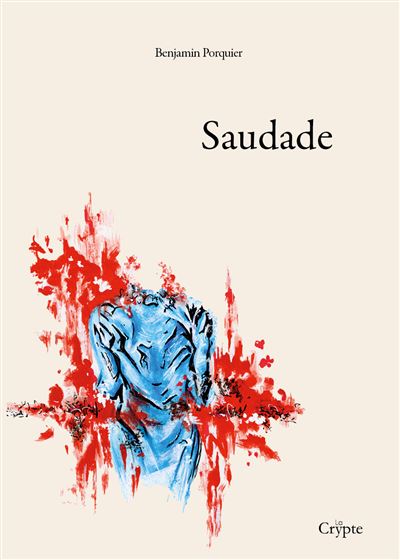
Benjamin Portier, Saudade, éditions de La Crypte, 2023, 144 pages, 18 €.
Le livre présente toujours sur la page de gauche (à une ou deux exceptions près) un poème dans lequel figure le pronom elle écrit en italique et sur la page de gauche un autre poème d'où il est absent (là aussi à une ou deux exceptions près). Ces pelures d'oignon, enlevées une à une, en découvrant une autre, sont comme des pellicules de souvenir qui dévoilent au fur et à mesure mais renforcent aussi l'énigme quant à cette mystérieuse elle, disparue, enfouie dans la mémoire ; elle ne suscite pas seulement la nostalgie, elle finit par être Saudade. On notera par ailleurs que ce qui concerne les principaux protagonistes, les mots qui les évoquent sont toujours écrits en italique, que ce soit elle ou le narrateur : je, moi... Tout se passe comme si le monde alentour était durement concret alors que ces deux-là flottent dans une sorte d'évanescence...
Oh mon amour je t'en supplie
ne me considère pas
ne me reprends jamais
toi qui as aboli la meilleure part de moi
Alors que les mots désignant les autres sont écrits en lettres majuscules (comme une menace) : l'agenda des GENS, CEUX qui les avait gravées, QUI a vécu douze vies, ON aurait le penchant, VOUS savez, etc.
marcher
parler
lire et écrire
patienter au rouge
compter
demander l'heure aux PASSANTsil lui a tant fallu apprendre
pleurer par contre elle a su tout de suite
Certains mots sont barrés, ajoutant à l’ambiguïté, à l'interrogation. Tout juste aura-t-on repéré qu'ils concernent des personnes, le lien familial, mère, parents, sœur, famille, ta fille, ton fils, l'évocation d'éléments météorologiques, il pleut sur la pluie / bientôt il neigera sur la neige, mais aussi des mots comme demain et systématiquement le mot amour. Enfin, comme pour les étirer, en forcer l'articulation, certains mots sont découpés : in-sai-si-s-sa-ble, l'ar-tiste engagé / s'il l'é-tait vraiment / ne serait-il pas plutôt a-piculteur, non-cha-lant, vo-lon-tai-re-ment.
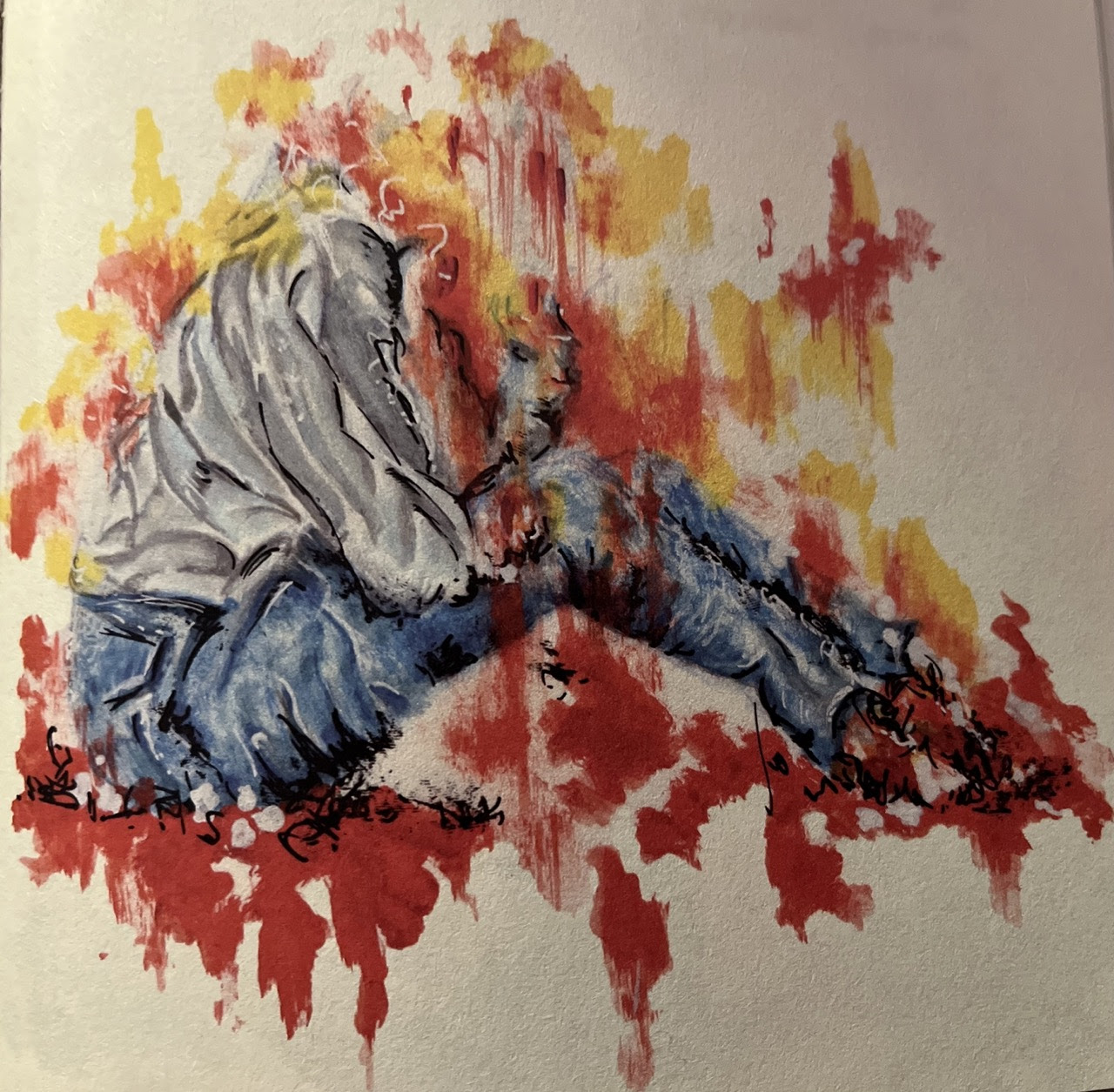
Ces aspects formels relevés, il est difficile de dire précisément ce que narre cette saudade : des instants, des sensations...
sous la pergola
le soleil en grappes vertes sur son front
ON peinerait à différencier elle
d'un chat
Ou encore :
comme on rançonne un supermarché
deux amants
l'un en l'autre se fondent
dans le tumulte un peu navrant
des vieillards arthritiques
puis s'assoupissent
Insertion du réel dans le poème, comme observé à travers une vitre embuée :
file une étoile
entre les lampions de juillet
c'est doux
comme une pincée de sucre
saupoudrée sur le jeûne
Réel le plus insignifiant parfois, tissant les mots du poème en la mineur : tandis que sur la cheminée les plantes / poursuivent / leur hivernage quiet
Mais c'est bien évidemment elle qui est présente tout au long du livre :
d'humeur badine
elle prends des poses sur l'escalator
memento mori
et c'est toutaujourd'hui a un goût de chlore
sirotant l'avenue
sous leur masque de carnaval
carpe diem est le nom de EUX
Un vers parfois concentre à lui seul une émotion forte :
la joie de elle comme un filin étroit
Le livre entier est un hymne en même temps qu'une nostalgie, une entreprise de raccommodage d'une blessure vive, comme en témoigne le mot kintsugi employé par deux fois. Il s'agit d'une technique japonaise de réparation des porcelaines et céramiques brisées, au moyen de laque saupoudrée de poudre d'or. Les cicatrices sont ainsi comme idéalisées et l'objet s'en trouve plus beau.
une balafre pour le ventre
une balafre pour les poumons
une balafre pour le premier soleilkintsugi
Et à la dernière page :
et elle
à égale distance de chimères
et de kintsugi
de la femme elle est une ébauche
une tentative
Il faut se laisser aller à la lecture de ce beau livre comme on le ferait pour une rêverie, accepter le flottement avec elle, saudade.