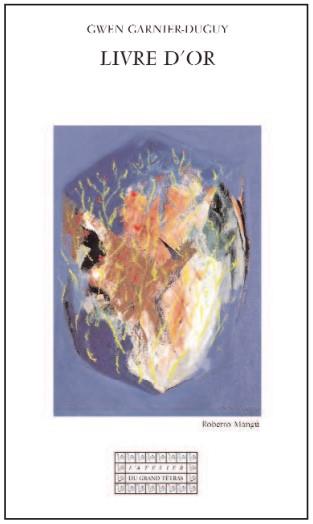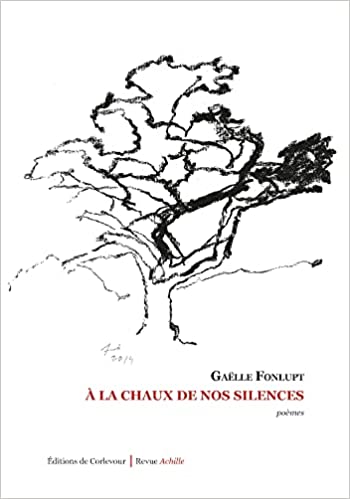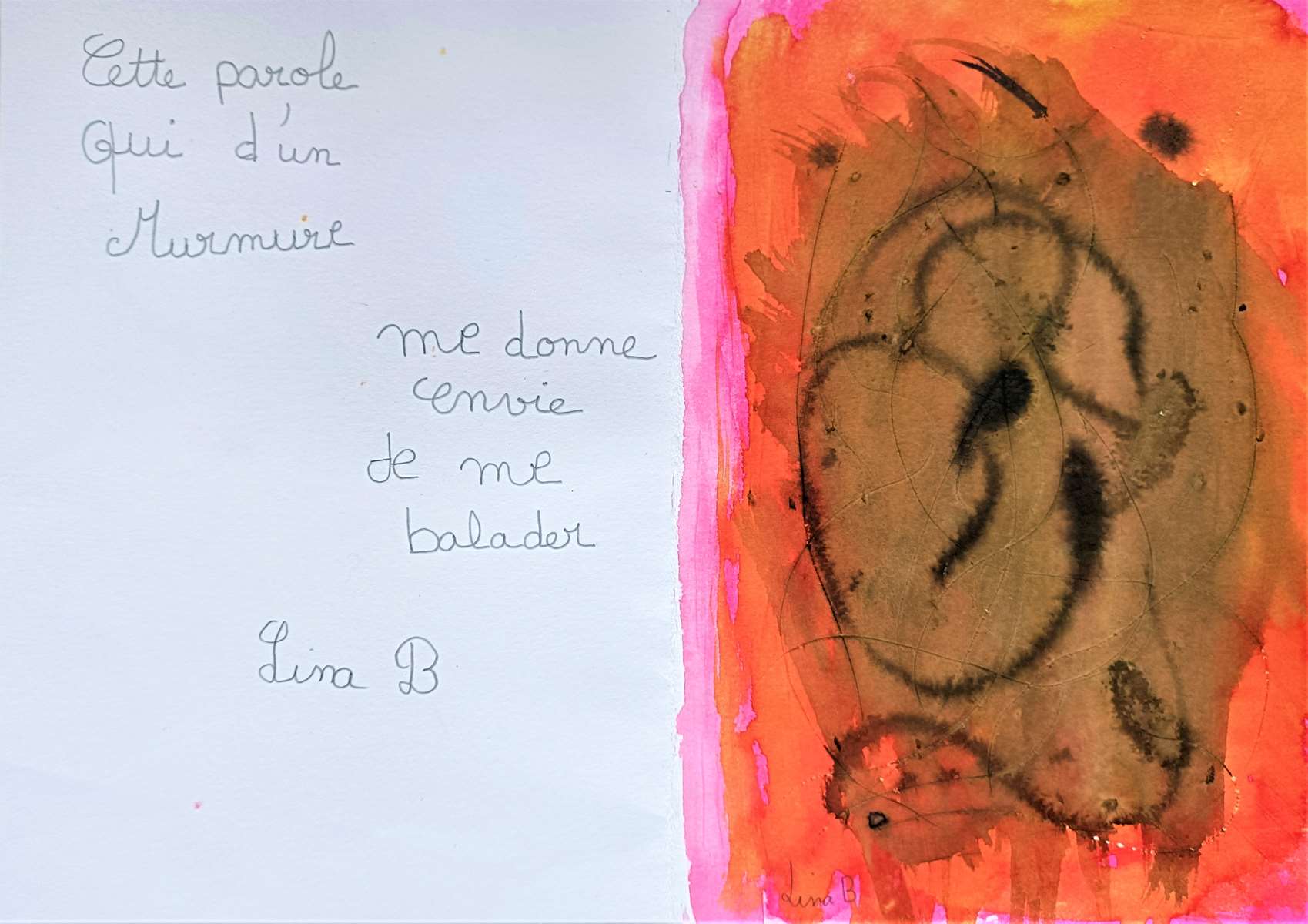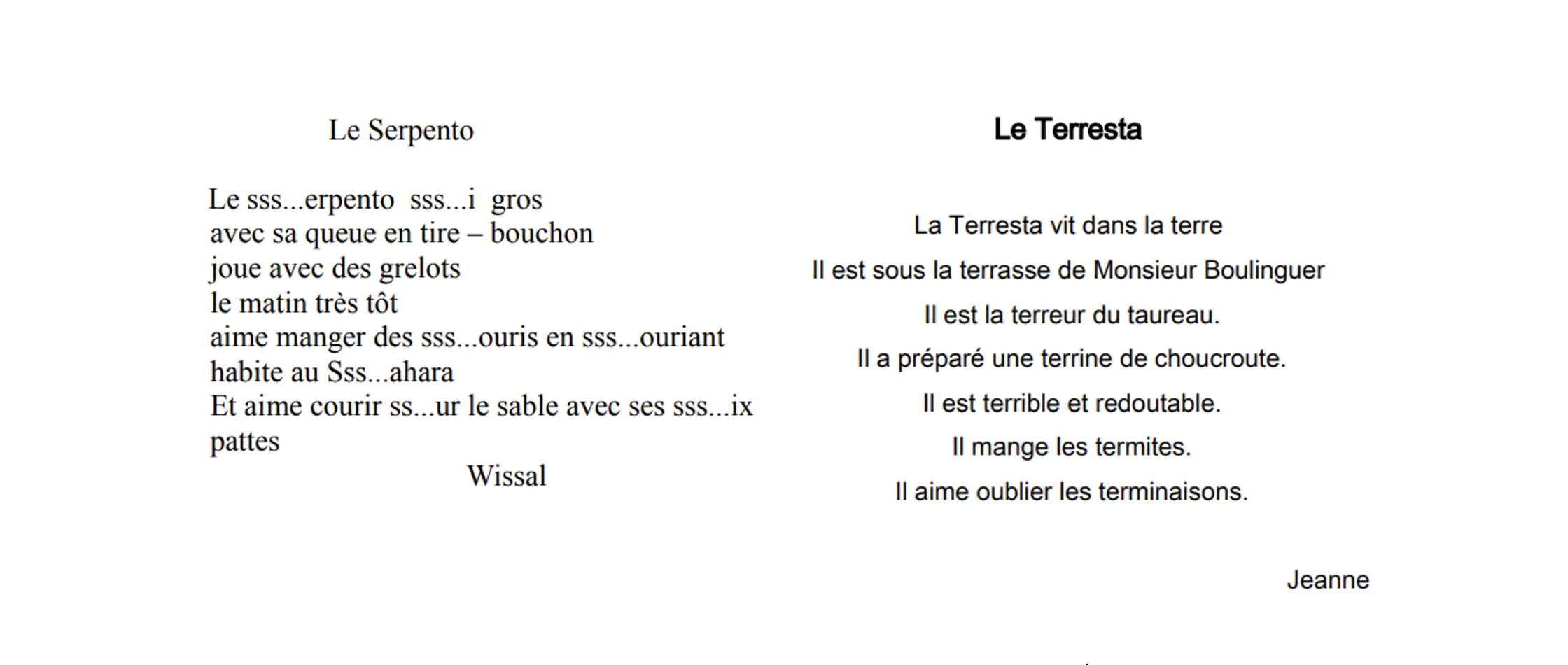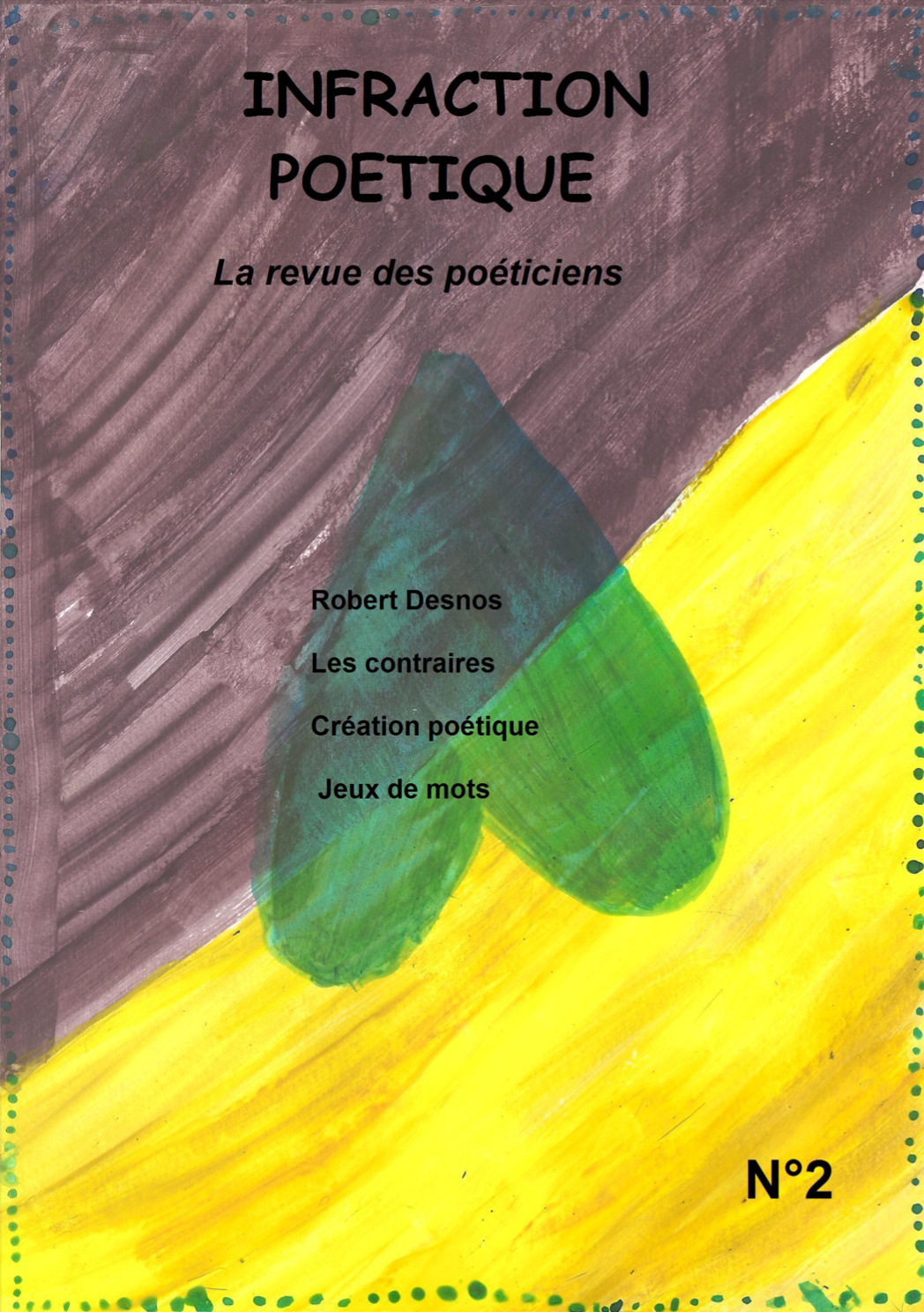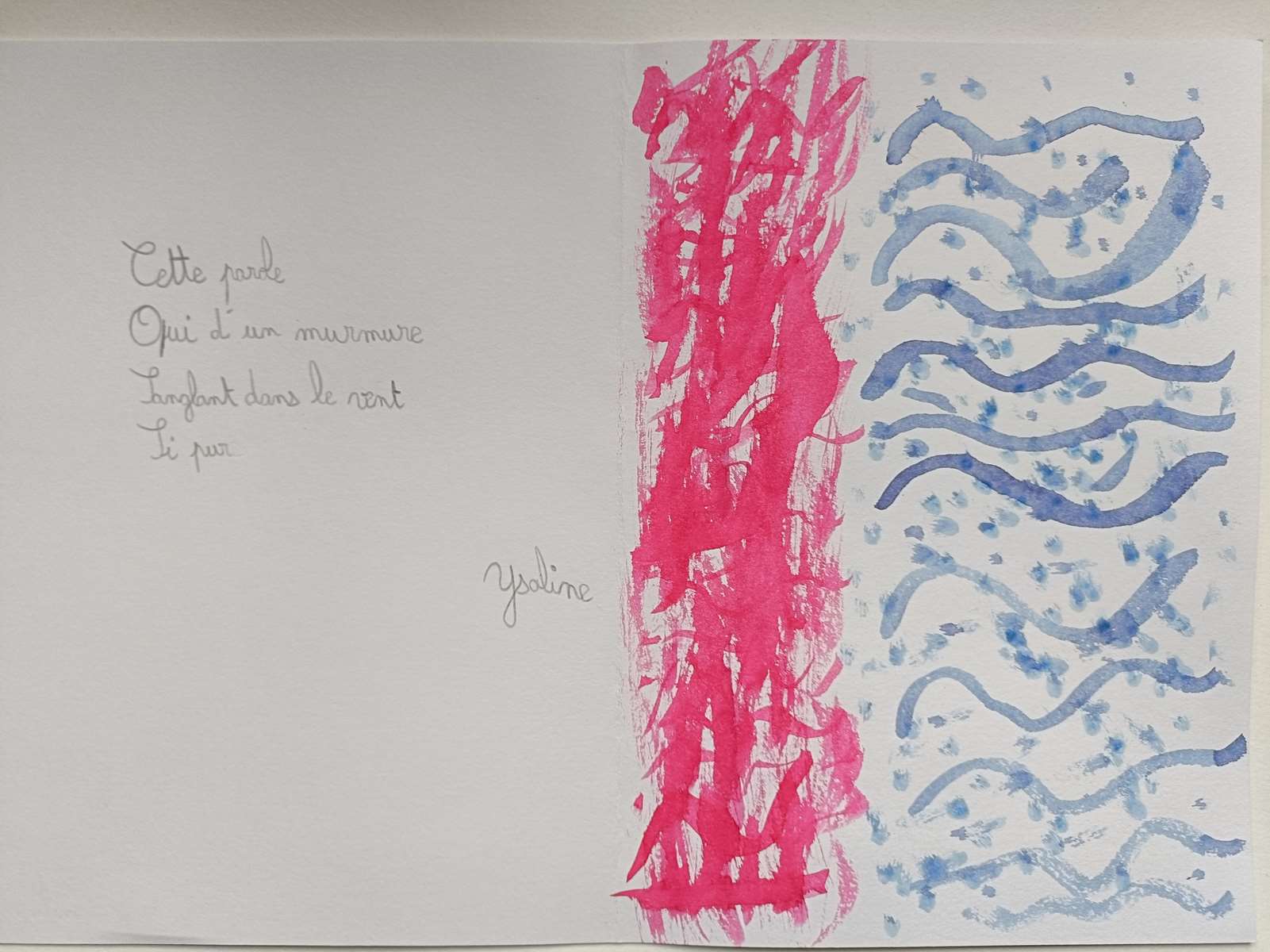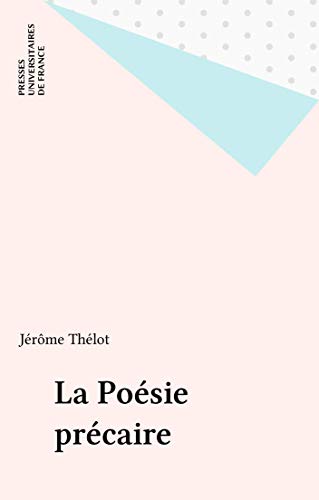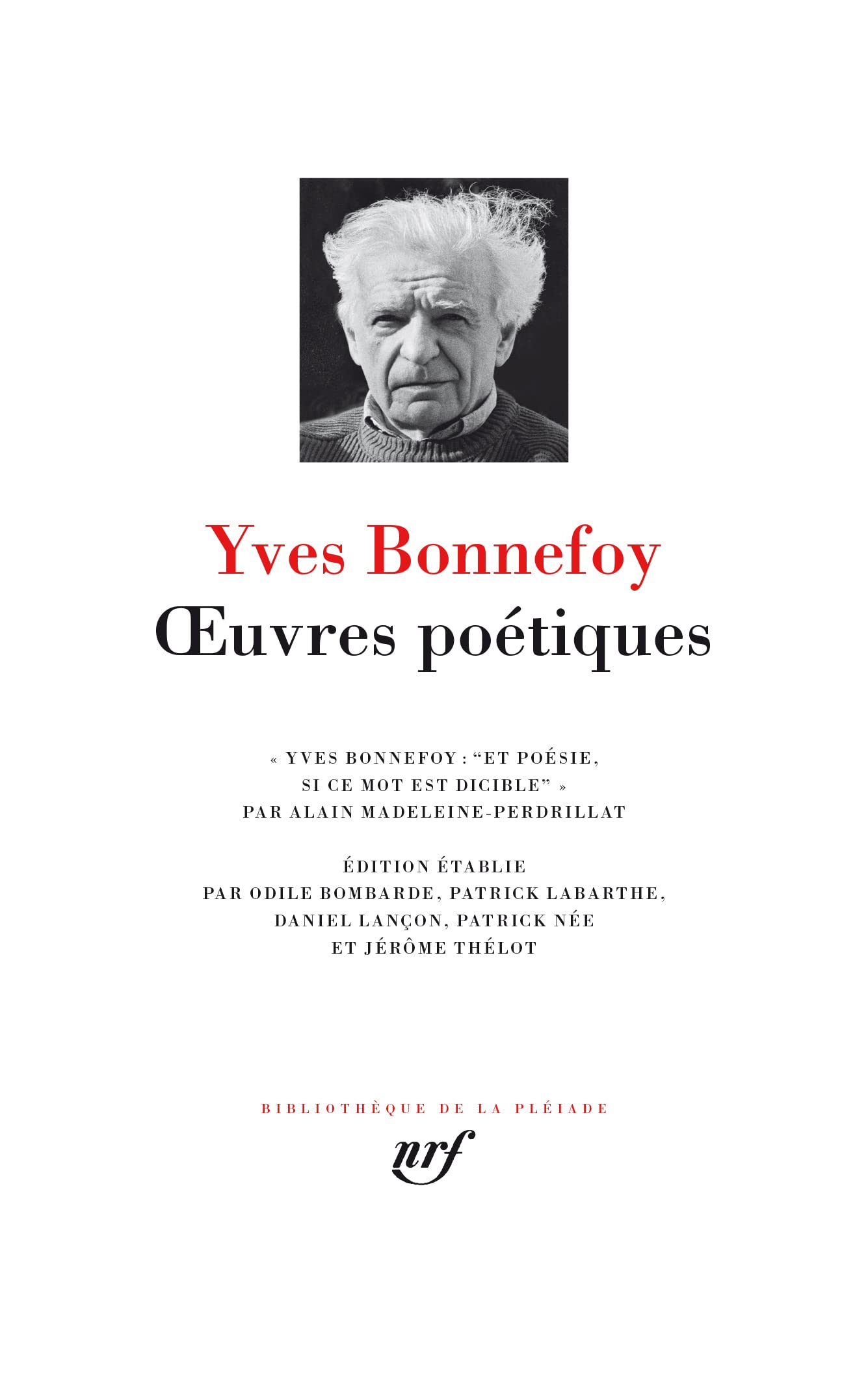À voix haute, ne résistant pas au désir qui nous envahit au fil des pages de confronter cette parole intérieure à l’épreuve de l’air, nous entendons surgir une langue du corps-source, une langue source-exil, comme celle puissamment présente au cœur de l’œuvre de Bernard Noël, « du nombril à mes cuisses », une langue d’affrontement, de résilience aussi, de multi sensorialité poncée à l’établi des mots, à l’établi des chairs et de l’âme qui voudraient parler. S’incarner dans la langue des germes.
C’est en la lisant ici que nous devenons solitude, puis présence, son amant, son ami, celui qui, tenu par la main de ses métaphores, vacille, chavire avec elle, comme si danser la douleur devenait Joie et Requiem, souffle mot à mot d’un cantique, plongée au-dedans comme dans rivière engourdie, prière inventée juste pour nous, faire face à la brûlure mère du silence, nous répéter, je suis là, je suis là, je traverse, j’éclos, je suis celui devenu celle qui, à chaque trait acéré du vers, se brise, se reconstitue, coagule et affirme « robe retroussée peau crue brouillée /… / je bois le bleu nu». Mon androgyne s’avance devant moi et boit les paroles de cette ombre profonde couchée en moi. Buvez avec moi. Buvez-moi.
Rare, précieuse, et précise au scalpel dans sa syntaxe, au ventre de cette soif partagée avec autant de pudeur, de discernement et de violence aussi, on sent monter une voix, et avec elle une sororité, du plus loin de la présence et de son animalité, écho du plus acéré des ténèbres aussi, du plus vivifiant d’Eros et de Thanatos, une voix étrange, prenante, fascinante, coupante comme « le fer d’une langue d’orage », un voix jeune mais affirmée, prometteuse, dans la tradition de « l’offrande en bouche » entre la pureté acétique d’un Roberto Juarroz et le lyrisme maitrisé d’un César Pavese.
Cette « chaux du silence » est de plus en plus vive au fil des pages, V.I.T.R.I.O.L du sens et du vide, testament d’une renaissance brûlée par le poème, et, sous le blanc du papier « la nuit assiège la douleur». Nous gagnons à mêler notre chair à celle brûlante de cette frontière entre lire et atteindre. La langue est nue sous sa robe. Saigner et signer nous guérissent de guérir.
Certains poèmes se dressent tout droit en éblouissements. Entre aphasie et marée haute. Déferlement et anéantissement. Courage de faire volte-face. Entre mourir et souffrir finalement. Puis, non. Tremblement de terre des émotions avant l’effondrement du moi.
Ce qui va renaître est inespéré. Un seul vers, une seule communion. Une consolation inattendue comme un bourgeon dans une haie d’épines. La terre sous nos pieds nous relie enfin à ce qui va nous dévorer, un jour, corps et âme confondus, en rendant à l’univers ce qui nous avait été prêté, le temps d’une vie.
De purs moments de pleine conscience ressuscitent le désir comme dernière chance donnée au souffle de s’incarner. Des cris essorés jusqu’à la transparence. C’est par cette densité d’une langue quasi alchimique, une quête de changer le plomb du chagrin en or de lucidité et de bienveillance, qu’on avance dans une immanence souveraine.
Quelque chose neige dans le réel. Et ce sont des poèmes. Quelque chose neige dans ce recueil : des éclats de voix aussitôt enfouis dans nos yeux, dans nos pensées. Comme des êtres à part entière. Et nous ne sommes plus jamais seuls.
Chaque vers nous apprend la bienveillance avec le monde et ce qui nous torture, clairvoyance avec nos deuils comme avec nos orgasmes, avec celui qui nous aime, celui qui nous blesse, car l’un et l’autre ici se côtoient à travers le vertige et la transe, comme si tu marchais le long d’une falaise.
Mourir et fleurir. Pleurer et sourdre sous le linceul avec les sources. Il y a tant de mystère dans cette vie déployée en palimpseste sous nos yeux qu’on incline son visage pour embrasser la gemme du non-dit et ses éclats. Coller nos lèvres à cette beauté sauvage de la pudeur ose nous dévoiler qui nous sommes. Nous embrassons Humains et Infinis dans la langue. Singularité et multitude.
Cette chaux vive brûle une à une, et j’assume le mot, quasi religieusement, tel un encens de notre propre chair, les écorces opaques de nos contours, comme l’amour brûle notre ennui, notre médiocrité, notre ego, encens de tous nos enfermements vers ce désir d’unité avec notre amour. Mais avec notre manque aussi. On dirait que le manque devenu douleur devenue poème féconde les arbres de cette forêt mystique où vivre serait perdre, accoster, se séparer, grandir vers l’être.
Voir, se battre. Il aura fallu l’écriture singulière d’une femme pour nous parler corps, corps à mort, corps Amor, nous ramener à une autre sensualité esthétique presque mystique dans son essence, à la limite du renversement de la douleur-plaisir, de l’effroi-renoncement et de la contemplation-combat. Dans la parturition de cette fécondation par l’image, quand il y a recherche d’effacement de soi et des dualités, surgit une troisième voie, voix, celle du centre. Une voix du Soi en quelque sorte.
Corps rond ou brisé de la mère, aigu de l’amante. Corps du désir, corps de l’attente. Du don et de la perte. Vécus des rythmes qui vident les chairs du rythme. Lire, cette parole de l’oscillation et du vacillement, comme s’inverser, entrer en contact avec son anima, basculer du yang solaire au yin lunaire de la fécondation.
Il existe en poésie une écriture féminine avec son identité propre, j’en suis certain, ce livre en donne une tonicité de plus. Elle nous pénètre et nous éparpille en son sein comme pollen, père et enfant du silence. Le dieu de la lumière lui aussi se féminise. « elle s’allonge sur le vent / s’ouvre à deux mains /attendant que le soleil en elle se fende »
La spiritualité commence avec cette ouverture vers ce qui se cache. Nous finissons échoués, inversés et émus sur la dernière page, dénudés par l’essentiel d’un chant lyrique, grave et contagieux, Robinson d’une rencontre qui nous murmure avant de refermer le livre.
« j’ai si faim de renaître »
Merci Gaëlle Fonlupt pour ce voyage initiatique.