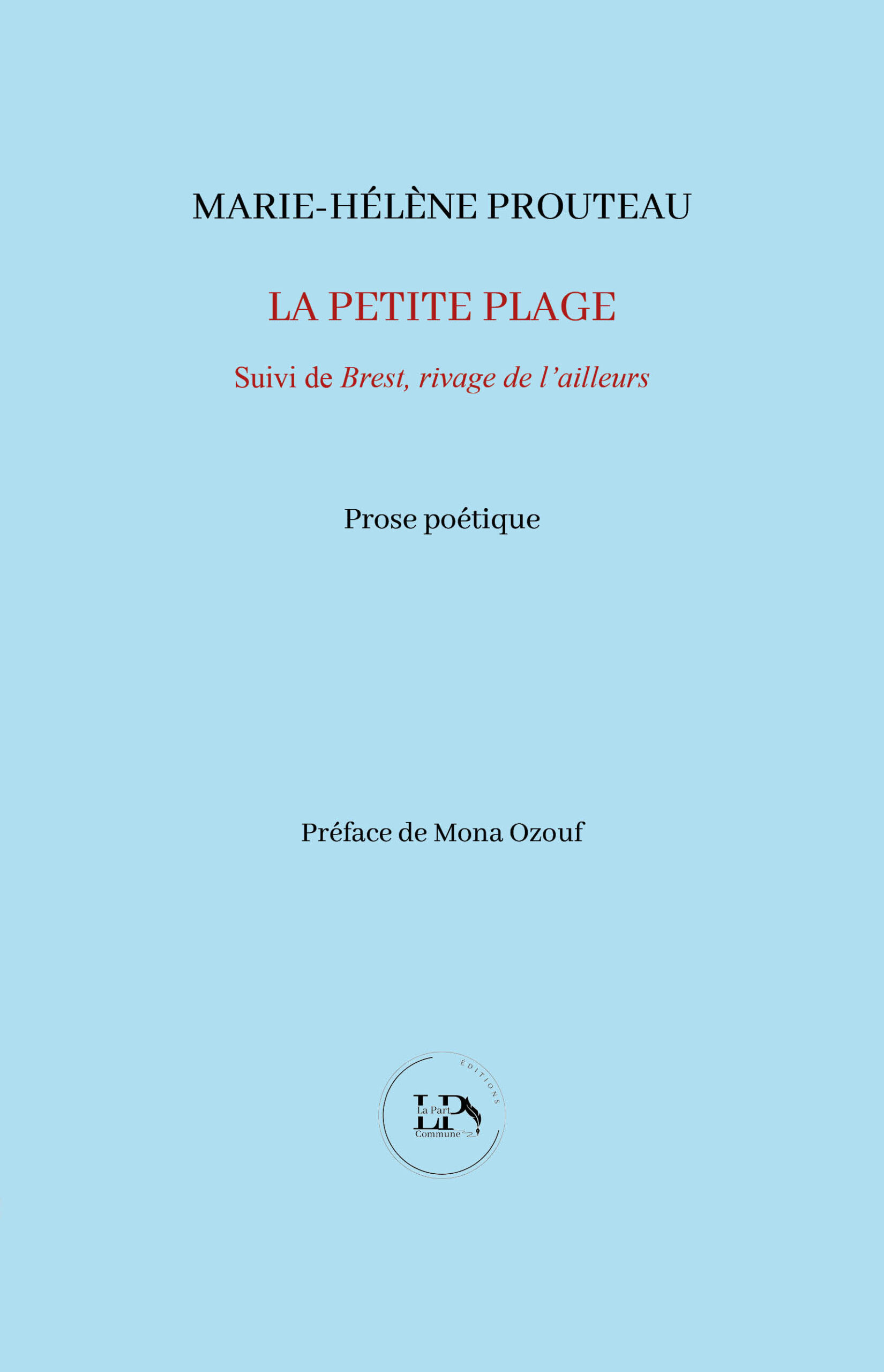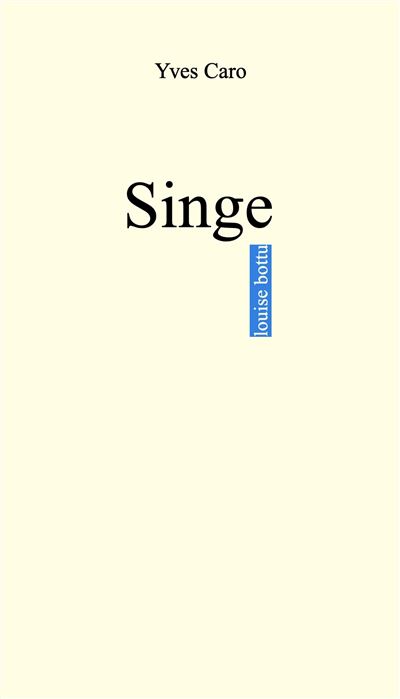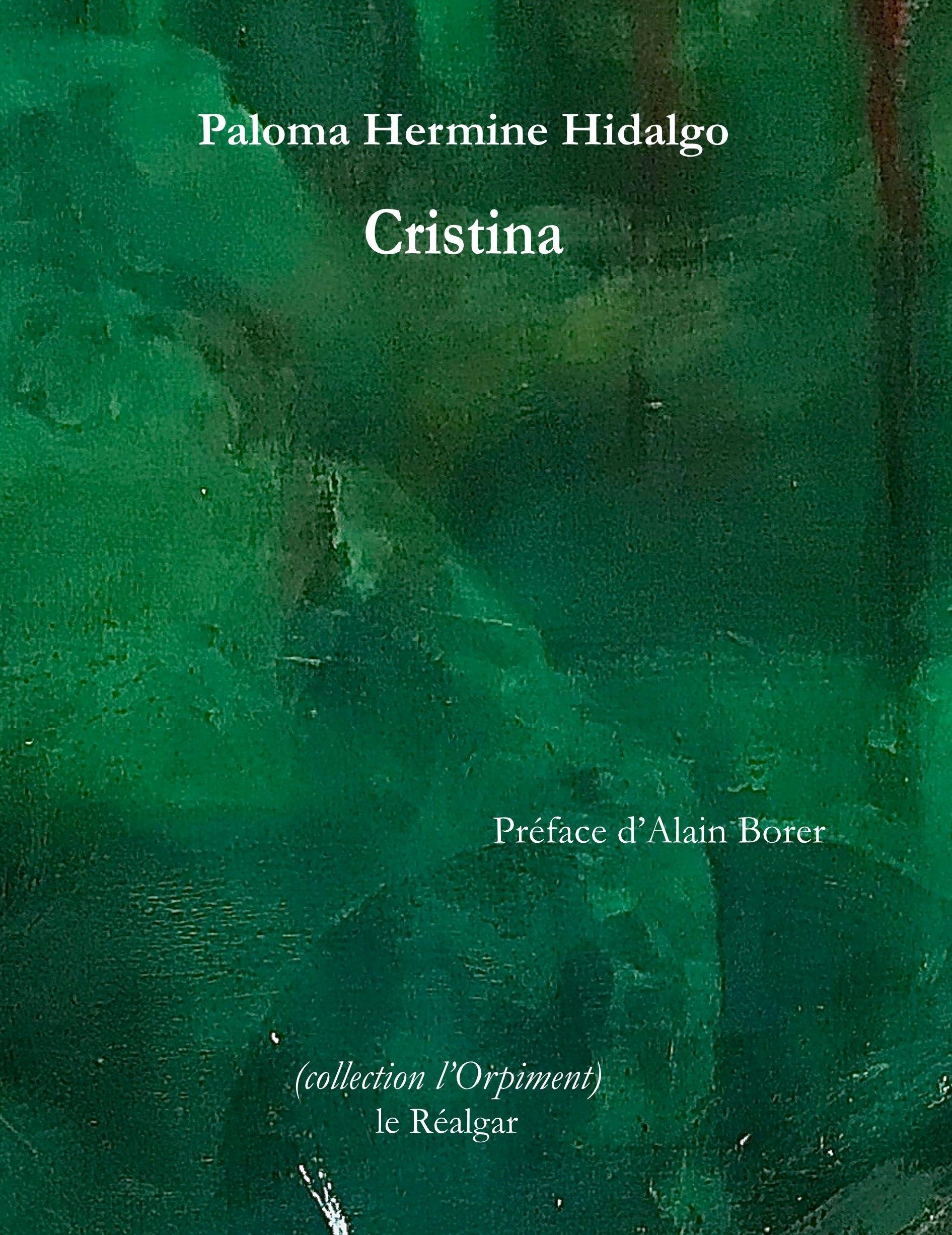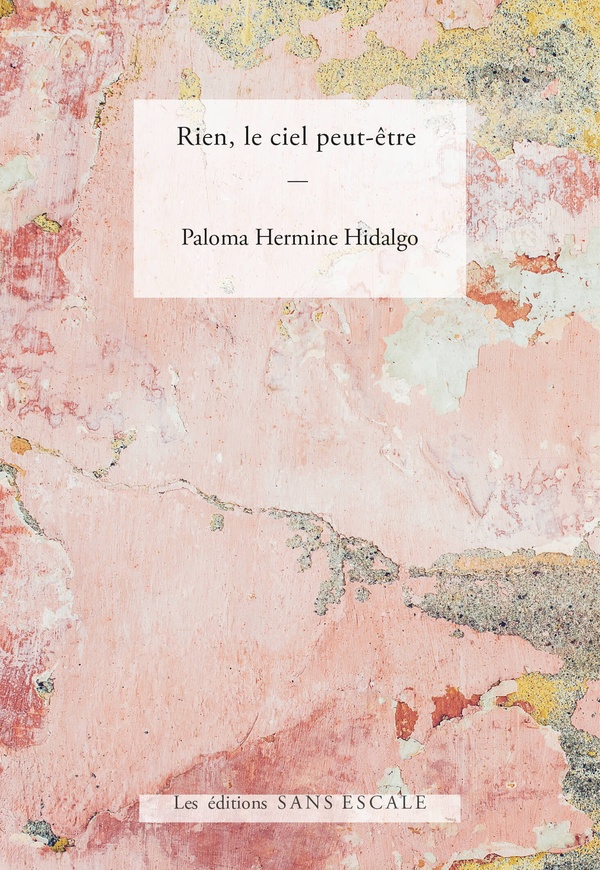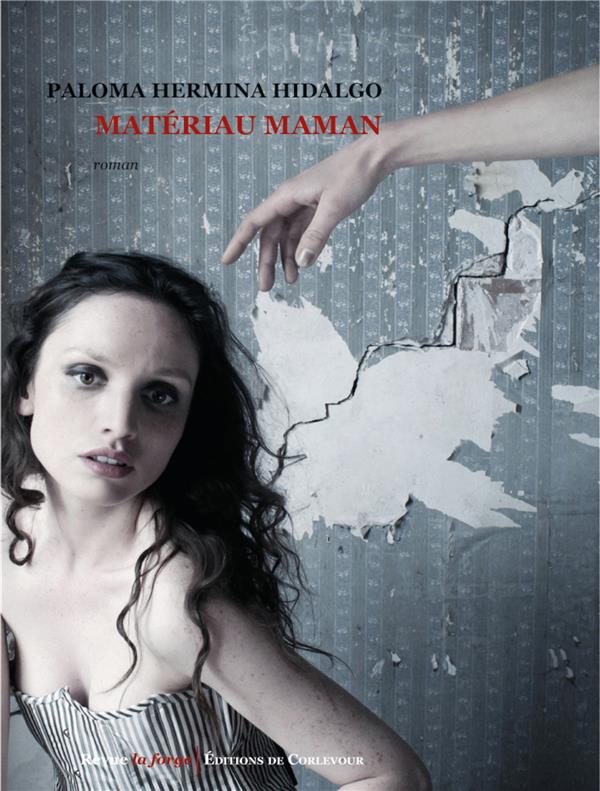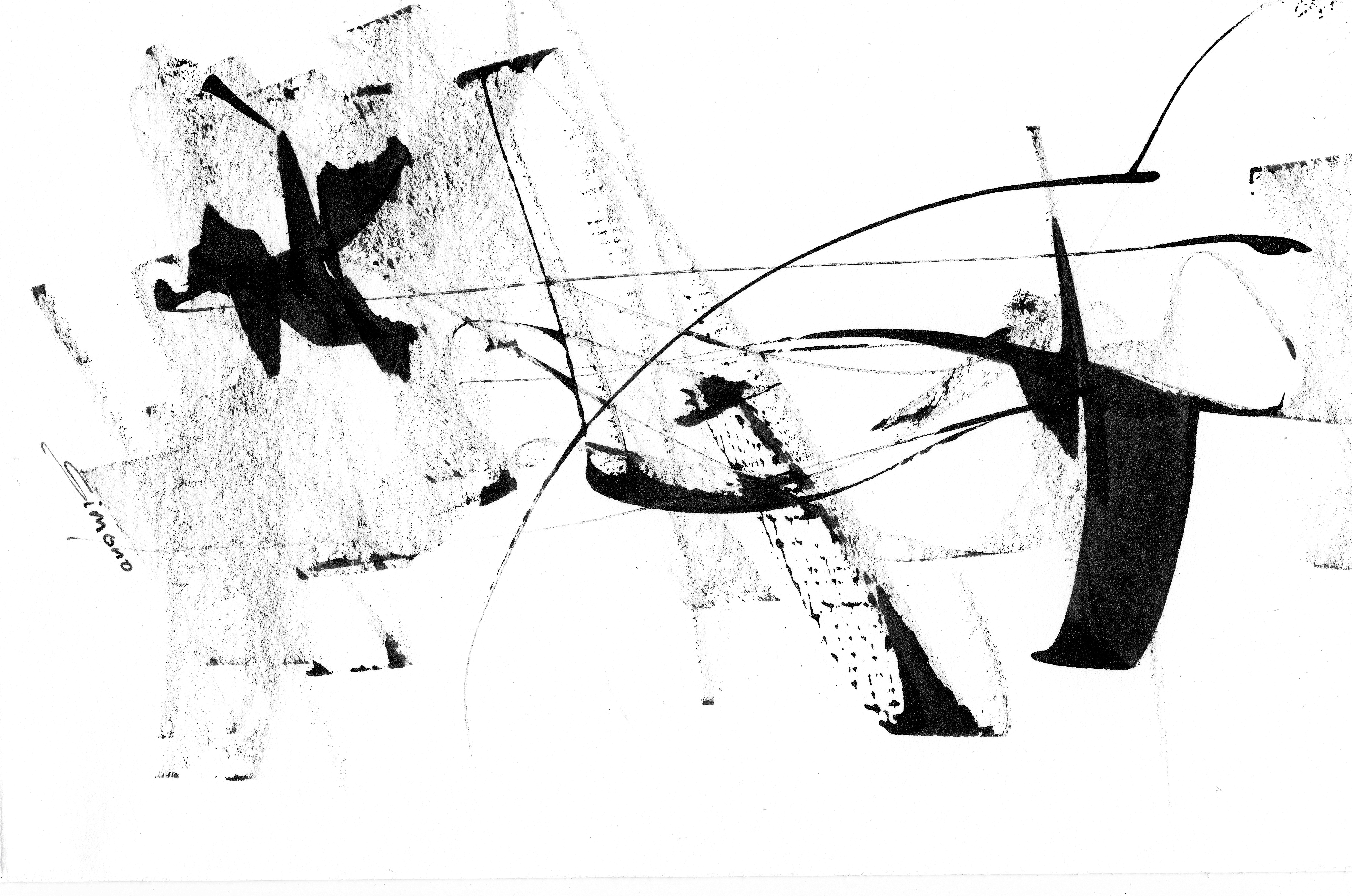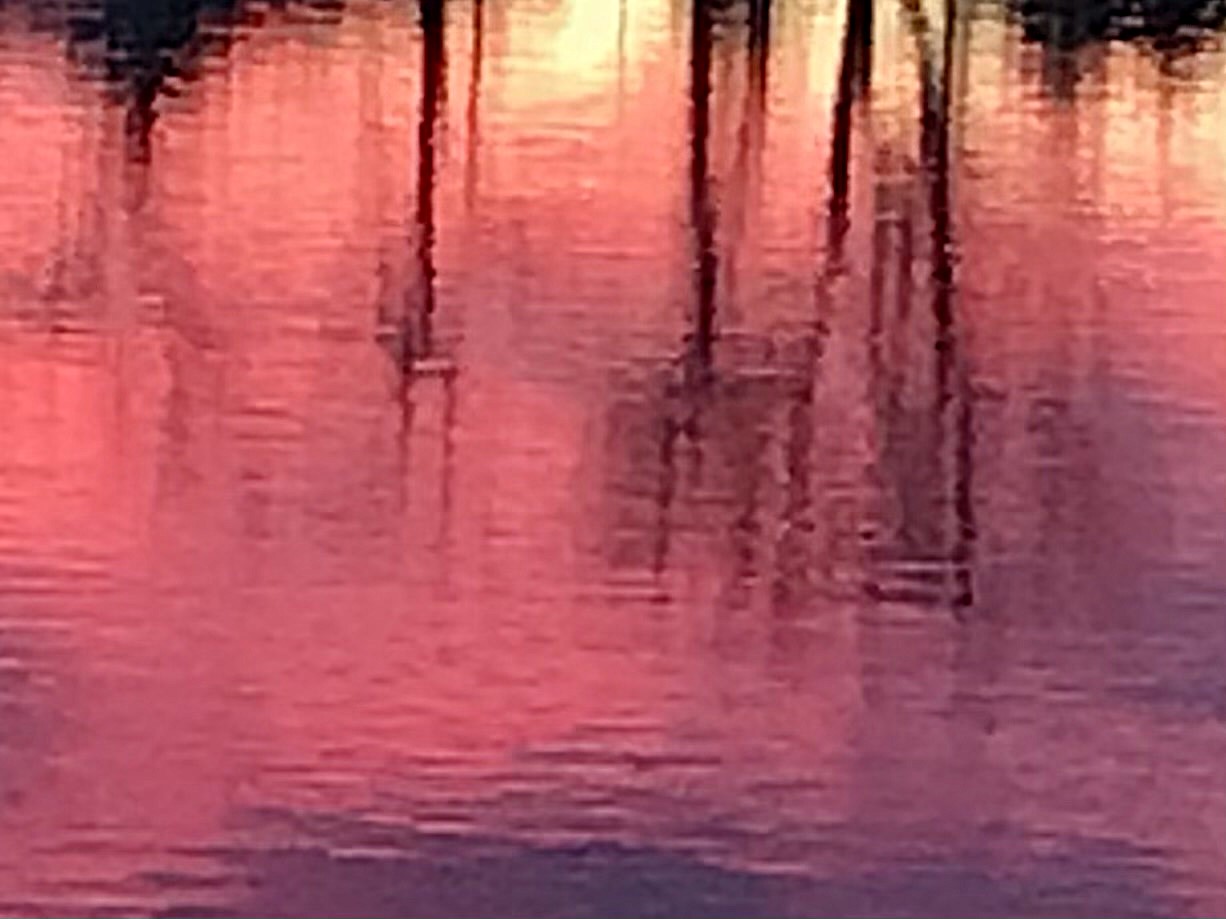Eve Lerner, Un tant soit peu de lumière
Eve Lerner récidive. Convaincue que « Le chaos reste confiant », titre d’un précédent livre (Diabase 2020), elle nous dit tout le mal qu’elle pense de ce monde qui part en vrilles. Son verdict est implacable avec, cette fois, une petite couche de noirceur supplémentaire. Mais tout n’est pas perdu : il y a toujours la vie qui palpite, il y a la poésie, il y a l’amour…
« C’est le temps de l’obscur », écrit la poétesse lorientaise. Il faut dire que, depuis 2020, la pandémie et la guerre à l’est de l’Europe sont passées par là, sans parler du réchauffement climatique dont on connaît les effets les plus délétères. Eve Lerner commence par lancer une charge contre « les hommes de pouvoir » et « les décideurs » qu’elle qualifie de « briseurs de rêves, fossoyeurs de la pensée ». Elle n’attend plus grand-chose d’eux. « Tu voudrais écrouer ceux qui déroulent sans fin la fausse parole et les fausses images ». Cette « fausse parole », elle l’avait déjà dénoncée dans son précédent livre, comme l’avait fait en son temps le poète Armand Robin (La fausse parole, 1953) Poussant l’acte d’accusation, elle va aussi jusqu’à dire : « On cherche à nous faire peur ».
Que faire dans ce maelstrom ? « Il faut tenir », nous dit Eve Lerner. « Aller jusqu’au bout du chaos triomphant, l’épuiser, le retourner comme une crêpe, l’embobiner, le réduire à moins que rien, et l’envoyer aux travaux forcés ». Mais comment s’atteler à un si gigantesque chantier ? La poétesse, qui s’exprime ici sous forme de fragments, ne nous conduit pas sur les chemins de la rébellion, même si son souhait est bien que l’on puisse arriver un jour à « déboulonner les statues des oppresseurs, cisailler les grillages de chasseurs, ceux des camps et ceux des burkas intégrales ». Mais son livre n’est pas un manifeste politique. Plutôt un manifeste poétique quand elle écrit : « Tout acte infime peut changer la donne qu’on nous impose. Sauver un orque, une femme, un jardin, une source, un oiseau, un marais peut ouvrir une veine de vie ». Plus loin, elle ajoute : « Soigner les blessés, les arbres, les oiseaux, les chevaux, soigner la terre, la mer, soigner son style ».
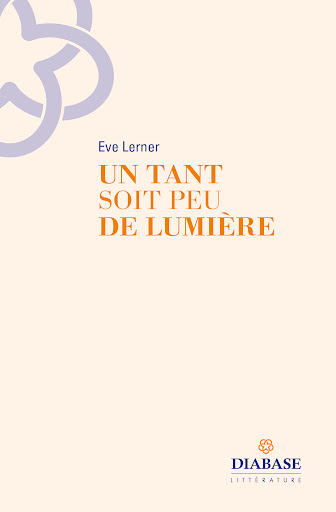
Eve Lerner, Un tant soit peu de lumière, Diabase, 100 pages, 14 euros.
Il y a, dans ces propos, quelque chose qui relève de l’acte de foi. Ou du moins d’une espérance. Elle la place dans notre capacité d’émerveillement (« que ton cœur s’envole, que ton sang vire à la sève… ») Mais Eve Lerner apporte d’emblée un bémol. Pour pouvoir s’émerveiller (injonction qu’elle juge un peu trop dans l’air du temps), « il faudrait assagir la part sauvage de l’homme et retrouver la part sauvage du monde ». Alors il reste à célébrer inlassablement l’amour et le désir, « un refuge, un havre de bien-être » dans « la noirceur du monde ». Ou, comme elle le dit aussi : « Pouvoir encore dire à un être, à une idée : je tiens à toi. Réussir tout cela, qui nous tient à cœur, tient du miracle. Il ne tient qu’à nous de le faire. Il faut tenir la distance ».
Pour elle, « tenir la distance » devient un redoutable défi. Elle fait, sans fard, le constat d’une forme d’éloignement progressif du monde. « Je ne sais plus recevoir et ne sais plus si j’ai encore quelque chose à partager, à transmettre ». Qu’elle se rassure. Ses lecteurs ont encore la conviction qu’elle n’a pas dit son dernier mot. Ses propos sont dans le droit fil de ce que disait le poète italien Giuseppe Ungaretti : « La poésie consiste à convertir la mémoire en songes et à apporter d’heureuses clartés sur les chemins de l’obscur ». Ou de ce qu’affirmait le Marocain Abdellatif Laâbi : « De l’homme à son humanité/la poésie est le chemin le plus court/le plus sûr ».