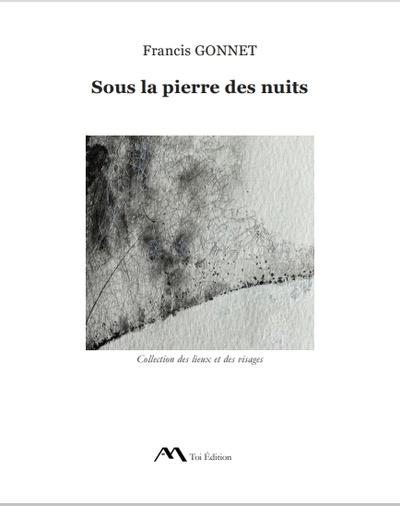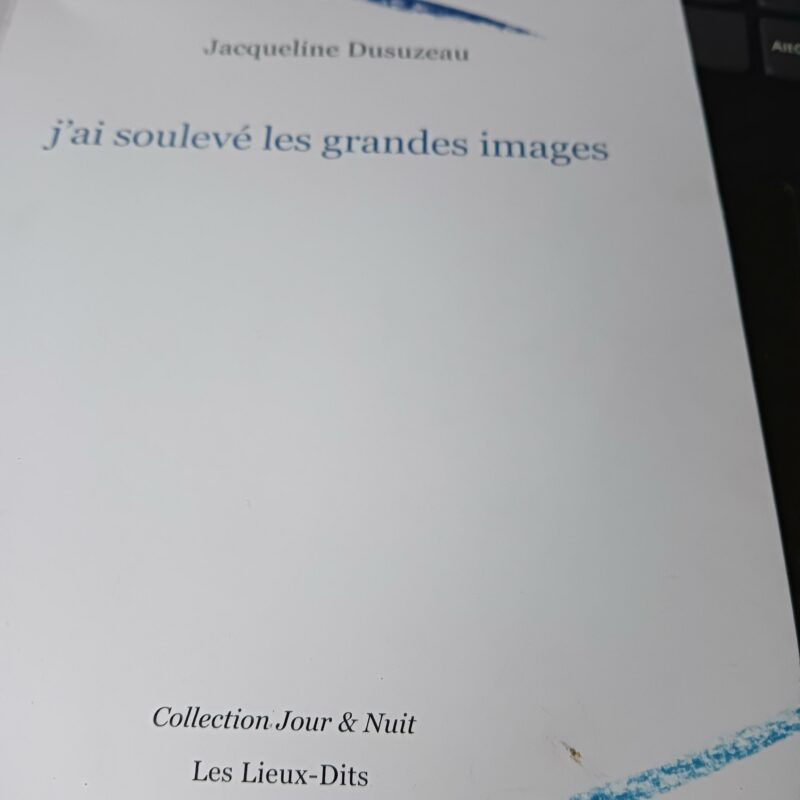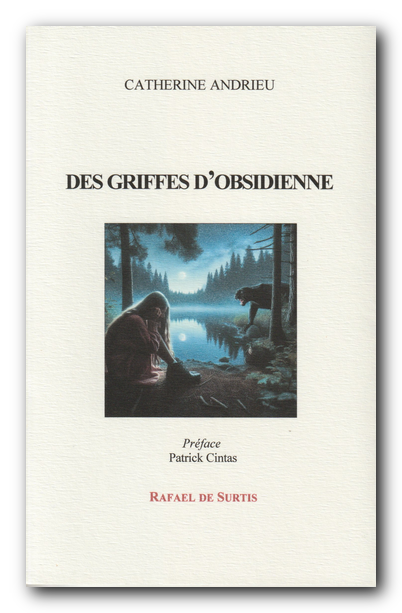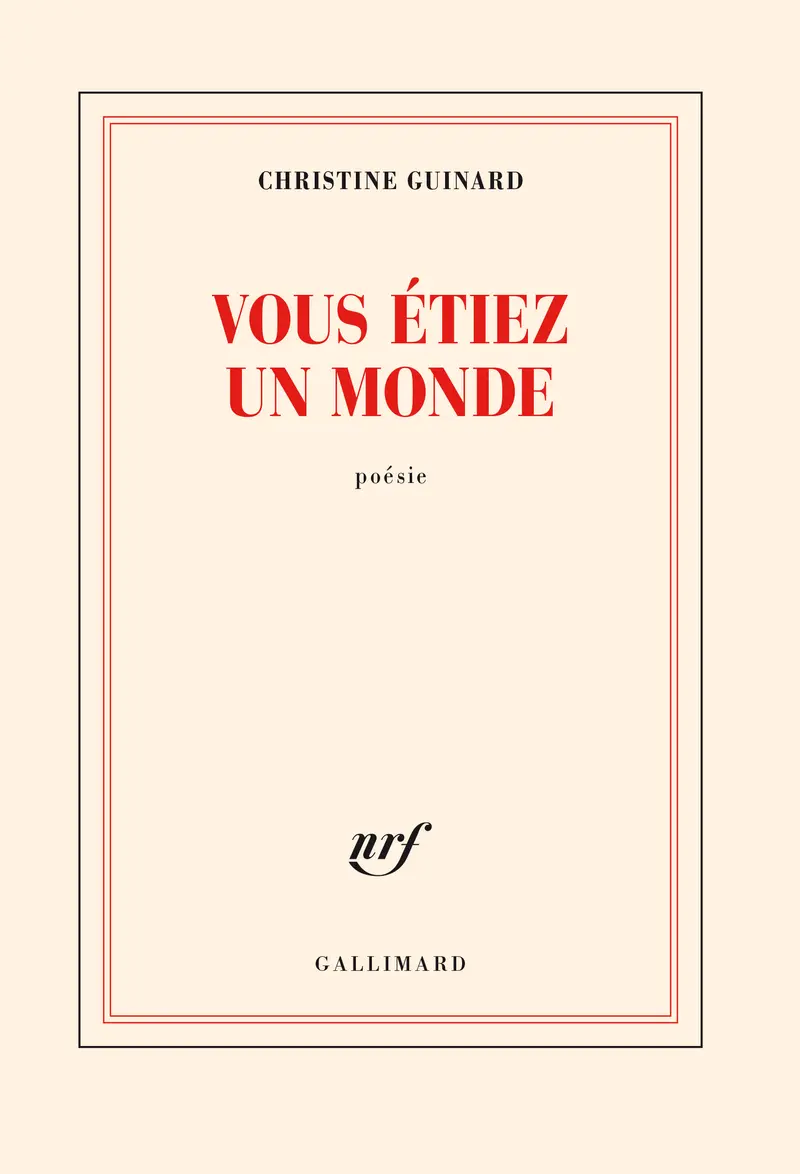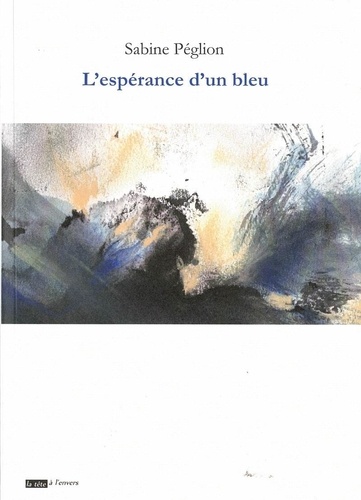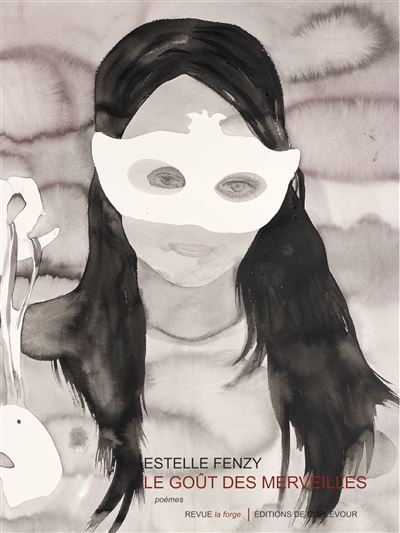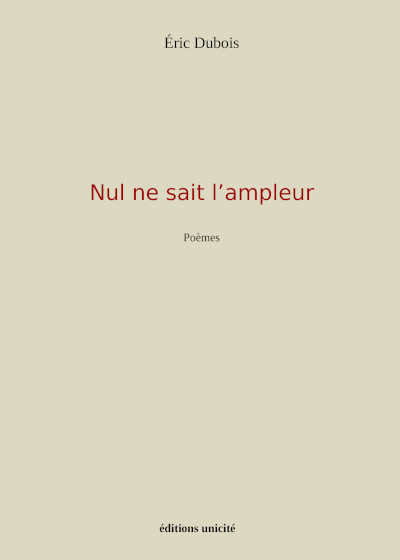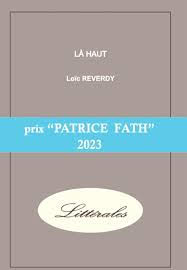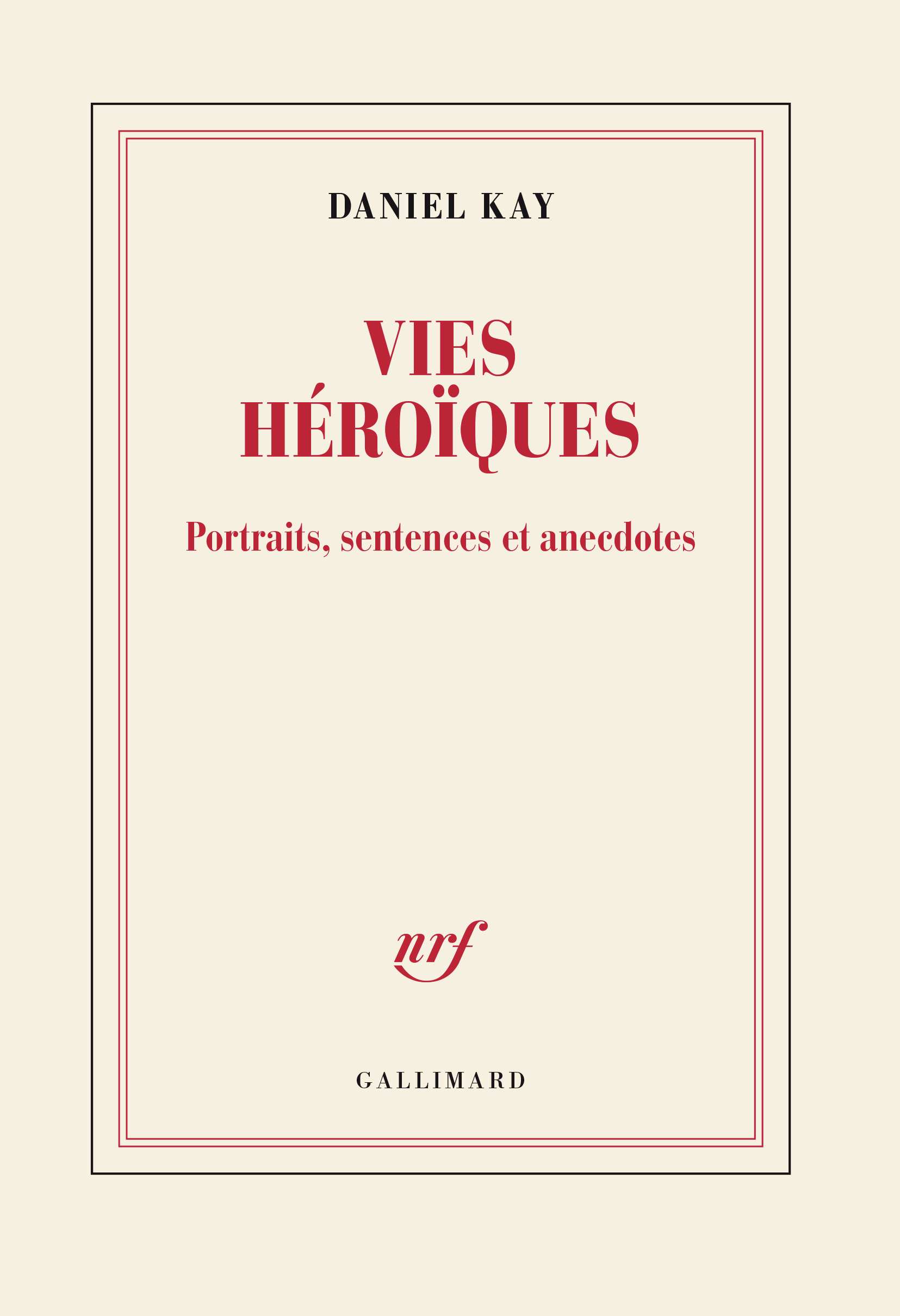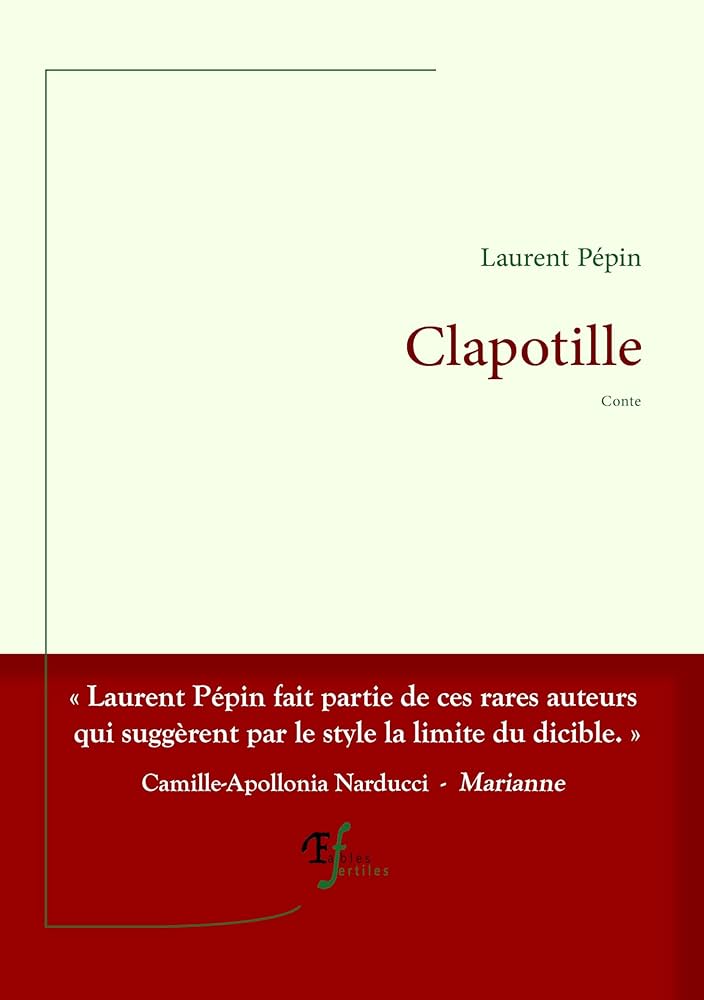Reproduire comme on vient de le faire la poésie de Demangeot (/ pour changer de ligne ; // pour sauter une ligne) ne lui rend pas suffisamment justice. La disposition des vers sur la page est chez lui capitale, plus encore que chez de nombreux pratiquants du vers libre. Parfois, comme dans le poème « Litanies de Caïn » qui ouvre le recueil, divisé en versets de neuf ou dix vers, l’auteur ne se contente pas de sauter une ligne, il coupe carrément la page en deux, avec un premier verset en haut et le suivant en bas de la page. Ainsi, après le meurtre d’Abel, le premier verset qui se termine par On m’a / blanchi. On m’a / dit que j’étais un homme, un / de ces hommes dont le monde / a besoin. Pour s’interrompt brutalement sur la préposition « pour » et la suite n’arrive qu’après un énorme enjambement : fuir, on m’a donné / de faux papiers. Calligraphiés / d’une main sûre. Enluminés / avec élégance. Avec ça en poche je / vais, comme je suis, comme / je me tiens : corps / écrit : j’ignore / au nord / de quoi. On remarque quatre octosyllabes dans ces versets, comme pour donner une cadence, d’ailleurs vite interrompue, outre que de ces vers, un seul (de ces hommes dont le monde) se lit d’une traite2. Simple coïncidence ? Sans doute, car la présentation de deux versets par page séparés au maximum est bien ce qui rend remarquable le poème sur Caïn. Elle oblige le lecteur à reprendre son souffle entre deux versets successifs, le temps d’une pause pour assimiler ce qu’il vient de lire.
Le livre est divisé en deux parties, Pornographie et Ravachol3. La première – sous-titrée Ébauche d’un livre du mal – compte dix-sept poèmes. Si tous dégagent une atmosphère crépusculaire, de fin du monde, d’arbitraire et de violence contre laquelle le poète tente (en vain) de se révolter, l’humour vient souvent au secours pour rendre le tableau plus supportable. On a pu s’en rendre compte par les extraits ci-dessus et la manière qu’à l’auteur de couper les phrases – voire les mots, ici ou là4 – y contribue fortement. Il lui arrive aussi de souligner un mot en le mettant en italiques.
Quelques textes apparaissent plus légers que d’autres en dépit de leur sujet. Ainsi « Concentrationnaire » où le poète dénonce plutôt gentiment les vacanciers enrégimentés. On repère même quelques préciosités : l’intégrisme critique / et l’éclatante condescendance / et le barreau blanc bleu violent de la / voûte hypercielleuse de l’ / été.
Pour Demangeot, le monde est foncièrement obscène, ce qu’il définit en tête du livre comme ce qui offense ostensiblement le sens moral. Ex. : l’obscénité du capitalisme. Encore une fois, son discours n’est pas un discours, mais un cri. Il ne se demande nulle part quel système serait préférable au capitalisme ; il accuse et, reconnaissons-le, il n’est pas nécessaire de chercher bien longtemps pour découvrir les tares de notre système. Rapports de classes, rapports de genres aussi bien.
l‘oiseau, l’ / oiseau de la / Nuit mon a / mant m’a / menti maman, on / m’a fait mal on / m’a mal / mariée Ah / mon amie, tu / es là, toujours nue toi, près de / moi, moi vêtue de ce / sale vêtement bl / ancommunmort, (« Une triste histoire »).
Demangeot ne fait pas mouche à tous les coups. On peut penser qu’il stigmatise ici des mœurs rétrogrades, des mœurs que la police qu’il honnit pourtant s’efforce de combattre et qu’il devrait bien choisir entre une police appliquant imparfaitement notre conception des droits de l’homme et le relativisme du « toutes les cultures se valent ». Là n’est pas le propos. Le poète a un droit (un devoir ?) général d’insurrection (même si celle-ci ne saurait mener bien loin, mais c’est un autre sujet soulevé ici de surcroît par un pessimiste par nature).
Quand Demangeot dénonce l’obscénité et la violence, il y va carrément : Chérie – oh / tu m’écoutes quand je parle j’ai dit / regarde Salope / ou je te dévisse la tête à coups de poing (« Sale temps ») ; la / Mort m’a mise à genoux m’a / forcée – for / cée à sucer / un Propriétaire, le / curé mon mari / bandait de me voir à genoux […] ce fut la grande Kermesse / de la Terreur, le grand défilé / des hommes importants / dans ma bouche & / dans mon cul (« Une triste histoire »).
On notera dans le dernier exemple l’intéressant usage des majuscules pour désigner l’ennemi : le Proprétaire (le capitalisme), la Kermesse (la religion – ou le marché?), la Terreur (le pouvoir). Demangeot anticlérical ? Pas sûr. Dans la citation précédent, « curé » n’a pas droit à la majuscule. Par ailleurs, le poème « La soif » commence par un tercet : Vite bordel / il faut que j’avale / une éponge, où les deux derniers vers sont en italiques sur l’original, comme pour souligner la citation des Évangiles relatant le calvaire du Christ.
Il y a chez Demangeot une certaine « décontraction » (en paroles) à l’égard du sexe féminin qui risque de choquer les bien pensants. Il n’est pas sûr que ces derniers soient prêts à accepter une dénonciation de la misère et de l’injustice sociale exprimée comme dans le poème « Sale temps ».
regarde / tout de même ils / auraient pu envoyer un / pauvre, au ramassage de / ces monticules de cadavres laissés pourrissant / sur le trottoir, qu’en penses-tu / Chérie, touche / comme c’est mou, sens / comme ça pue, vois / comme c’est laid, comme / ça vous gâche un paysage parfait – allez, / ma petite pute – je veux de toi / que tu me dises combien / c’est innommable – alors nous / la nommerons ensemble & / sentirons le frisson vrai / refroidir notre double dos –
Un couple en train de faire l’amour (le « double dos ») qui s’indigne parce que la misère – qui n’éveille en lui qu’un frisson (fût-il « vrai ») – s’expose au grand jour, un homme qui traite sa « Chérie » de « petite pute » : se moquer de la misère, rabaisser sa femme, tout cela est fort incorrect et dévoile par ailleurs un aspect de Demangeot que l’on ne voit pas nécessairement chez lui. Sincère, oui, scandalisé, oui par l’injustice, les violences policières (en particulier dans ce recueil), mais lorsqu’il dénonce ainsi l’indifférence, dans quelle mesure s’en exclue-t-il ? Suffit-il de crier ? Le fait qu’il emploie ici la première personne du pluriel pourrait inciter à penser qu’il ne veut pas être dupe de lui-même. Est ainsi posée l’éternelle question de la vérité du poète, y compris lorsque sa sincérité n’est pas en doute.
Et poète est celui
qui s’obstine à fouiller une terre
battue de bottes pour le sens
battu du mot d’homme qui ne s’y trouve pas
Cette définition, tirée du poème « Fenêtre sur le bleu » n’est somme toute pas si différente de celle de Paul Celan dans Le Méridien5. La poésie, Mesdames et Messieurs : cette parole d’infini, parole de la mort vaine et du seul Rien6.
Notes
(1) Jérôme Thélot, « Politique du poétique : le travail de Cédric Demangeot », L’Esprit créateur, vol. 55, n° 1, 2015, p. 69-77.
(2) Compte tenu du changement de ligne entre « dont le monde » et « a besoin », il semblerait judicieux de ne pas faire la liaison et de compter la deuxième syllabe de « monde » comme un pied, ce qui ferait bien de ce vers un octosyllabe.
(3) Cette deuxième partie, plus courte, sous-titrée « petit roman en vers suivi d’un poème », consacrée à une évocation de l’anarchiste Ravachol (1859-1892) commence par la retranscription de son journal et se poursuit par diverses « gloses » (à ce sujet, la postface de Victor Martinez, p. 383-384).
(4) Exemple : Ceci / est ton frère. Le morceau / reçoit le don du nom / bizarre d’A / bel.
(5) Der Meridian, discours prononcé à l’occasion de la remise du prix Georg Büchner (1960).
(6) Dans l’original : Die Dichtung, meine Damen und Herren – : diese Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit und Unsonst ! Ici dans la traduction de Maurice Blanchot (in Philippe Lacoue-Labarthe, La Poésie comme expérience, Paris, Christian Bourgois, 1986, p. 146).