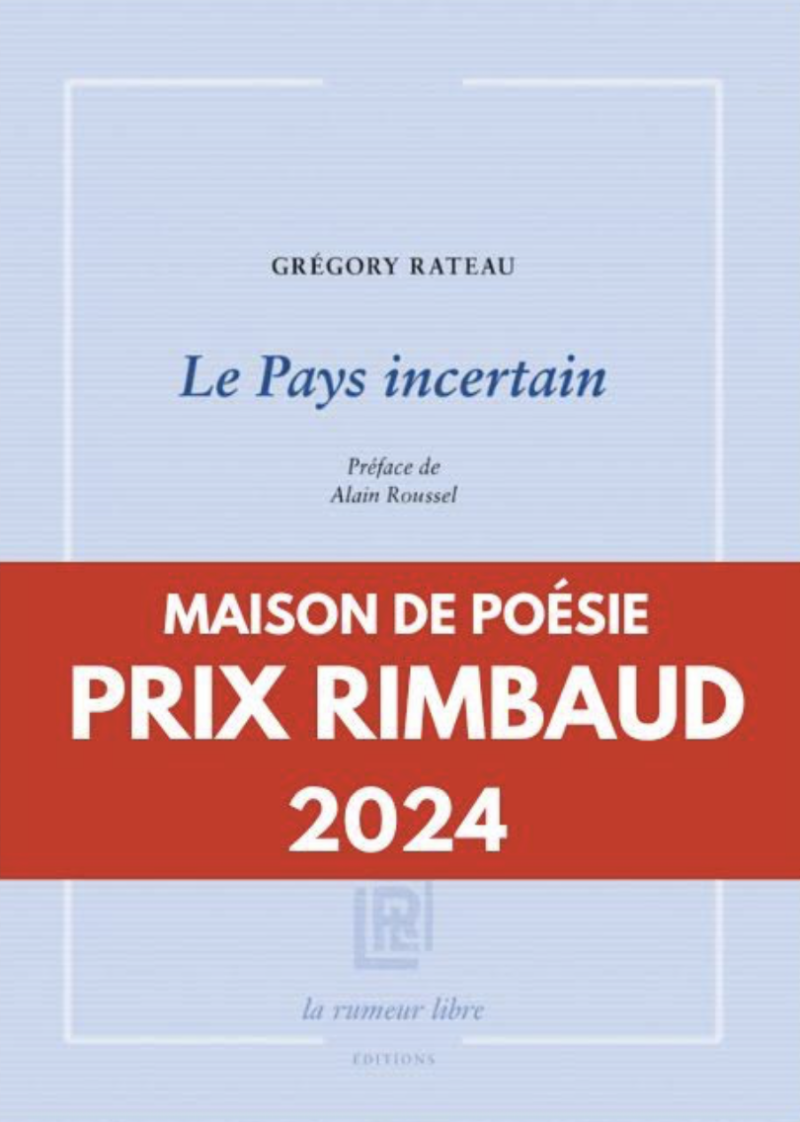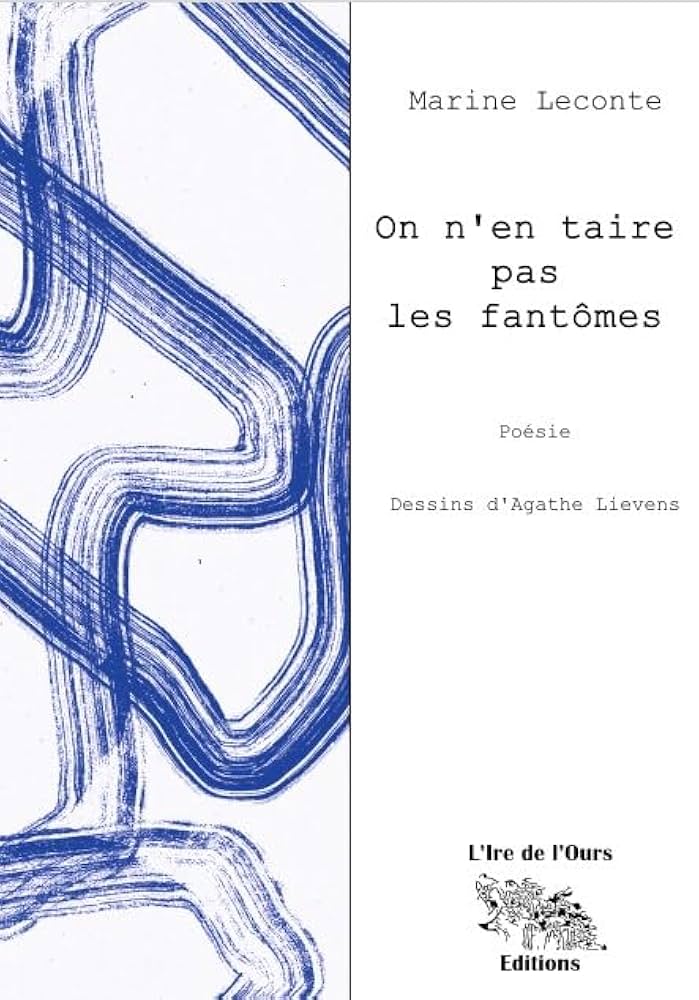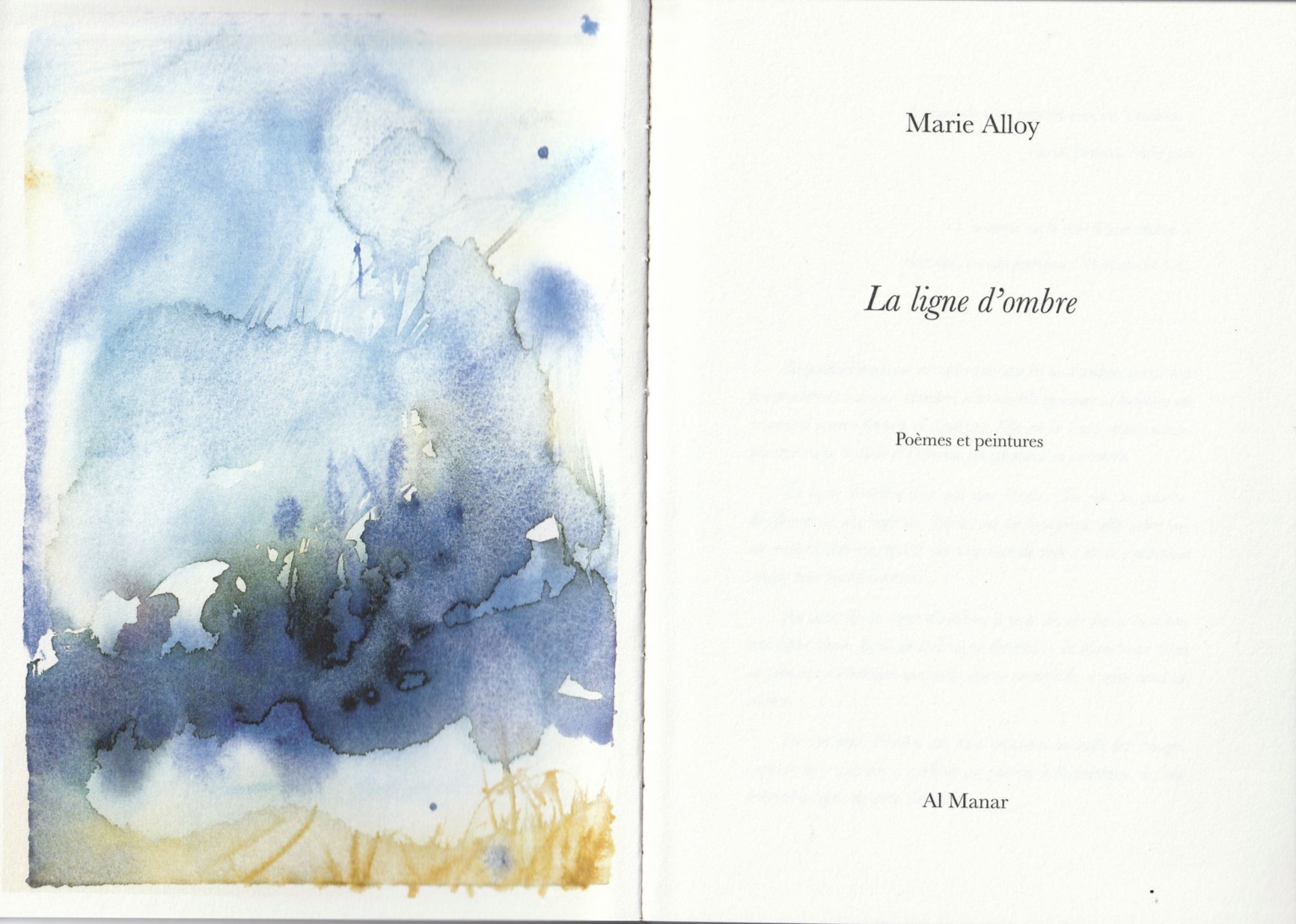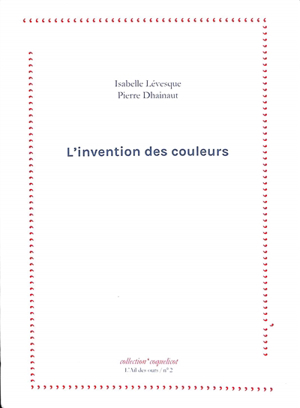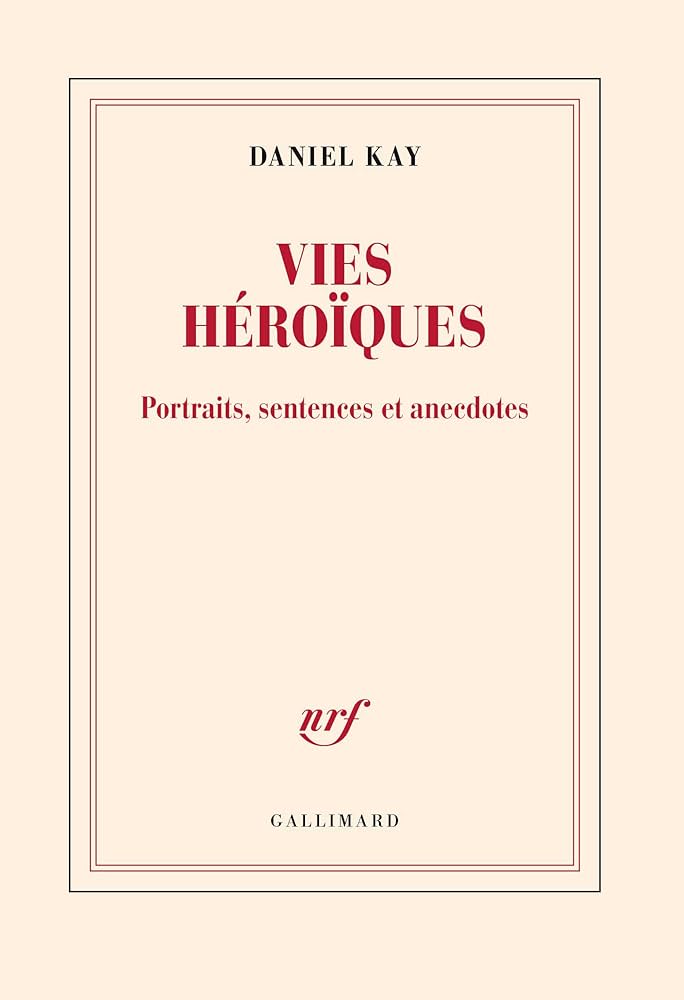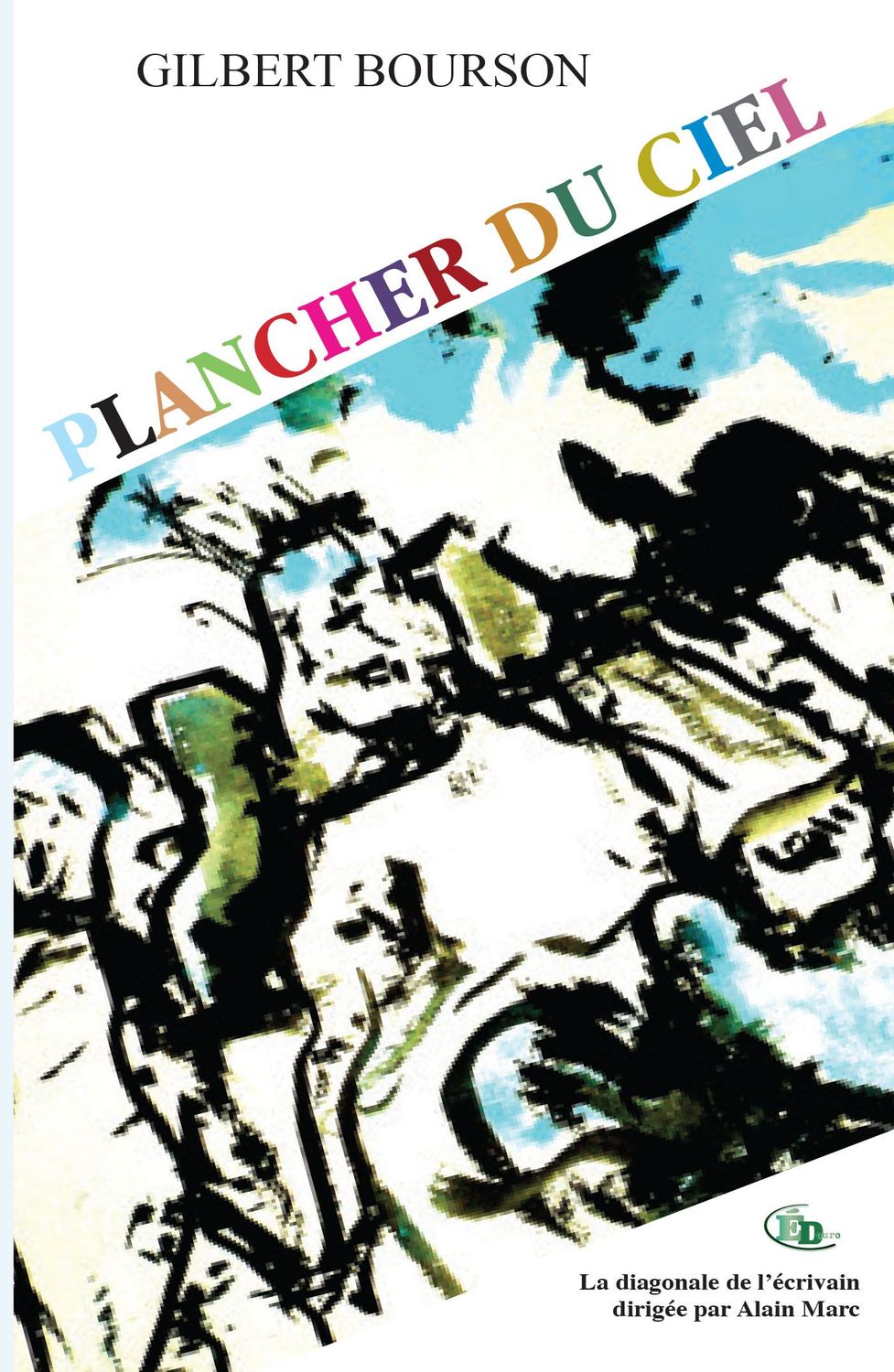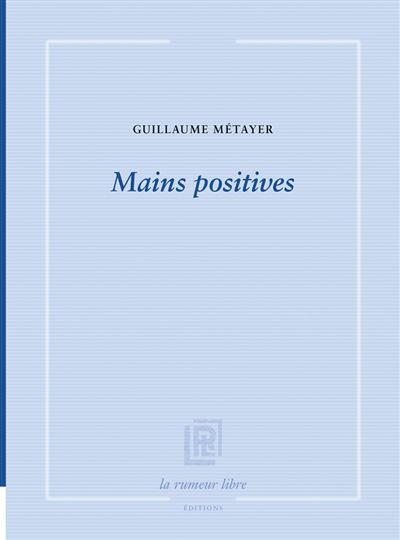Un danger est de « faire poète » au sens de ne pas l’être en le voulant trop ; simplement, en tenant le rôle. On voit même l’idéal virer au suicide. Imaginez :« Une vie soumise à l’anagramme ». La proposition se trouve dans un poème intitulé « Roulette ». Russe, bien sûr.
Mains positives est une suite de poèmes en prose. Dans ses deux précédents recueils, Guillaume Métayer écrivait en vers. « Faire n’est pas refaire ». Et le troisième est sans versification. Sauf que… l’on y retrouve des alexandrins clandestins, avec effet immédiat de souvenir. Et échange de bons procédés : dans le livre précédent, Libre jeu, la versification dépaysait le prosaïque. Imaginez un poème en vers intitulé « CIC », qui reprend « Ce sont souvent les actions / qui apportent le plus de satisfactions », auxquelles il oppose sa propre action. Dans ce recueil-ci, le vers, la cadence, le sens de la chute pour clôturer un texte ont le même effet de trouble. La prose et le vers ont trouvé d’autres placements.
Il y avait dans le précédent recueil des lieux de prédilection : rue, café, parc, toits… On les retrouve ici mais le temps a changé. Le temps qu’il fait et le temps qui est. Le premier est à dominante grise ou brumeuse. D’ailleurs, « il y a rarement eu plus brume que moi », dit l’auteur. Le second, explicite dans « Trotteuse », n’est pas celui qu’on croit. Certes, il est ce qui grise, au sens de ce qui vieillit :
Allongé aussi longtemps face au silence du plafond, le corps se jette dans la seule issue
possible, la vieillesse. L’âme le suit comme son ombre et pour un peu on la verrait passer
comme un cambrioleur entre les deux fenêtres si au siècle dernier la radiographie avait
mieux progressé.
Mais le temps est aussi ce que dit le poème « Minute » :
Une minute peut durer soixante ans sous l’espèce d’une louche dans le bouillon. De grandes
histoires d’amour tiennent en une minute.
La suite joue l’œil sur la soupe. Après un passage lyrique, rupture de ton :
Mais quand la minute a été bien étirée, c’est toujours la même histoire. L’élastique claque, la
longue minute vous revient au nez.
La dérision, la possible image clownesque rééquilibre et dégrise ; à plus forte raison, une possible auto-dérision le fait-elle. Une certaine légèreté est une réponse, parfois de sur-vie, parfois de vie ; une réponse authentique dans un contexte général hostile où il ne s’agit surtout pas de participer aux entreprises d’où « on… sort plus gris ».
Le gris du temps météo et politique rencontre le gris de la vie amoureuse. Et Guillaume Metayer ne s’interdit pas de parler à la première personne, de s’adresser à une femme - rencontrée, ou/ et s’éloignant - : « Ne pose jamais sur nous ce beau sourire gris ». Le « tu » est aussi présent, qui renvoie à un être aimé ou à soi-même dans un dialogue intérieur, comme dans « Chenil » où un moment de colère noire rencontre Juvénal et Anubis. La violence d’un moment passe par l’Antiquité et disparaît sur ces mots : « fin de la version ».
Il faut le dire, en pensant sans peser, le gris est celui du monde comme il va : « l’antivol au volant pourrait être à la gorge ». Ou encore, « on peut tuer quelqu’un en lui enfonçant un soufflet dans le coeur ». Ou : « il nous faudra bientôt importer autant d’armes que de douceurs. Introduire le droit de tirer à vue, pour protéger le sucre et augmenter la peur ». Mais, attention au survol, à un « bien-entendu » de connivence. « Il ne s’agit pas de faire de l’air du temps une allusion ».
Une veine satirique traverse le livre, avec des formules saisissantes : « Certains assoient sur vos yeux leurs grosses fesses grises. Ils vous couvent, disent-ils… » ou encore « rien de tel pour bloquer une entrée qu’être le château gonflable ». Cours et courtisans sont toujours là. Et le poème est accessoire. « Mes poèmes ressemblent à des cravates » et la cravate est « tolérée uniquement chez quelques dignitaires du parti ».
Sur ce fond gris, il y a des retournements héroïques. Une lucidité propre au poème dégrise des crédos faussaires. Ainsi, sur un ton satirique - l’époque l’a bien cherché - :
Les scientifiques sont formels : il est possible de tout revoir passer, sans la moindre
nostalgie, dans un tout autre confort linéaire que la mort…
Seules resteront douloureuses les arrivées et leurs chignons .
Les arrivées et les départs ont un rôle majeur. Cela donne le très beau poème « trains » et ce cadre, « la porte des trains ». « Les arrivées et leur chignons », c’est un enchaînement poétique, comme « chignon » est une chaîne de montagnes. Un jardin, avec « le lent mouvement de taïchi », recueille les paroles de celle qui vient de s’éloigner et inspire cette conclusion :
Je ne saurai jamais pourquoi choisir ces allées pour figurer un départ.
Répond au gris la joie possible. Il y a déjà de l’amusement à signaler quelques marottes et inventions de l’époque, à écrire un poème sur le « Dimsum », à comprendre la playlist, où « le retour redevient départ » ; à s’arrêter au jeûne, « grossesse messianique d’autrefois d’où tout à chacun peut renaître ». C’est un livre qui fait sourire et rire, ce qui ne peut être sans la peine : « au moment du chagrin l’oreille s’ouvre ». « Et le deuil (est) notre dictionnaire favori ». Un décalage très singulier, une sorte d’apparent mouvement de côté avant l’impact de l’émotion permet de regarder en face ce qui la provoque.
Il y a une joie possible à voir les choses telles qu’elles sont. Comme dans ce très beau poème « Piscine » où l’on revient au sujet principal « Le temps qui passe dans les piscines n’est pas le même. »Et des rampes d’émotions : « la neige. Sa gangue fait date », la présence du passé, la force de « il y avait », l’enfance, et le rappel du Temps qui joue en poussant des pions. On croise ici des jeux, le bonneteau, les cartes, le bréchet, et même le petit os de poulet en forme de Y, avec lequel on fait un vœu…Traversent aussi des éléments de conte.
On ne finira pas sans évoquer la rencontre poème-récit, une forme libre, une réussite, qui rebat les cartes et accueille la fantaisie. Deux exemples : le poème Her, avec sa trottinette connectée :
Je l’appelai Her et elle me nommait early bird.
Et « Wishbone », où se raconte une guerre projetée sur la plage, pendant l’enfance. Une sorte de Guerre des boutons, avec des ennemis…
Mais au moment de ravager leur oasis de posidonies et de barbelés, une voix nous arrêta,
comme d’un décalogue.
C’est la voix d’un pêcheur admiré, un malheureux… Convergent ici une expérience forte, une scène, un événement de son et de sens (impossibles à séparer) où condensent le mystère « les oasis de posidonies et de barbelés ».
Pour le poème aussi « le son est l’un des treuils des choses mais il n’est pas le seul ». Et la distance qu’il parcourt et révèle, il la voit à même les choses sensées rapprocher ; ainsi, le portable.
En m’étirant vers lui chaque matin j’approche la mesure du chagrin.
Le poème est la mesure vraie.
On terminera cette présentation trop sommaire, qui trace, incertain, un contour du livre, quand le poème, lui, est main positive, plein, plénitude… dans l’émotion d’un poème très singulier, intitulé « Aujourd’hui (virgule) ». Il finit sur un deuil. Ce texte est une suite d’images, réelles et rêvées, sans séparation possible. Une suite de phrases comme des pièces d’or. Guillaume Métayer arrive à ce comble : une prouesse de formalisme - au lieu d’inscrire la ponctuation, il l’écrit en toutes lettres (point), (virgule) et cela fait un rythme - et l’éclat du simple. Dans cette étrange Dictée ( d’école, de poésie), il ne prononce pas et cependant dit « point final » comme jamais on ne le fit entendre.