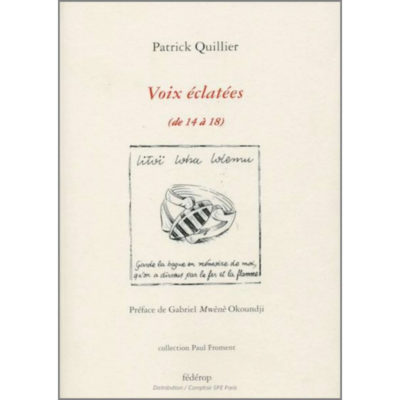Patrick Quillier, Voix éclatées, extraits
en ce temps-là la guerre était en terre
l’europe dilacérée labourait
ses plaines et y plantait des boisseaux d’hommes
malheureux tous ces morts tels des épis
cueillis verts malheureux tous ces morts
aux moissons innommables de l’histoire
malheureux tous ces morts pour six arpents
de terre malheureux tous ces morts pour
satisfaire morgue et cupidité
des chefs malheureux tous ces morts en guerre
déraisonnable injuste malheureux
tous ces morts car cette chair de la terre
où leur face est tombée n’est la cité
que d’une divinité fantomale
malheureux tous ces morts aux funérailles
sacrilèges malheureux tous ces morts
que mensonge et folie ont abattus
dans la chair d’une terre aimée perdue
dans les replis d’un sol dernier et sale
malheureux tous ces morts à ces caveaux
indignes cette glèbe saturée
de sang supplicié de chairs éclatées
d’os mitraillés émiettés malheureux
tous ces morts dans cette chair de la terre
suppliciée mitraillée dilacérée
malheureux tous ces morts embrassés par
l’horreur d’un hosanna de fer de feu
de gaz malheureux tous ces morts étreints
par les démons qu’ont déchaînés des hommes
qui étaient chefs en chefs qui étaient fous
furieux en chefs oui fous furieux en chefs
dans l’absurde abandon aux symbolismes
d'état qui pullulent et manipulent
malheureux tous ces morts gibier sans fin
aux chasses sans pitié de la bêtise
mariée à l’hypocrite couardise
à la plus obscène des convoitises
au cynisme se camouflant en « crise »
à l’arrogant dégoûtant égo(t)ïsme
*
LES MISES AU POINT DE VICTORIN BÈS
Victorin Bès, le 9 novembre mille
neuf cent quinze : « Soyez bien fiers de nous
vous tous de l’arrière qui lisez ce
communiqué :
“Le moral des Poilus
est admirable, ils meurent le sourire
aux lèvres et ne crient jamais maman
en mourant les entrailles broyées, mais
ils hurlent Vive la France !”
Ah, crapules
de journalistes qui entretenez
le moral de l’arrière ainsi, venez
vivre une heure seulement au moment
où se radinent crapouillots, torpilles,
etc.
La Patrie qui nous fait
tuer, notre mère ? Allons donc ! Ma mère,
c’est ma maman qui chaque nuit pleure et
tremble sur mon sort. Ma patrie, c’est ce
que j’ai de plus cher au monde et qui m’aime,
c’est maman, c’est papa. Maman. Papa.»
*
Le 17 mars 1917,
à l’hôpital militaire du Grand
Palais, on procède à la tentative
d’une greffe osseuse sur deux soldats
mutilés. Lorsque la lueur oblique
du couchant traverse les carreaux de
leur porte-fenêtre et vient caresser
sur leurs lits de douleur leur deux visages,
le plus âgé remonte sa chemise,
découvrant son nombril et sa poitrine,
peau frémissante et glabre, à la chaleur
douce d’un soleil déjà printanier.
Ses jambes sont bandées, et là opère,
il y met tout le poids de son espoir,
une silencieuse chimie de vie.
Le plus jeune s’est accoudé, non sans
peine, au rebord d’un lit articulé,
d’où il laisse pendre, pliée, sa jambe
droite, elle aussi bandée, du pied jusqu’au
dessus du genou. La tête posée
à la renverse sur un gros coussin,
il laisse la lumière scintiller
sur son profil perdu, l’air épuisé,
les traits sereins pourtant. Sa main pianote
une valse-musette sur sa cuisse
droite (la gauche n’est plus qu’un moignon),
comme pour anesthésier la douleur,
comme pour encourager les cellules
du greffon à se lancer dans la danse,
à s’entrelacer, s’épouser, s’étreindre,
se féconder. Dans sa tête pourtant
la musique est mélancolique et tourne
à l’obsession dans un mode aigre-doux.
L’odeur de pharmacie les enveloppe
tous deux, qui se sentent flotter très loin,
très haut, très allégés, au creux de limbes
qui les ramènent tendres à l’enfance.
Faible chaleur du soir, fine lumière
en aura transparente sur leurs fronts,
effluves lents et lisses des produits
qui font dans l’air flux et reflux de souffles
s’immisçant dans le silence, l’esprit
des deux greffés réinvestit leurs corps
avec délicatesse, avec prudence,
comme si une paix pouvait venir
en armistice singulier avant
la paix qui soulagerait les armées,
la vraie paix générale, universelle,
la paix qu’ils n’ont jamais cessé d’aimer.
Qu’adviendra-t-il de ces deux-là, cobayes
consentants et reconnaissants de la
faculté acculée à progresser
devant tant de souffrance et tant d’horreur ?
Nous laisserons ici l’issue ouverte.
Nous resterons devant cette photo
que la faculté des deux à fait prendre
dans le soleil du soir, pour ses archives.
Nous resterons devant cette photo,
paralysés par la fraternité
qui nous unit à ces deux mutilés,
fragiles survivants d’une curée
dont nous ne savons toujours pas jauger
l’impact irrémédiable sur le monde.
Tôt ou tard ils mourront et nous mourrons,
précédés par des millions d’agonies
brutales ou interminables, des
morts données par l’homme et par son génie
destructeur qui invente toujours plus
d’armes de destruction universelle.
Tôt ou tard ils mourront et nous mourrons,
c’est ce que dit comme toute photo
cette photo d’archive, et cependant
plus que d’autres photos ce cliché-là
semble suspendre un bref moment le flux
irrépressible qui nous bouleverse
et nous entraîne à la mort tard ou tôt.
Nous sommes tous greffés sur la photo.
Nous frémissons du friselis de la
lumière chaude du couchant, sentons
les pas de la valse-musette des
cellules sur la piste des chimies
mystérieuses de la vie, flottons
en compagnie de ces deux-là, aux limbes
d’une enfance perdue qui nous revient.
Et telle la couronne d’un corymbe
une atmosphère d’émotions sans fin
unit morts et vivants en communion.
*
CHANSON DE CRAONNE
« Nous allons chanter la Chanson de Craonne,
village détruit au Chemin des Dames.
Nivelle a tout fait pour tout niveler.
Volant nos vies, pas ce chant inviolé.
Elle est d’abord la Chanson de Lorette,
aux derniers jours d’été, l’an I de guerre,
à la bataille d’Ablain-Saint-Nazaire,
complainte des combattants trop honnêtes.
Complainte des combattants passifs, tristes,
ensuite elle est la Chanson de Champagne,
servie sur ce plateau par des zutistes
à l’automne II des rases campagnes.
La voilà bientôt Chanson de Verdun,
dans l’hiver avide où au fort de Vaux
en 1916 on risque sa peau
depuis février au jour vingt-et-un.
En terre occupée par les Allemands,
elle est publiée par leur propagande
afin de saper le moral flanchant
des gars incités à sauver leur viande.
C’est dans l’été de l’an III de géhenne
que sous le nom de Chanson du soldat
elle est placée parmi les addenda
du canard La Gazette des Ardennes.
Dans le carnet du soldat François Court,
elle est notée d’une écriture nette,
« chanson créée le 10 avril 17
sur le plateau de Craonne, adieu l’amour. »
« Sur le plateau de Craonne », une syllabe
le village détruit, comme un carabe
sous un soulier, porte un nom qu’on prononce
crâne, fort crânement, coup de semonce !
Dans la chanson, il faut dire Cra-onne
si l’on veut respecter la mélodie.
Et c’est ainsi que la colère tonne,
dans son déguisement de parodie.
De parodie d’une valse à guinguette
jouée dans l’insouciance des dimanche,
lorsque, l’esprit libre et les coudées franches,
les amoureux partout sont en goguette.
Du 16 avril au 15 mai 17
le Général Nivelle a nivelé.
« Je les grignote », a dit Joffre, pas bête.
Vie volée, oui, mais chanson inviolée.
Dès le 2 mai, la grève des attaques
saisit les gars envoyés au plateau,
la Chanson de Cra-onneau bec, c’est beau !
comme autrefois la révolte des jacques.
Comme aujourd’hui celle des camarades
russes exaspérés d’être spoliés.
Et les troufions rendent leurs tabliers
au niveleur en chef qui pétarade.
Pétarade et réprime à tour de bras,
quand le 15 mai, il est limogé.
Pétain survient alors, très fier-à-bras
d’un côté, mais de l’autre très futé.
Il continue ainsi la répression :
30 000 mutins sont concernés,
plus de 3 400 condamnés,
500 à mort, 50 exécutions.
Mais il caresse dans le sens du poil
les Poilus révoltés, pour apaiser
leurs esprits choqués par le sépulcral
silence des potes exécutés.
On améliore leur popote, on donne
plus souvent des permissions plus longues.
Ils rentrent dans le rang. Mais la diphtongue
dans le cœur, de la Chanson de Cra-onne.
Chanson du soldat, Chanson de Lorette,
Chanson de Verdun, Chanson de l’Argonne,
de Vauquois, de Cra-onne, de Péronne,
Sebdul-Bahr, Charny, Perroy, L’Épinette…
Dans tous les lieux, hélas, multipliés,
où des humains se transforment en crânes
par milliers, une syllabe pour Craonne,
et c’est aussi une chanson de macabré.
Chant inviolé, chanson des vies volées
au nivellement de qui furibonde
dans tous les Chemins des Dames du monde,
Cra-onne, crânes nous t’avons chanté ! »