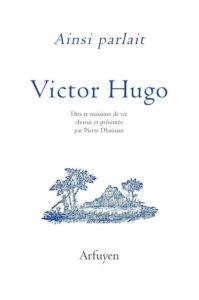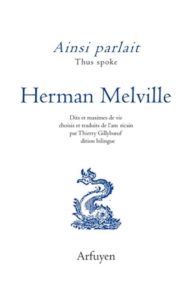Pierre Dhainaut, Pour voix et flûte
Pour voix et flûte s’impose dès le titre comme une partition musicale, un duo qui prend vie dans le souffle (celui du poète et celui de l’instrumentiste) et qui se compose de trois « mouvements » :
le premier, qui s’intitule D’abord et toujours nous fait entrer dans une double temporalité. Il y a ce qui vient en premier lieu (le son) et puis l’infini (les ondes sonores). Revenant ici sur cet état particulier vécu au moment d’une grave intervention chirurgicale à l’issue incertaine, Pierre Dhainaut, dans la continuité de ses précédents ouvrages, atteste de la suprématie du langage. Pour lui, le mot sera toujours premier, anticipant, voire créant l’image.
Dans le premier poème, il écrit :
[…] quel mot nous défendra de dire adieu
et servira de viatique ? De lui-même
il s’impose. Ainsi « message »entendu bien des fois sur un portable
sans que nous prenions garde »
Car le poète est celui qui délivre un message. Un message sur la mort mais, comme le dirait François Cheng, « parler de la mort c’est aussi parler de la vie »1. La mort perçue comme un passage, un seuil où l’on ne dit pas complètement adieu aux vivants et où l’on dit, aux morts « à demain », la mort comme un « transfert de souffles » de lèvre à lèvre, d’âme à âme, d’un être à l’autre, d’un poète à un autre, et l’ensemble de ces souffles constitue la pulsation du monde.
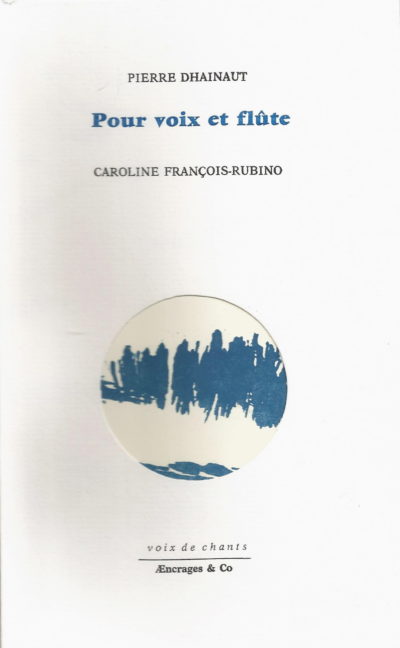
Pierre Dhainaut, Pour voix et flûte, Éditions Æncrages & Co, Collection Voix de chants 2020, illustrations de Caroline François-Rubino 40 pages, 18 euros.
Plus que jamais, la forme poétique de ce recueil épouse le message : les mots enjambent les vers, les vers enjambent les strophes, les poèmes eux-mêmes enjambent la pliure des pages et courent de l’une à l’autre. L’absence de pagination renforce la fluidité en n’imposant aucun repère. Tout n’est que mouvance, continuité, onde perpétuelle se propageant à l’infini, à l’image de l’âme « inlassablement fugitive ».
Si le poète est tenté d'imaginer les lieux où surviendra la rencontre avec la mort, il sait que tant qu'il perçoit des sons et des lueurs il appartient toujours à ce monde où l’ombre des disparus et les souvenirs d'enfance qui hantent les paupières closes se mélangent au présent.
Écrire, c’est esquisser un poème et le dédier à tous les enfants, ceux du présent et ceux qui l'ont été.
Ecrire, c’est comme jouer de la flûte : c’est fermer les yeux pour percevoir le devenir du premier souffle qui une fois émis, de même que l’écoute, ne peut revenir en arrière.
Et l'on comprend pourquoi le son est plus important que l'image : à la statique de celle-ci il oppose la fluidité du mouvement, les sons éphémères qui se fécondent les uns les autres, les soufflent qui traversent l'espace et le temps dans « l'inquiétude et la joie » c’est pourquoi il nous invite à aimer les mots.
« L’air ne refuse / personne : nous aimerions les mots / sons et silence (entre les pages) pour passer d'un son à l'autre, d'un poème à l'autre. »
Dans le deuxième « mouvement », intitulé Un mot pour un autre, on pourrait y voir un mot qui en remplace un autre, mais c’est bien évidemment le sens de celui qui en féconde un autre que l’on va privilégier.
Le poète n’hésite pas à nous placer au cœur de sa création en répétant des mots qui prennent une valeur incantatoire : ainsi du mot « corolle » qui en engendre d’autres, des mots intimement mêlés aux éléments de la nature, « haleine et brouillard confondus » ; il constate qu’il suffit de laisser parler les mots, « ne pas se plaindre de n'avoir rien à dire ».
L'amour des mots passe par le corps, relais de la parole. Il nous appartient de rester à l’écoute, d’apprendre au regard à se perdre comme l’ouïe, de voix en voix, de « lâcher prise » pour que puisse advenir la possibilité d'un poème. La parole est « la figure initiale d’où s’élancera un poème. » Une poésie qui ne peut se faire que dans la durée, comme la lente maturation d’un fruit, à l’aide de sons qui entrent en résonance et se propagent.
Que fait d’autre un poème, et que fera-t-il d’autre
sinon confier à l’oreille, au passage,
le secret de ce qui doit suivre ?
Le troisième « mouvement », Lecture de lumières, s’ouvre sur une clarté bleutée, à la fois une et multiple. Le bleu peut être perçu comme la symbolique de l'eau, de la femme, du rêve, de la sagesse, de la sérénité, l’écho d’un monde intérieur, peut-être aussi de la vérité « ce que tu ignores, les souffles le savent », la couleur bleue est aussi symbole d’un devenir, d’une épiphanie issue du son, celui du premier cri, le souffle primordial, celui de la naissance car c’est lui qui donne sa tonalité à notre vie, et quand Pierre Dhainaut écrit : « Sous le ciel de la mer » ne faut-il pas entendre « la mère » ? Au vers suivant, nous lisons, « Tu n’as jamais fini de naître ».
La parole respire, abolie toute limite, donne son mouvement à la lumière. Il faut laisser aller le souffle : de sa liberté dépend la nôtre. Le poète reprend l’image de la mer pour nous décrire sa perception du souffle comme une houle intérieure qui brasse les souvenirs et il termine sur une image où paroles et images évoquent des entités fuyantes et éphémères dont l’impermanence est acceptée avec sérénité et nous réaffirme la primauté de la parole.
On l’a compris, Pierre Dhainaut a une mémoire avant tout auditive, s’il est habité par des images, ce sont toujours les sons qui prévalent « la mémoire n'explique pas pourquoi au lieu d'une image elle préfère un mot », une mémoire qui fait appel aux sens, comme la parole passe par le corps. Il serait intéressant de rapprocher sa perception de celle d’autres poètes chez qui le langage et le corps sont intimement liés. À titre d’exemple, on pourrait citer Hisaki Matsuura qui dans son tout premier poème affirmait que notre corporéité est vécue dans le langage2 .
Pour voix et flûte est un livre vibrant comme une sonate, un livre qui dit l’amour des mots, un puissant souffle de vie qui enfle au cours des pages (les distiques font place aux tercets puis aux sizains), un souffle qui appelle d’autres souffles, et l’on ne peut s’empêcher de penser à la toute dernière publication de Jean Michel Maulpoix qui, dans Le jour venu3, écrit : La présence nous est donnée, et c’est une joie qui pourrait nous suffire : celle d’être là, seul ou avec d’autres, en ce monde, une fois, une fois seulement, tenu en vie par notre souffle ! Mais il y faut encore tous les mots de la langue pour en dire la teneur. Changer en voix, en chant peut-être, le souffle même de notre vie. Dire, dire encore cela, avec plus de force et de justesse.
Force et justesse sont présentes dans ce recueil de Pierre Dhainaut où les encres bleues de Caroline Rubino effleurent le papier, y laissant la trace de paysages à peine esquissés. Des ombres bleues qui se détachent dans la lumière des pages, comme le regard du poète tourné vers le passé pour mieux voir le futur.
Notes
1.François Cheng, Cinq méditations sur la mort, Albin Michel 2013.
2.Hisaki Matsuura, Ebisu-Etudes japonaises, 2000.
3. Jean-Michel Maulpoix, Le jour venu, Mercure de France, 2020