Chronique du veilleur (40) : William Cliff
Ecrasez-le, Homo sum, Fête nationale, Immense existence, on aimerait citer tous les titres de l’œuvre de William Cliff qui publie aujourd’hui Le Temps, qui semble les contenir tous. C’est le livre d’un poète hors définition, hors jeu, hors classe, d’une sincérité d’autant plus troublante qu’on la sent profondément à vif…
On pourrait citer la formule de son ami et compatriote Jean-Claude Pirotte : « une voix parfaitement émancipée », mais la singularité de ce poète qui se confond avec celle de l’homme voyageur, en errance, en continuels soubresauts et aventures, va bien au-delà. Je songe à un éternel adolescent, mal dans cette société, mal dans son être, et pourtant tellement capable d’exaltations d’âme et de chair, qu’il regarde tous ses contemporains restés sur le quai, alors que son bateau ivre vogue depuis longtemps en pleine mer.
Ce sont quelques escales de cette navigation qu’il évoque dans Le Temps : les logements souvent presque insalubres, les débuts de sa curieuse carrière de professeur, les poèmes écrits sur le tableau noir, les jeunes gens attirants, la poésie des villes, Bruxelles, Dijon, Gheel, Paris, « les rêves comme l’eau de pluie qui s’écoule » et qui « s’en vont se perdre avec les illusions perdues »…
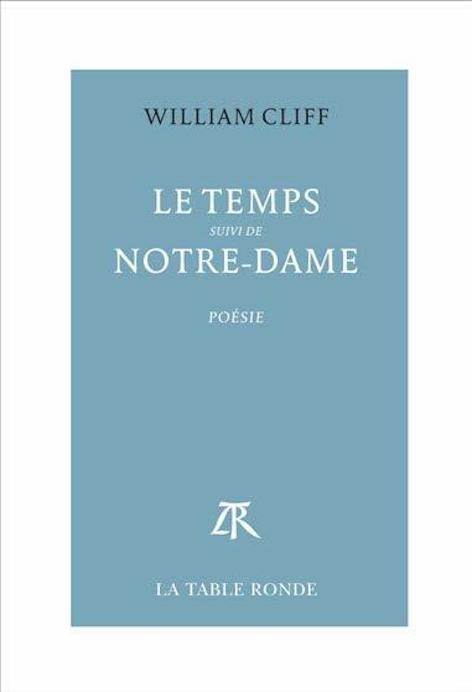
William Cliff, Le Temps suivi de Notre Dame, La Table Ronde, 15 euros.
Et, malgré toutes les misères, un air entraînant fait valser tout cela, avec des notes de dérision qui sont si proches de celles, funèbres, du désespoir, un air de printemps plus fort que tout :
Au printemps il est temps de rénover sa peau,
d’aller dans la forêt se vautrer au terreau
plein de feuilles pourries et d’entendre un oiseau
chanter avec folie, voir un gars de la ville
passer et repasser devant un corps débile
pour se rincer l’œil et se réchauffer la bile.
William Cliff, Brut de poésie, dit pas Jacques Bonnaffé.
Bien sûr, on pourrait admirer les prouesses du voltigeur de l’alexandrin, de ce créateur de rythmes de « proèmes », dans la lignée d’Une Vie ordinaire de Georges Perros, qui fait du langage apparemment prosaïque une matière poétique inédite, incroyablement ductile et syncopée. Dans le poème final, Notre Dame, qui date de 1996, William Cliff fait pertinemment référence à Charles Péguy, offrant ses pauvres vers à la Vierge, tout comme lui à la cathédrale : « Je les ai faits comme un bon ouvrier ».
Oui, il y a de la modestie dans cette façon d’écrire, bien plus que de la légèreté ou de la fantaisie. J’en veux pour preuve cette adresse à Dieu, au « Grand Etre Suprême », où l’on entend passer d’humbles paroles, comme celles d’un enfant triste, étonné par une condition humaine qu’une seule existence ne suffira pas à explorer :
Je voudrais bien savoir pourquoi ces hommes viennent
si nombreux dans ma rue ainsi se promener ?
pourquoi dépensent-ils leur temps, Etre Suprême,
à user le pavé et retrousser leur nez ?
William Cliff, Brut de poésie, dit par Jacques Bonnaffé.
Si le terme de fraternité poétique a un sens, c’est ici qu’il doit être employé. William Cliff, qui est à présent octogénaire, a toujours été le frère des « malheureux dont pleure le cœur », sans doute parce que son propre cœur, secrètement, n’a jamais cessé de pleurer.
