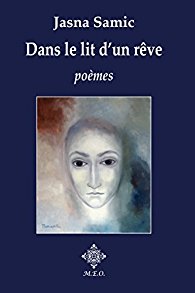En avant, route !
C'est un curieux livre, dont on ne perçoit pas tout de suite l'unité, la nécessité de juxtaposer ces quatre parties, plutôt une sorte de créature couturée à la Frankenstein, les différents éléments gardant leur indiscutable indépendance, participant néanmoins d'un tout, fût-il désarticulé et dérangeant. Ça me va. Cela s'appelle Ordre de marche (éditions Samizdat, Genève, 2016). Peut-on l'éclairer à l'aide de la prosopopée rimbaldienne, « Démocratie » (issue des fameuses « Illuminations ») que l'auteur nous propose en exergue ? J'en reproduis ici l'intégralité (en lui restituant tous les guillemets qu'y avait mis Rimbaud, ce qui fait particulièrement sens, suggérant que nous avons affaire à une parole sinon collective, du moins provenant de plusieurs individus, soldats, parlant au nom d'une masse, d'un corps dont ils sont une partie) :
« Démocratie
Le drapeau va au paysage immonde, et notre patois étouffe le tambour.
« Aux centres nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques.
« Aux pays poivrés et détrempés ! — au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires.
« Au revoir ici, n'importe où. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie féroce ; ignorants pour la science, roués pour le confort ; la crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche. En avant, route ! »
On se place donc d'emblée dans une ambiance militaire qui sera confirmée à divers titres par la suite. Ce ne sera pas le propos de la première partie, intitulée « Résidences secondaires » dont on nous dit qu'elle a été initialement publiée dans un numéro de la revue Archipel consacré au « Jardin dans la ville ». L'auteur la subdivise en deux sous ensembles, le n° 1 – c'est son titre – s'attachant au paysage des cimetières, le n° 2 à celui des bordures d'autoroutes. On aura à chaque fois, un petit pavé de prose sur la page de droite et sur la page de gauche l'architecture plus convenue d'un poème sans ponctuation, avec retour à la ligne. L'univers de la soldatesque semble pourtant affleurer :« Tout baigne dans une odeur de buis et de lierre, de pelouses fraîchement réglementaires. » avec ce dernier adjectif, ou encore : « Plus de sang, plus de corps à tordre / plus de linge sale / asphyxié dans ses fibres » dans cet environnement des cimetières où « Certains viendront festoyer sur les tombes, buvant goulûment à la santé de la tribu » ; de même, concernant les parcelles cultivées en fin de semaine au long des autoroutes, par des citadins de toutes origines : « Et flottent au vent les appartenances, bannières nationales comme autant de filiations affirmées ou fantasmées. ».
La deuxième partie, ne serait-ce que par son titre fait plus directement allusion à l'armée : « Le grand corps ». C'est sans doute plus largement à tous les moules, tous les codes, tous les embrigadements, y compris ceux qu'on s'inflige à soi-même (jusque dans l'usage que l'on fait de la langue, en écriture) que Eric Duvoisin fait allusion. A l'appartenance, consentie ou non, obligée « Crosses et crânes, on nous vaccine. Tout cela paraît bien innocent mais on ne peut s'empêcher d'observer, dans les coutumes du grand corps, une digestion lente qui mène à l'absorption complète de soi – obèse cellule de foule. » ; le poète vaudois semble avoir été marqué par la conscription dans l'armée suisse, aux aspects probablement comparables dans ses rites et conventions, à ce que fut celle qui existait encore en France il n'y a pas si longtemps.
« Le néant a un goût d'urine, Peinture décrépie, mégot froid : sur les parois des petits coins, pullulent les effusions lascives, fleurissent les grappes d'injures. Ailleurs, on se pollue sous le nimbe des néons. Tout cela a des relents de désirs soustraits, de colères rentrées, Ici rien ne se digère tout implose en logorrhées, en glose sur la misère de l'intime.
A travers les lézardes du grand corps, glotte s'étrangle en slogans.
Apnée de pin-up. »
S'il est une révolte, un désespoir, à rapprocher du poème « Démocratie » cité en ouverture, de multiples extraits pourraient en être exemples : « Ogre à bâtir du rien, orgiaque obéissance. », « Hirsute, tout est retrouvé. » (Quoi ? - L'éternité.) et cette entière deuxième partie qui commence par « ..mais l'abcès attend de crever, civilement. », développe en onze textes brefs « L'intime alignement, au garde-à-vous », de manière à la fois sensible et caustique, jusqu'à conclure « L'abcès a crevé. »
La troisième partie , « Bouche bée » a pour exergue les mots de Beckett dans « Fin de partie » : « Tu te crois un morceau, hein ? / Non, mille » et l'argument est posé dès le premier texte.
« De la bouche tous les possibles : un monde de sons, de phonèmes à former musculairement ; la soufflerie des langues isole, fragmente et recompose : ma langue. Sifflantes, fricatives et nasales résonnent dans la grotte, du magma primal s'organise l'orchestre buccal. Des origines va vers le sens, de l'exil vers les signes, et nous différencie de l'animal. L'articulation est le squelette de l'humanité. La parole, son certificat d'authenticité. »
Cent mille milliards de poèmes, façon Raymond Queneau, ou plus encore des yotta-combinaisons, une profusion vertigineuse de possibles. Tout cela s'organisant organiquement, sémantiquement, pour une parole qui permettra (permettrait?) une expression et une communication d'une richesse infinie, une parole qui nous met donc en marge du territoire animal dépourvu de cette « ingénierie langagière ». Pourtant, dans cette troisième division de son recueil, Eric Duvoisin va non seulement questionner cette langue construite, notre apanage – allant jusqu'à pervertir son message initial, par l'introduction quasi systématique dans son texte de références à l'animal, ou jouant du champ lexical y attaché – mais de surcroît décliner de troublantes intersections. « Il vaudrait mieux s'attaquer au langage, le charcuter : épeler un mot, peler les animaux, Et épicer cette viande d'images. » Et finalement, on aura le sentiment, que hors cette fameuse parole articulée, peu sépare l'homme de l'animal et que derrière le petit masque d'hermétisme de ces textes, se cache une virulente condamnation de la boucherie que l'humain continue de perpétrer contre les animaux. Description terrible par exemple de la tuerie d'un cochon, vécue durant l'enfance, « Père et oncles, à entamer le goret : qui gigote, qui couine, qui s'abat au sol. » sans doute fondatrice de ce rapport au texte, à la viande, « Une tête qui roule comme trois points de suspension... ». Pire, cette parole, qui fonde la séparation et autorise le carnage, est durement mise en cause.
« Et tout reprendre à zéro, avec le b.a-ba des syllabes, reconstruire les tissus, sur lesquels à nouveau se fier. Dégager, retrouver de l'allant, de l'allure, de l'haleine – ne plus rien étreindre, garder l'attente dans les yeux, n'articuler que cet intime écart – le silence des mots – entre la bête et soi. »
On nous signale en fin d'ouvrage que trois de ces fragments d'écriture ont été inspirés par Into One-Another, cycle de sculptures et dessins de l'artiste flamande Berlinde de Bruyckere. Le lecteur curieux ira voir sur le Net les œuvres en question qui ne sont pas sans rappeler Francis Bacon pour l'aspect pictural torturé ; les sculptures ont la même apparence douloureuse, cette « présence organique » qu'évoque l'auteur, celle-là même qui nous rapproche de l'animal.
Conscrits du bon vouloir, comme l'écrivait l'énigmatique et ironique Rimbaud, nous arrivons avec « Black Belize » à la dernière partie du recueil. Au début des années 90, j'ai traversé ce pays d'Amérique centrale dont la devise est « Sub umbra floreo » (« Je fleuris à l'ombre »). L'auteur nous en restitue sa vision de « Brusques tropiques » avec sa façon particulière d'images :
« Au matin, un amas d'ailes, masse de cils palpitant dans le ciel d'appétit : rejets carnés d'usine. Au bord de la piste, rut de flèches, kamikazes dans l'air aiguisent les becs, Tout autour se bataillent à coups de couteaux secs, le papier sombre du ciel. Saturé de traits, toi-même est proie et rapace, Les beaux paysages : du linge lavé et repassé. Seuls quelques-uns laisseront une trace dans les souvenirs, acides comme une cicatrice. »
On sent, jusque dans cette poignée d'instantanés, le rêve déçu d'un mercenaire écœuré, d'un aventurier du langage plus que de l'exploration géographique, malgré les cannes à sucre ou les sacs d'amulettes : « Peu importe le fuseau horaire, notre marche forcée à la syncope. » ; le soldat avance, avec son paquetage hétéroclite et j'oserais bien en conclusion un verbe qui ressemble à cet assemblage : n'a-t-il pas cherché à nous... dérouter ? Ou bien cette question posée en quatrième de couverture : « Mais qu'est-ce qui / nous mobilise / sans cesse ? »
*