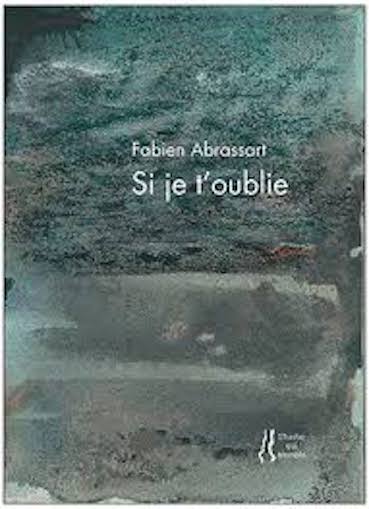Nos affaires terrestres
On se taquinera pour savoir qui est qui
Pour s’amuser en quelque sorte en ce retour de Sibérie
Le premier retour concernait la carte et les kilomètres
Le deuxième – le temps et les secondes
On ne sait qui est le mot qui la pensée et qui l’imagination
Comme des continents de bas-reliefs
Le vrai est impossible à graver dans la pierre
Le dernier est un rocher percé par la lance de l’eau
Tel le rocher de la poétesse qui saute dans le gouffre marin
Le gouffre ouvre les bras et la mer dévoile le Visage d’une Autre Terre
Nasze ziemskie sprawy
Będziemy się przekomarzać kto jest kim
By jakoś zabawiać się w tym powrocie z Syberii
Pierwszy powrót dotyczył mapy i kilometrów
Drugi - czasu i sekund
Nie wiadomo kto jest słowem kto myślą a kto wyobraźnią
Jak kontynenty z płaskorzeźby
Prawdziwy jest nie do wykucia w żadnym kamieniu
Ostatni jest skałą przebitą włócznią wody
Jak skała z poetką wskakującą w przepaść morza
Przepaść otworzy ramiona a morze odsłoni Twarz Nowego Lądu
Inversement proportionnel au tout
Tu pleures des étoiles comme l’univers qui ne connaît pas sa mère
Le cosmos s’éveille en sortant des manches de ses envoyés la pointe d’une flèche mortelle
Le souvenir de cette souffrance a pénétré toutes les étoiles
Elles versent le rouge des lèvres de feu de quelqu’un qui compatit avec elles
Restent des traces sanglantes comme la langue des étoiles dans la constellation du corps qui s’en va
La planète bleue est comme une bague sur l’index d’une victime sur le majeur d’un tortionnaire
Deux pôles comme deux plateaux d’une balance sur lesquels pèse non pas tant l’effet que la cause
Odwrotnie proporcjonalnie do całości
Płaczesz gwiazdami jak wszechświat który nie zna swojej matki
Kosmos budzi się ze snu wyjmując z rąk swoich posłańców ostrza śmiertelnej strzały
Pamięć tego cierpienia przeniknęła wszystkie gwiazdy
Sączą czerwień z ognistych ust kogoś kto współodczuwa z nim
Pozostają krwawe ślady jak język gwiazd w konstelacji odchodzącego ciała
Błękitna planeta jest jak pierścień na wskazującym palcu ofiary i środkowym palcu oprawcy
Dwa bieguny jak dwie szale wagi na których ciąży nie tyle skutek co przyczyna
Cristal
Tu te penches sur le Nombre afin d’en voir plus de la fenêtre que la vue
Tu te penches sur le Nombre que l’on voyait de la fenêtre de la cuisine
Quand tu étais enfant le Nombre venait à toi
Demandait du pain avec du beurre et une allumette allumée
Tu savais son drame : désir d’un espace ouvert et de lumière
Ici entre les bâtiments claustrophobes
Il implorait comme la sensibilité qui implore dans le poème
L’élaboration de la douleur parfaite
Quintessence d’une mise à nue de soi et du monde
Le Nombre fait frire des crêpes et demande que l’on attende les lutins du bonheur
A l’abri du Nombre tu as élevé une maison provisoire
Voyant comme chacun de tes pas ponctue la présence
Séparé de ce qui devrait être su
Tu as choisi l’invisible car la réalité a trahi
Le Nombre que l’on ne peut dénombrer en gens
On dit : la répétition est accidentelle
Comme si on n’avait pas remarqué la ressemblance entre le commencement et la fin
Départ arrivée départ – même planète sans cesse
Manque d’amour et l’amour est ce même
Paradoxe formulé d’une autre manière
Je t’aime entre autres
Les liens entre les mots tels les liens entre les gens
S’agencent comme les atomes dans le cristal
Sans comprendre que chacun d’eux est à sa place propre
Chaque dialogue est différent et pourtant sans cesse le même
Comme la structure du cristal
Triompher du multiple: toujours cette même résistance face au toucher
Un gars avec une étoile tatouée au bras droit
Distingué de la foule il a pour nom Intouchable
Comme s’il existait en lui l’unité
Comme s’il constituait tout le contenu du cristal
Comme s’il poursuivait un dialogue ininterrompu avec lui-même
Il présente la solitude comme des nombres
Il dessine une nouvelle suite de chiffres sur le cadran
L’ordre des conséquences comme s’il composait un nouvel alphabet
Se désagrège et fusionne tombe une goutte dorée
Le Nombre joue à la pluie et assemble hermétiquement les murs de la mer
Le Nombre dans la limpide circulation sanguine du monde dessine ton souffle sur le ciel
Kryształ
Zastanawiasz się nad Liczbą by widzieć z okna coś więcej niż widok
Zastanawiasz się nad Liczbą którą było widać z okna kuchni
Gdy byłaś dzieckiem Liczba przychodziła do ciebie
Prosiła o chleb z masłem i zapaloną zapałkę
Znałaś jej dramat: pragnienie otwartej przestrzeni i światła
Tutaj między klaustrofobicznymi budynkami
Skomlała jak wrażliwość która skomli w wierszu
Wypracowanie bólu doskonałego
Kwintesencja obnażania siebie i świata
Liczba smaży naleśniki i każe czekać na skrzata szczęścia
W cieniu Liczby stawiałaś prowizoryczny dom
Widząc jak znaczy obecnością każdy twój krok
Odcięta od tego co powinno być wiadome
Wybierałaś niewidzialne bo rzeczywistość zdradzała
Liczba która nie jest przeliczalna na ludzi
Mówią: powtarzalność jest przypadkowa
Jakby nie zauważyli podobieństwa między początkiem i końcem
Odchodzi przychodzi odchodzi – wciąż ta sama planeta
Brak miłości i miłość jest tym samym
W inny sposób opowiedziany paradoks
Kocham cię między innymi
Związki między słowami jak związki między ludźmi
Układają się jak atomy w krysztale
Nie rozumiejąc że każdy z nich jest na właściwym miejscu
Każda rozmowa jest niby inna a wciąż ta sama
Jak struktura kryształu
Przezwyciężanie wielości: wciąż ten sam opór przed dotykiem
Chłopiec z wytatuowaną gwiazdą na prawej ręce
Wyodrębniony z tłumu na imię ma Nietykalny
Jakby zaistniała w nim jedność
Jakby stanowił całą zawartość kryształu
Jakby prowadził nieustanną rozmowę z samym sobą
Przestawia samotność jak liczby
Rysuje nową kolejność cyfr na cyferblacie
Porządek następstw jakby ustanawiał nowy alfabet
Kruszy i scala spada złota kropla
Liczba bawi się w deszcz i szczelnie domyka ściany morza
Liczba w przejrzystym krwioobiegu świata rysuje twój oddech na niebie