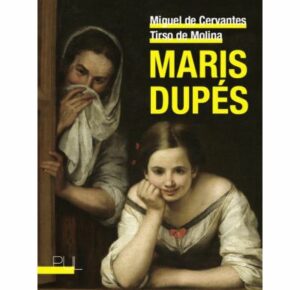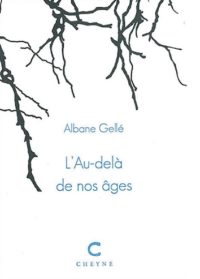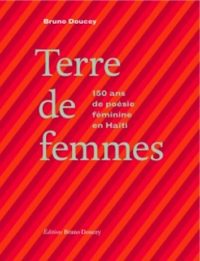Russie. L’Immense et l’intime
La revue États provisoires du poème dresse, dans son numéro 19, un panorama rapide de la poésie et de la littérature russes, depuis l’extraordinaire floraison poétique qui a marqué ce que l’on a appelé l’Âge d’argent (du début du XXe siècle aux années vingt) et enregistre en quelque sorte l’acte de naissance d’une nouvelle poésie russe en ce début de XXIe siècle.
C’est peu dire qu’un volume de 125 pages paraît a priori modeste, et bien fluet, en regard de l’importance à la fois littéraire, historique et symbolique de la matière abordée.
C’est pourquoi les éditeurs ont vraisemblablement, d’abord, choisi de privilégier quelques figures, dont certaines connues, voire légendaires : Marina Tsvetaeva, Ossip Mandelstam, Daniil Harms, Elsa Triolet. La revue se donne un rôle à la fois « patrimonial », en réactivant la légende associée aux noms de Tsvetaeva et Mandelstam, et, « pionnier », en évoquant, en dépit de son ancienneté (il est mort dans les années trente, pendant l’époque stalinienne), la voix de Daniil Harms. D’autres encore viennent compléter, nouvelles, un panorama que l’on nous invite implicitement à considérer comme celui des poètes actuels de la langue russe : Eugen Kluev, Marina Skalova, Ivan Viripaev.
Le volume est pris en charge, dans l’ordre alphabétique, par Caroline Bérenger, Marie-Thérèse Eychart, Jean-Philippe Jaccard, Venus Khoury-Ghata, Eugen Kluev, Marina Skalova et Ivan Viripaev.

Russie. L’Immense et l’intime , États provisoires du poème, Numéro 19, Théâtre national populaire & Cheyne éditeur, 2019, 125 pages.
Il est clair que certains de ces auteurs parlent en leur nom propre, puisque la revue publie certains de leurs textes, alors que d’autres se font principalement les « passeurs », les « commentateurs » les « apologistes » ou les « interprètes » de l’œuvre d’un poète, ou d’une poétesse, à qui ils rendent hommage, quitte à donner un tour personnel à cet hommage.
La revue associe donc une ambition critique à une volonté de participer à l’entreprise de découverte et de promotion d’une nouvelle littérature, peu connue en France.
Et, d’emblée, ce qui frappe le lecteur, c’est avant tout le formidable drame de l’histoire russe. Il est question d’exil, de déportation, de folie, de mort ; et ce cortège de cruautés et d’exactions ne semble pas faiblir en ce début de troisième millénaire.
Caroline Bérenger accompagne Marina Tsvetaeva dans son itinéraire terrestre, de son exil parisien à son retour en Russie, jusqu’à son suicide « dans un village de Tatarie le 31 août 1941 » (p.37). Le récit de cette vie est jalonné d’extraits tous issus de la traduction récente des Éditions des Syrtes (Poésie lyrique, 2015).
Jean Philippe Jaccart nous convie à lire un poème de Daniil Harms, donné en version bilingue, texte russe sur la page de gauche et traduction en regard (p.24-25). Le critique s’attache à donner un sens politique à un poème où revient dans chaque strophe l’ensemble de vers suivant : « le concierge aux moustaches noires […] sous la porte cochère / se gratte de ses mains sales / la nuque sous son bonnet sale / et l’on entend par les fenêtres des cris joyeux / des bruits de pas et le tintement des bouteilles » (p.25). Le temps passe, la tyrannie demeure, le concierge (associé à la plupart des perquisitions) reste en place : est-ce le même, ou un autre qui lui ressemble à s’y méprendre ? Le critique évoque par ailleurs le destin de ce poème, depuis sa création jusqu’à l’époque contemporaine, et conclut de manière pseudo-sibylline en disant que le concierge est toujours là, surveillant « peut-être aussi la fête du centenaire de Harms qu’ouvrait Tomochevski du haut de son balcon en 2005 — an V du règne d’un certain concierge » (p.33).
La poétesse Vénus Khoury-Ghata, s’attache, presque en miroir, à évoquer les destins tragiques de Marina Tsvetaeva et d’Ossip Mandelstam, en miroir, car, non seulement elle traite conjointement des deux poètes, mais a eu elle-même à vivre, en France, l’expérience douloureuse de l’exil, amplifiée par le caractère si particulier, selon elle, du monde des Lettres en France, puisque l’auteur déclare, à ses débuts et même après, avoir « subi comme Tsvetaeva le rejet et l’ostracisme d’un certain milieu littéraire parisien qui prend les écrivains francophones de l’étranger pour des intrus » (p.37). De fait l’article accompagne les deux poètes dans leur marche à la mort, Mandelstam pour avoir écrit, avec un rare courage : « On n’entend que le paysan du Kremlin, L’assassin, le mangeur d’hommes », Tsvetaeva en raison de la participation de son mari aux combats de l’armée blanche.
Marie-Thérèse Eychart publie quant à elle un texte en prose d’Elsa Triolet, qu’elle assortit d’une introduction (p.73-103). Il s’agit de « La maison dans laquelle nous habitons », extrait de Colliers. Le texte nous plonge dans le quotidien d’Elsa et de Louis, dans le petit appartement qu’ils occupent au début de leur vie commune. Le récit vaut par son pittoresque, dans la mesure où il met en scène la vie d’une communauté bigarrée de simples gens au sein d’un ensemble immobilier aux allures de labyrinthe. Marie-Thérèse Eychart détaille avec bonheur et perspicacité les circonstances entourant la rédaction du texte. Par ailleurs Aragon, dans un de ses poèmes, cité p. 73, célèbre l’époque où, pour gagner de l’argent, Elsa fabriquait des colliers.
Les poèmes d’Eugen Kluev (p. 46-59) extraits du recueil Terre verte, sont donnés en version bilingue. Le poète semble nous convier à lire de « petits mystères » dans la mesure où, la plupart du temps, on ne sait qui parle, et même de quoi il est question. Les poèmes s’acharnent à s’entourer d’un halo de mystère et de menace : « La nuit était un champ de ruines ; / dans la cour ravagée / à l’aveugle trainait le salut / de toutes les lanternes » (p.51). Et encore : « Deux orages se sont rencontrés à la fenêtre / et périssent dans leur duel » (P.49). Le paysage tel qu’il apparaît dans ces textes semble investi par la présence d’une forme de menace ou de violence. Notons également la présence d’un univers imaginaire à tonalité germanique.
Marina Skalova, dans un long poème intitulé « L’Air » (p.63-68), exprime une forme de panique : « j’avais besoin il fallait que j’ouvre / la fenêtre fasse entrer de l’air / respire de l’air » (p.63). Cette impression d’urgence, d’étouffement accompagne la vision d’un monde en décomposition, où tout a changé, que l’on ne comprend pas, ou plus : « des années durant ces pages / étaient Aufklärung lumières / éclairant la Pravda du comportement / […] maintenant elles ne disent plus rien / les pages ont avalé leur langue » (p.64). La poétesse nous accompagne ensuite dans une déambulation aux dimensions de la Russie, où apparaissent les indices d’une catastrophe généralisée, notamment écologique : « sur ces territoires il n’y a personne / peut-être seulement quelques éternelles colonies / pour veiller sur la disparition / du gel éternel » (p. 65)
Pour finir, la revue, qui prend ainsi une allure d’anthologie, consacre seize pages au poète-dramaturge Ivan Viripaev. L’auteur, selon toute apparence, compose une sorte de pièce de théâtre sous forme poétique. Les voix se mêlent, d’un texte à l’autre, composant un univers parfois déroutant, comme peut l’être celui de Lewis Carroll : « - Et s’il n’y avait rien / qu’est-ce qu’il y aurait alors ? / - je m’envolerais / en montgolfière. Loin, loin. / je m’envolerais. Et je volerai jusqu’à l’endroit / de ma mère d’où je suis venue au monde. / D’où les enfants viennent. Et après je commencerai / à devenir plus petite, plus petite / et plus petite jusqu’à ce que je devienne / cette chose que j’étais / avant de devenir moi. Et la montgolfière / aussi deviendrait petite, petite / jusqu’à ce qu’elle se change en cette chose / qu’elle était avant / de devenir montgolfière » (p.109).
Ainsi ce numéro d’États provisoire du poème remplit pleinement une fonction de « veille poétique », en suggérant au lecteur de s’engager sur les voies de la poésie russe, un des pays au monde où, il y a peu encore, on lisait le plus de poésie. La revue réussit la gageure de susciter la curiosité au cours d’une lecture stimulante, où l’on oscille entre la sensation rassurante du connu, mais du connu évoqué avec art, et passion, et celle, piquante, de la découverte et de la nouveauté.