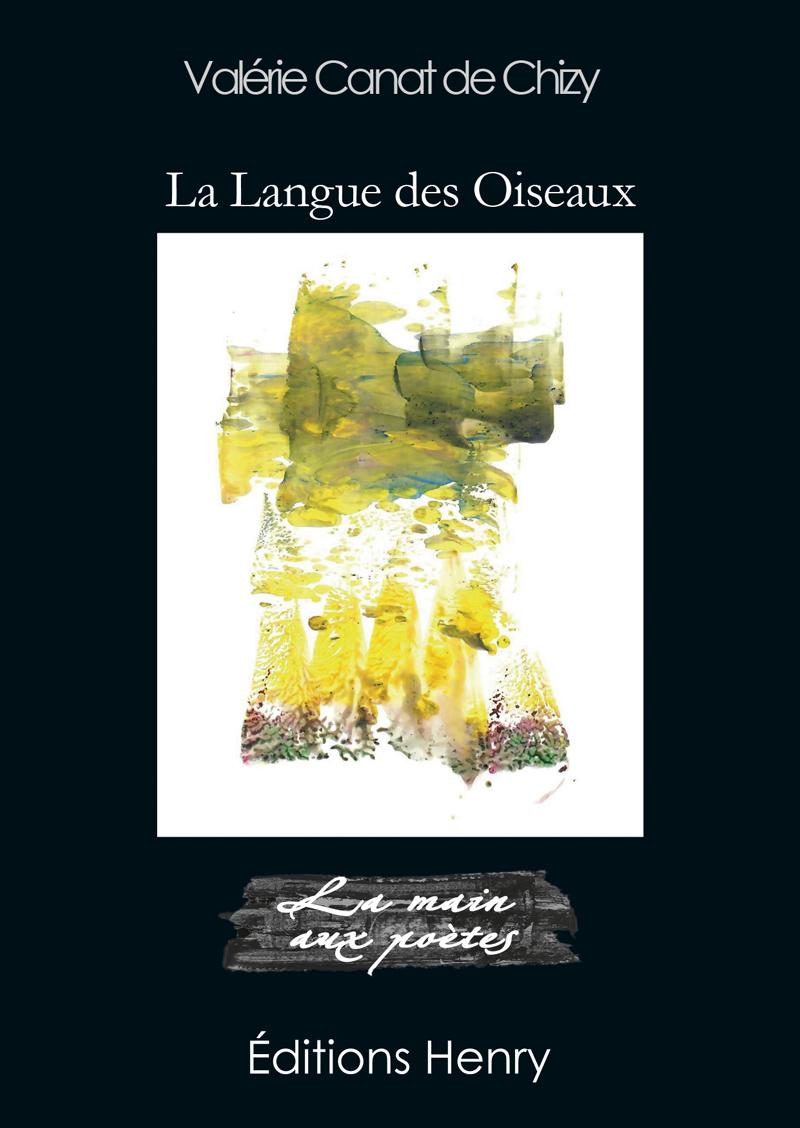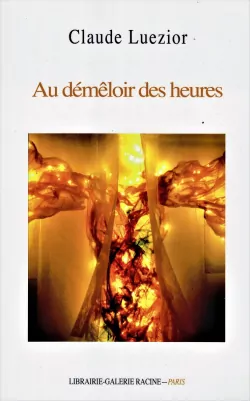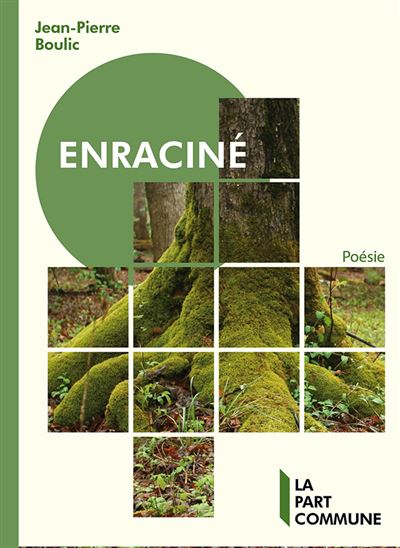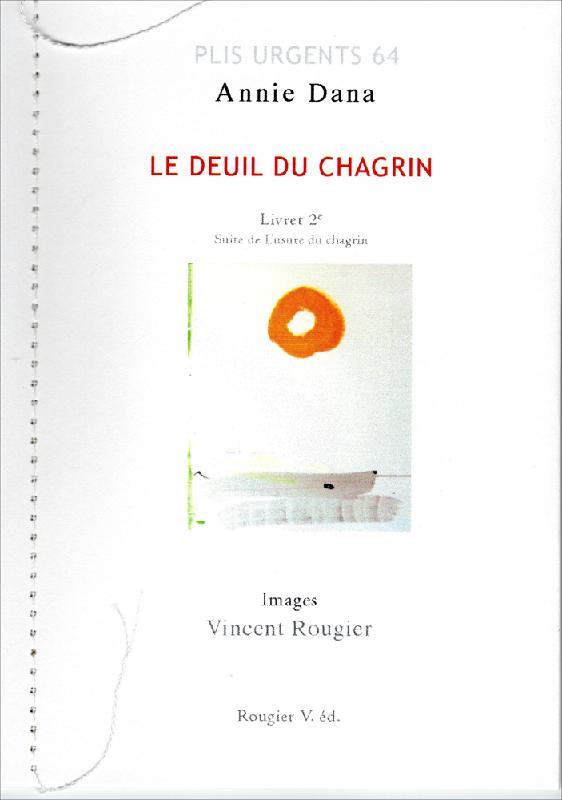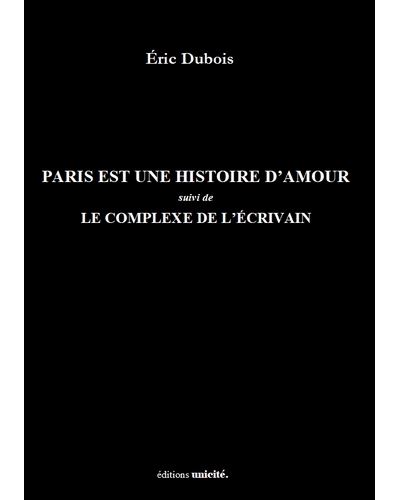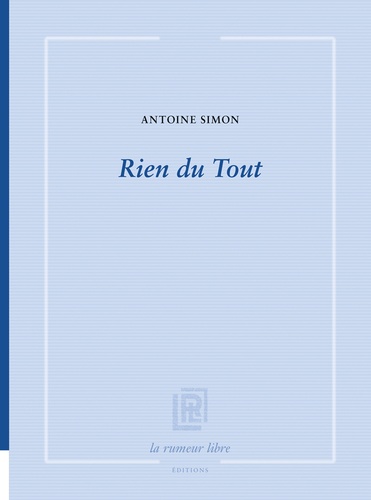Joël-Claude Meffre, Ma vie animalière suivi de Homme-père/homme de pluie et Souvenir du feu
J’ai fait ce songe. Il nous a consumés sans reliques
St-John Perse Éloges
Une fois n’est pas coutume, commençons par la fin. Dans « Souvenir du feu », dernière section de ce recueil saisissant, nous pénétrons au cœur d’une image angoissante, celle de ce chariot qui semble aller seul, portant en lui un feu insatiable.
L’image est puissante, presque surréaliste, c’est un œil d’enfant qui l’observe, la symbolique en est fulgurante et terrible.
Il brûle par lui-même,
sans rien qui le nourrisse.
C’est le feu avivé
de mon rêve
ressurgissant dans mes nuits.
(…)j’ai peur que le même feu
ne consume le rêve
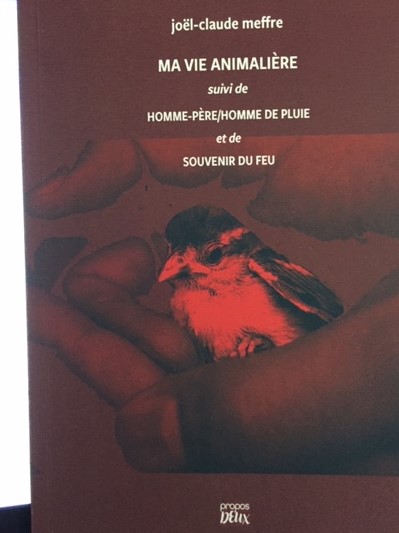
Joël-Claude Meffre, Ma vie animalière suivi de Homme-père/homme de pluie et Souvenir du feu, éditions propos DEUX, 2023.
C’est que Joël-Claude Meffre, comme rarement auparavant, nous accueille chez lui, dans l’intimité de son imaginaire, mais encore dans sa famille. Son frère, son père, deux figures complexes, tutélaires et énigmatiques, deux fantômes n’ayant laissé nulle trace sauf dans le cœur de celui qui se les rappelle. Comme le dit fort justement Marilyne Bertoncini dans sa belle Préface, « Les quatre parties débordent, les souvenirs abondent -et l’organisation élémentaire se fissure laissant transparaître des éléments épars d’une biographie liée à la ruralité, aux activités mystérieuses et paradoxales, dans le monde du « comme si » de l’enfance, confrontée à la mort infligée par les adultes (…) » Ainsi, dans la section « Grives » est-il question des oiseaux, certes, mais surtout, du Grand Frère, l’oiseleur, tantôt évoqué à la troisième personne et tantôt à la deuxième, comme pour tenter un dialogue. Celui-ci a lieu, bien sûr, mais il demeure éphémère et, bientôt, s’interrompt.
L’homme-oiseau, l’oiseleur, regarde parfois
ce vide-là,
qui a le visage d’une absence (…)Reste le chant.
Quelque part, ailleurs,
les hommes continuent à chanter
un langage de chants
sans qu’aucun mot ne se forme dans leur bouche (…)
Mais où est le pays de Joël-Claude Meffre ? Sans doute « Aux alentours d’un monde » comprenant le Ventoux, certes, mais, surtout, en ce chant qui « est un fleuve où les paroles communiquent avec leurs sources » selon la très belle citation de Jean Monod, insérée dans l’un des poèmes de « Grives » … D’ailleurs, dans « HOMME-PERE/HOMME DE PLUIE », il est question de « l’aval » et de « l’amont » de la « rivière », l’Ouvèze, jamais nommée. Le pays où nous nous trouvons n’en est ni la source :
dans la montagne
de la Chamouse
ni l'embouchure
La rivière, à elle-même, elle est son propre chemin qui va
par-delà la plaine,
jusqu’au fleuve qu’elle vient rejoindre.
Et cet entre-deux convient à l’évocation de ces figures absentes et singulièrement, celle du père :
Je pourrais peut-être retrouver l’image
de son visage,
celui de l’homme qui fait front à l’aval (…)
Je ne saurais imaginer
quel a pu être l’amont de sa vie,
l’amont le plus en amont de lui-même (…)
Il y a, chez Joël-Claude Meffre, comme une frontière infranchissable, un au-delà, lequel pourrait bien être un en-deçà, en même temps suggéré et inaccessible. Mais n’est-ce pas le propre de la condition humaine que de nous retrouver perdus entre un amont et un aval inatteignables ?
Il faudrait beaucoup d’attention
pour réveiller en nous quelque mémoire
du chuintement de ces sources.Cela même ne peut se dire
ni même sens doute se penser.
Les oiseaux seuls s’en souviennent peut-être.