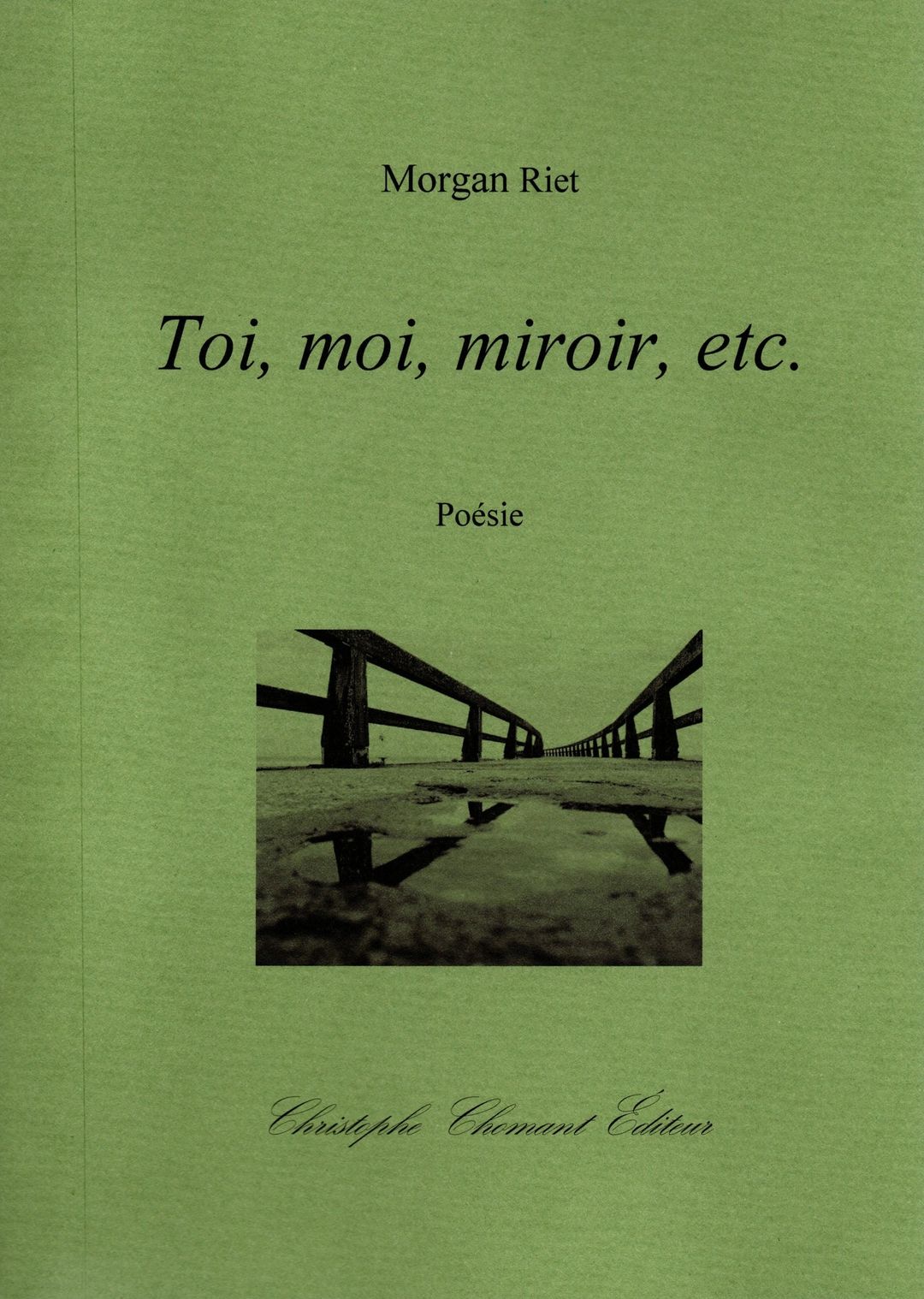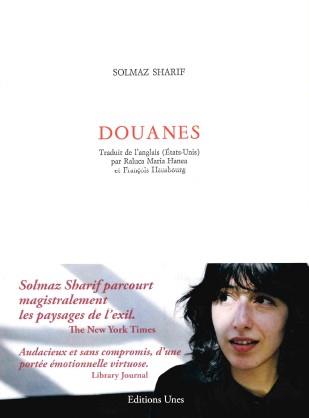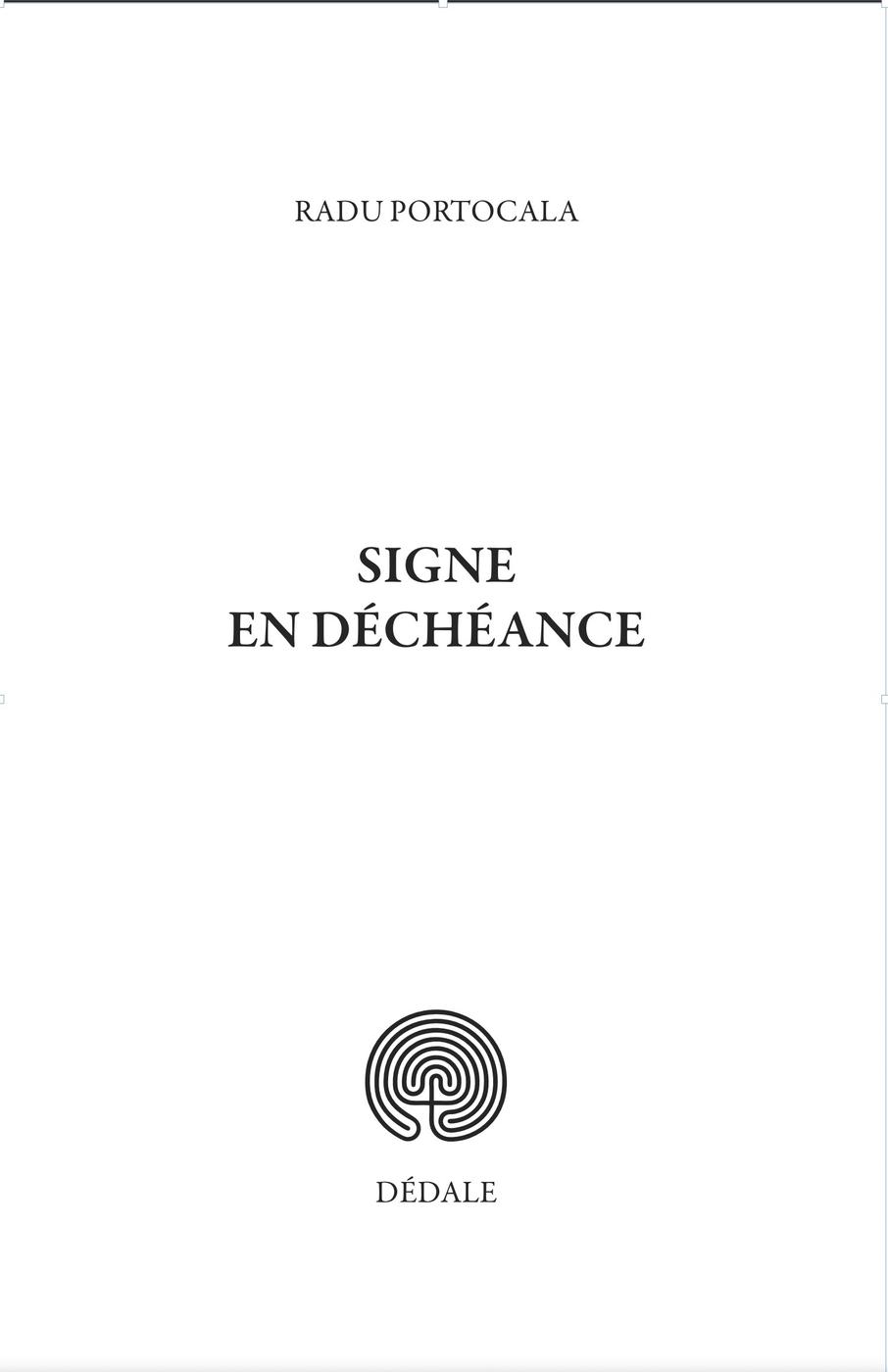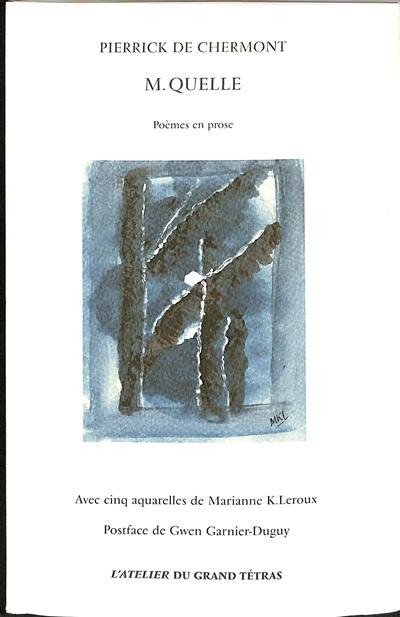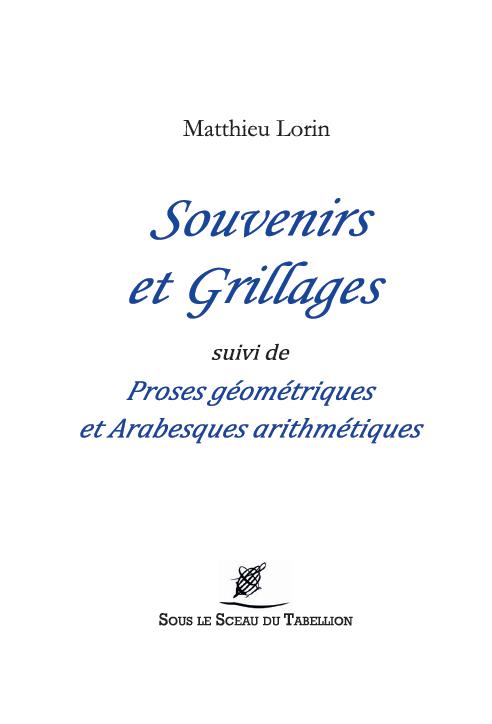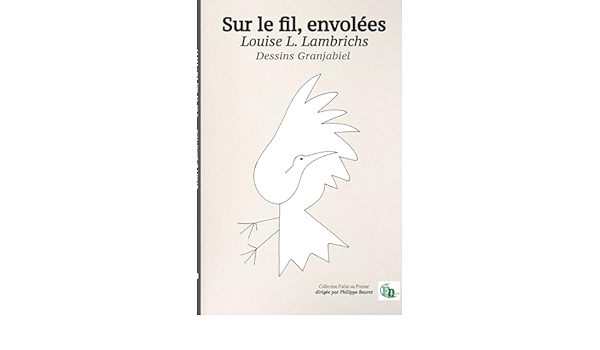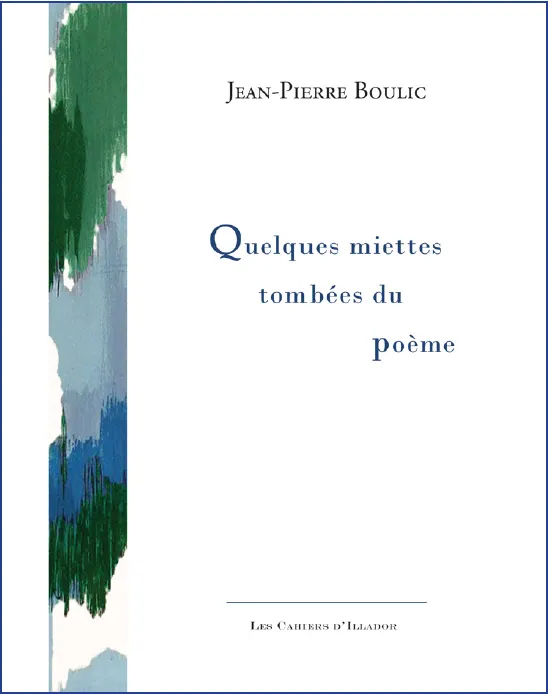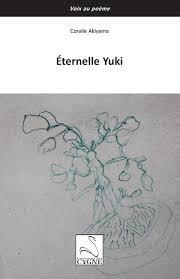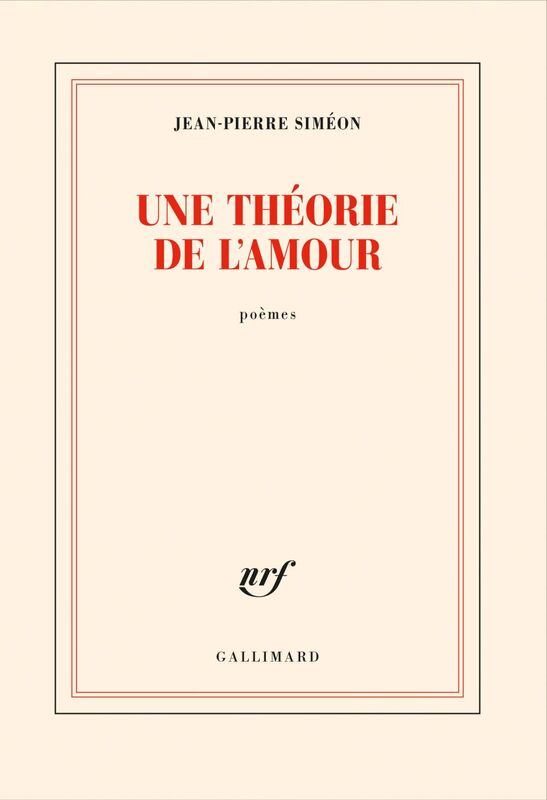Sabine Dewulf, Près du surgissement
Nous entrons dans le livre de Sabine Dewulf par une photographie signifiante. En couverture du livre, une eau vive, un bouillonnement « Près du surgissement ». Où peut-on demeurer pour écrire un poème ? Près de la source.
Les photographies de Stéphane Delecroix, photographe-philosophe à la recherche de beauté et d’harmonie à travers son viseur, nous y invitent : du minéral à l’aquatique en passant par le végétal, on suit un regard qui nous initie. L’eau, la terre, l’air, le feu, les quatre éléments sont présents auxquels il faudrait peut-être ajouter le vide, ce cinquième élément du bouddhisme. C’est ainsi que Près du surgissement semble retracer une genèse personnelle.
L’histoire de ce livre est présentée en avant-propos. Tout a commencé, pour la poète, par l’« étonnement, mêlé d’émerveillement, face aux images singulières de Stéphane Delecroix : souvent proches de l’abstraction, toujours inspirées par le monde naturel, ses photographies traduisent une présence au monde à la fois intense et respectueuse1 ». Reliant ces images à ses recherches sur l’histoire des lettres de l’alphabet, la poète en avait sélectionné 26 (+2 pour début et fin), puis avait procédé à un montage (établissant un ordre) et écrit une suite de 26 poèmes, de « Altitude » à « Zénith ».
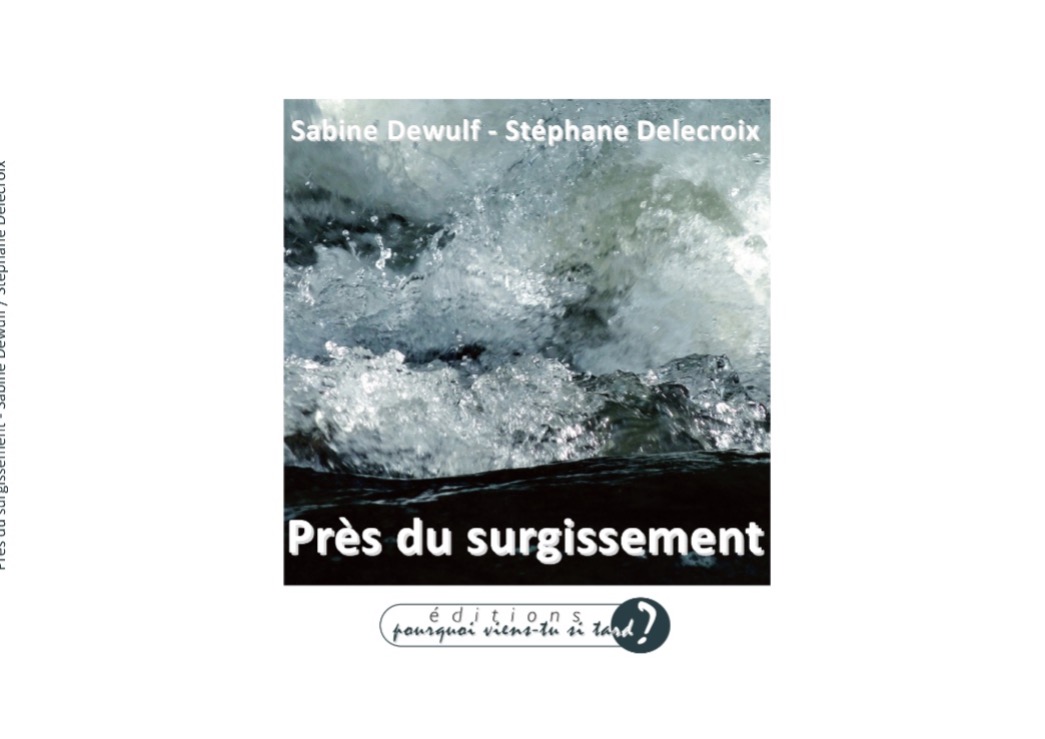
Sabine Dewulf, Près du surgissement, photographies de Stéphane Delecroix, Éditions Pourquoi viens-tu si tard ?, 2024 – 70 pages, 12 €
Quelques années plus tard, elle s’est éloignée de ses poèmes jugés par elle-même trop « tendus vers un universel idéalisé », alors que les photographies la fascinaient toujours autant. Elle a donc écarté les poèmes de Cosmos où nous dormons1 et procédé à un autre montage, première introduction du temps, d’un rythme, d’un instantané à l’autre, chemin tracé pour conter une autre histoire.
Sabine Dewulf est de ces poètes qui pourraient reprendre la formule chère à Georges Didi-Huberman : « Aller lire ailleurs pour voir si j’y suis.2 » Si le téléobjectif rapproche le lointain en quête de lumière, d’harmonie, de lignes et formes abstraites, l’écriture fait pénétrer dans un arrière-plan intime. Plus de contrainte alphabétique, voici une suite de poèmes retraçant un développement, une croissance, une quête personnelle et spirituelle partant de l’enfance pour y retourner. La brièveté des poèmes répond à l’instantanéité des photographies. Le photographe n’intervient plus quand la poète entreprend de lire et relire les images, de les lier et relier entre elles et avec les textes.
Il suffit de rester, il suffit de vivre l’instant. Sabine Dewulf l’exprime dans la préface : « face à une réalité sensible » livrée par les photos, les images « parviennent à nous dépayser ». C’est qu’un détail dans l’immensité du ciel, par exemple, traverse l’espace telle une virgule à l’envers, faisant signe ou énigme. La poète le découvre, l’éprouve et voit « la fracture ». Jamais, dans ce joli livre, le sens des poèmes n’amoindrit la perception. Quelque chose, suggéré par l’image, est revisité au prisme de la vision et de la poésie.
Les images aquatiques dominent la série : neuf sur vingt-six. De l’eau naît la vie, puis les émotions, celles de l’enfance et celles de toujours
Comme un rire égaré
la marée est montéeet si la mer m’envahissait
profitant d’une porte
entrebâilléela façade défaite
seul compterait le largel’eau que je suis déjà
Les vagues, les larmes, la pluie se mêlent dès le poème suivant. C’est une sorte de chaos originel, mais dans lequel déjà « tout s’ordonne illisible ».
Un nuage, virgule inversée dans le ciel, sera lu comme le signe d’acquiescement au ciel et à sa couleur. Le ciel constitue l’une des parenthèses privilégiées du livre. La déclinaison des couleurs, la présence des nuages ou leur absence, permet à la poète de discerner des émotions et de les rendre fertiles. Sa force est telle qu’elle absorbe la colère et facilite le passage vers l’écriture. La formulation, à travers la lecture des signes du monde, sauvegarde l’impression vive de la contemplation et le regard est orienté vers un dépassement :
j’ai appris à pleurer
sans le vouloir le gouffre
s’est inverséc’est à peine s’il gronde
Cette inversion, permise par l’écriture, ouvre un espace de signification :
Sur mon sommeil se penche
une face nouvelle
qui fait la ronde
Ronde d’enfance, ronde Terre conciliante et protectrice.
Sabine Dewulf est poète de la Terre. Dans son deuxième livre, Habitant le qui-vive3, elle le posait bien dès son titre. Elle y écrivait par exemple : « Je rêve de mon corps comme ventre de terre ». Son premier livre personnel, Et je suis sur la terre4, insistait sur cette présence qui implique blessures, failles et manques. Elle y évoquait « la blessure initiale ». Ici, elle nous confie : « J’habite la fracture » et « je suis la vulnérable ». Parfois les rêves ou rêveries entraînent très loin, mais : « je touche la terre au réveil // frissonnement ». La quête qui permet l’envol vers le ciel et au-delà ne peut faire oublier qu’il nous faut habiter la Terre en toute lucidité :
de moins en moins je souffre
en remerciant
je cherche ce qui brûle
Un ciel uniformément et intensément bleu, est à peine marqué d’une trace d’avion : une disparition. Ce ciel est-il un vide, le néant ou un ailleurs ? Le poème nous entraîne plus loin nous révélant, avec la même intensité, que « le soleil / partout rend grâce au bleu // depuis la nuit jusqu’au vertige ».
Vie et poème confondus dans l’apprentissage : chaque texte apprivoise l’instant, c’est ce couronnement d’un équilibre trouvé qui est célébré à travers le livre. Les poèmes, guidés par les images, restituent une quête où ce qui est cherché ne résout pas les dilemmes mais les rend vivables. Aucune fuite n’est tentée, la confrontation salutaire ouvre à la métamorphose, « après les soubresauts/l’éternelle colonne ».
Sur la photographie de Stéphane Delecroix enfin une silhouette enfantine dans l’éclat du bord de mer, l’ultime poème semble concentrer ce chemin parcouru qui ramène au surgissement toujours recommencé de l’enfance :
Un enclos s’est défait
je me souviens j’étais
une enfant sur les vaguesmordant l’été
au sous-bois des aiguilles
à ce point odorantesque même entre deux murs la mer
surgit encore
Notes
1. Cosmos où nous dormons, Stéphane Delecroix et Sabine Dewulf - Terre à ciel (terreaciel.net)
2. Georges Didi-Huberman, Tables de montage (Éditions de l’IMEC, 2023).
3. Sabine Dewulf, Habitant le qui-vive – œuvre d’Ise (L’herbe qui tremble, 2022).
4. Sabine Dewulf, Et je suis sur la terre – aquarelles de Caroline François-Rubino (L’herbe qui tremble, 2020).