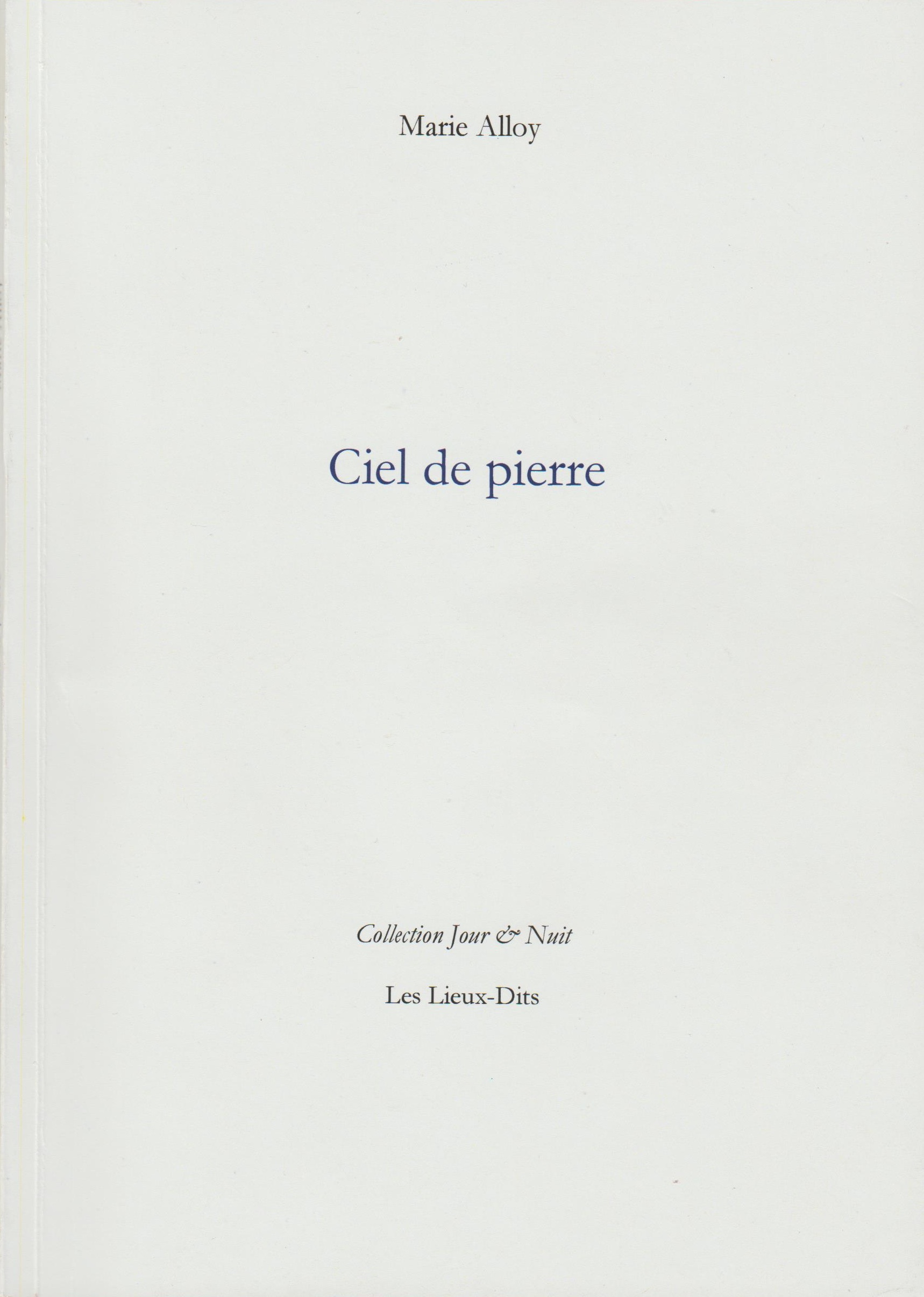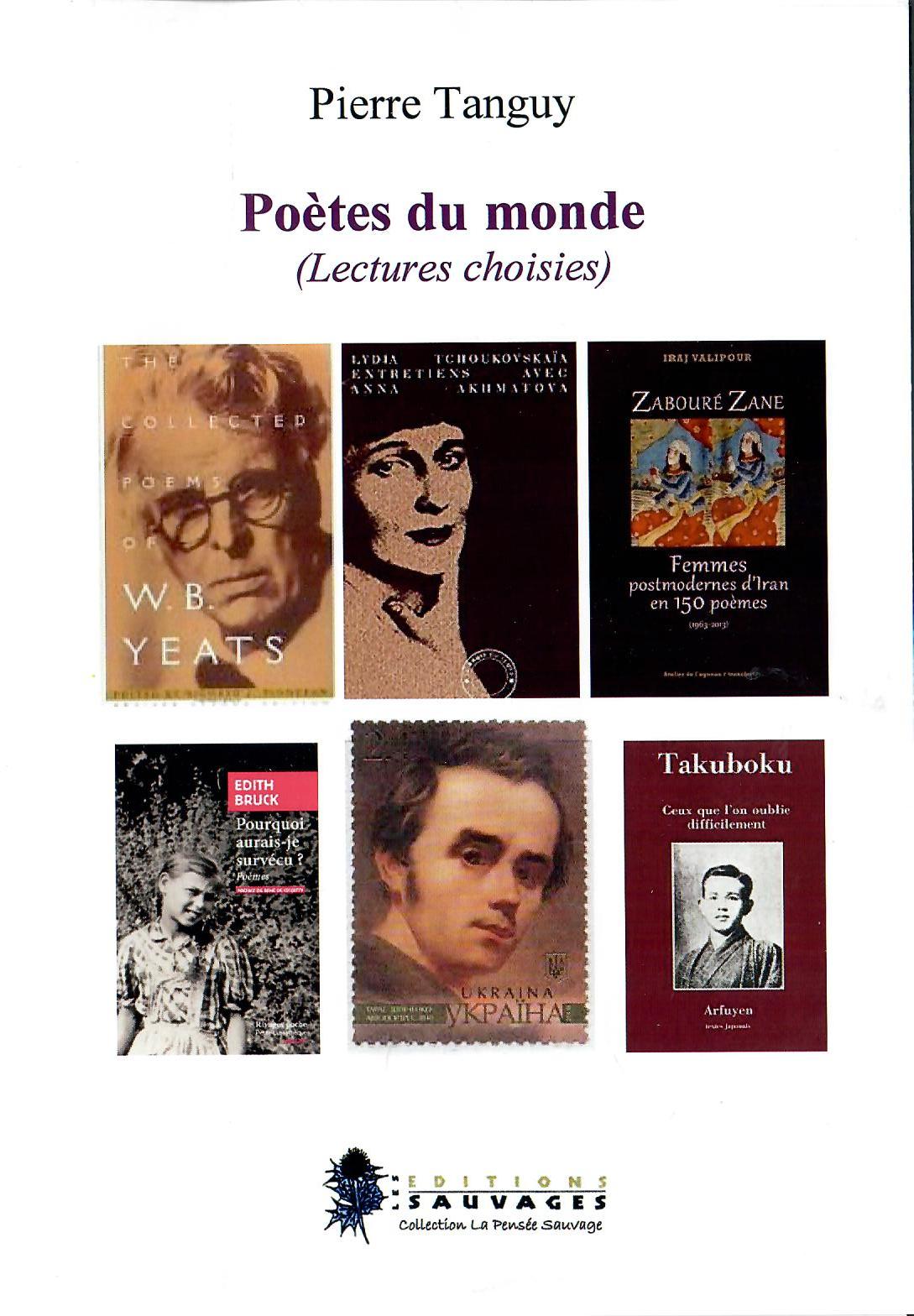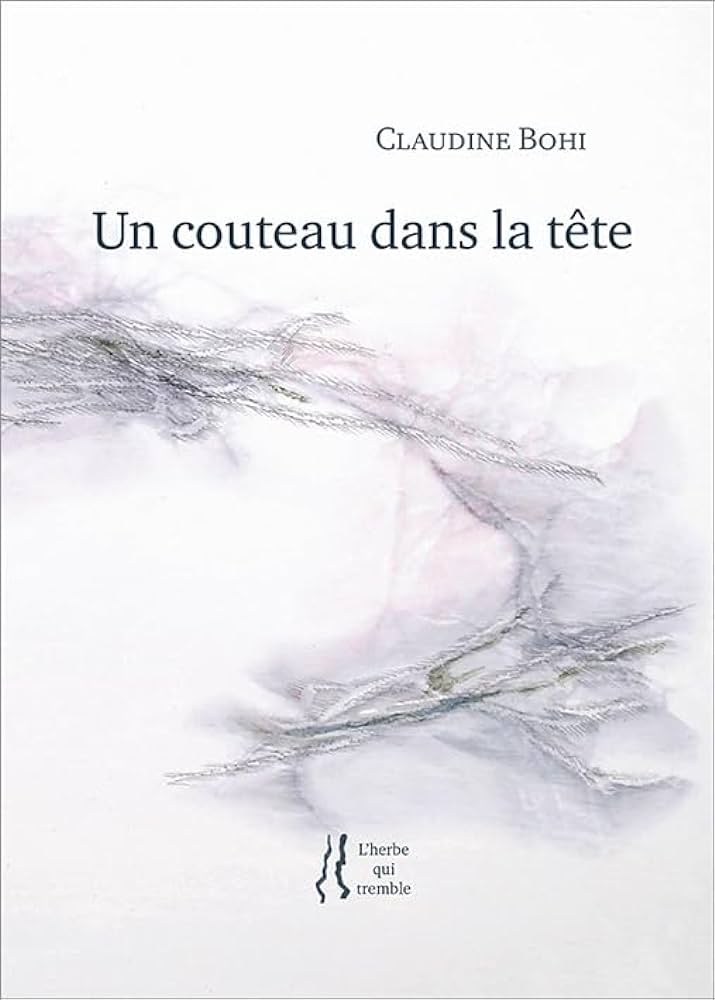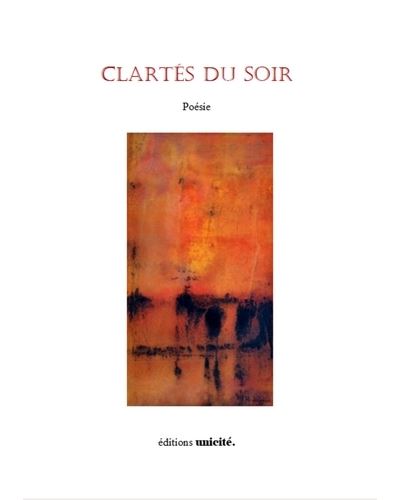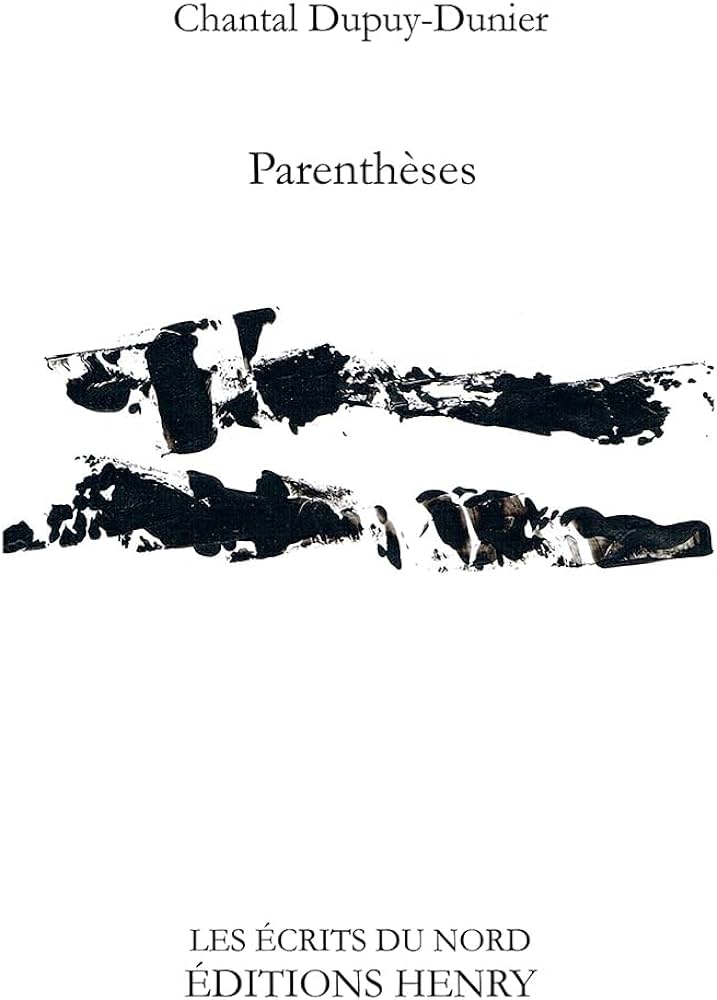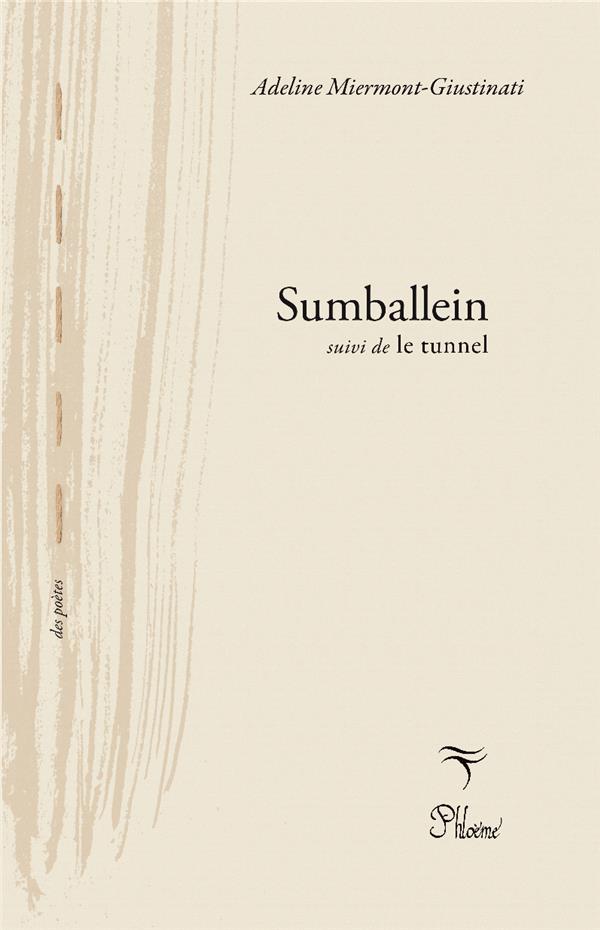Béatrice Libert, Comme un livre ouvert à la croisée des doutes
Une note en postface nous apprend que ce livre s'est construit durant le confinement de la façon suivante : Laurence Toussaint, cloîtrée dans sa maison de campagne et faisant une promenade quotidienne autour d'un étang, envoya une photo à Béatrice Libert qui lui répondit par un poème. Le principe était lancé : une photo suivit auquel un poème fit écho, ainsi de suite jusqu'à constituer un livre d'artistes de 56 images accompagnées de 56 poèmes, publié en 2023.
La seconde édition, courante, nous donne à lire les poèmes, cinq reproductions photographiques seulement figurant à l'intérieur de l'ouvrage (en sus de celle de couverture). Celles-ci signent la présence de l'eau (la promenade autour de l'étang) mais sont aussi un éloge de la lumière et de ses variations.
Le livre est encadré par deux citations de Christian Bobin : « Ce qui ne nous sauve pas immédiatement n'est rien. » en exergue et « L'art de vivre consiste à garder intact le sentiment de la vie et à ne jamais déserter le point d'émerveillement et de sidération qui seul permet à l'âme de voir. » en fin d'ouvrage. Voilà qui pose la tonalité (contemplative, sensorielle, de cheminement intérieur) : Une lumière qui tiendrait le pays / Comme on tiendrait la main d'un poème avec parfois des glissements mystérieux qui font que l'on reste songeur, laissant les vers flotter doucement, les répétant intérieurement : Partir est parfois une phrase si longue / Que certains n'en reviennent jamais.
Si le poème est légèrement descriptif, évocateur plutôt, il s'accompagne souvent d'une interrogation sur soi, le monde, l'écriture, le sens...
Flambeaux drus d'avril
Promesses de PâquesÉcrire est-ce dédoubler le temps
Ouvrir un cahier d'eauFaire sentinelle
Au bord du videPorter ce vide envahi d'azur
À son sommet d'incandescence ?

Béatrice Libert (poèmes), Laurence Toussaint (photographies), Comme un livre ouvert à la croisée des doutes, Le Taillis Pré éditeur, 2023, 96 pages, 15 €.
Nous voici donc dans un entre-deux : l'évocation du concret et la posture abstraite, intellectuelle et poétique : Debout sur l'aile de l'instant / Quel vertige nous saisit // Alors que la lumière / Joue à la marelle sur un arbre flétri ?
J'ai précisé les circonstances d'écriture de ce livre. Le confinement et ses conséquences sont bien là, en arrière-plan, dans ce poème par exemple :
Ce poids sur notre attente
Cette barrière invisible dans l’œilCe cadenas posé sur nos voyages
Cette frontière fermée à tous les horizonsNous aimons leur donner
L'empire d'un nouveau langageEn levant chacune de ces limites
En nous disant « Le monde c'est toi !
C'est alors une attention plus grande portée au monde accessible, au proche : Il nous arrive quelquefois / De regarder ce lent bocage // Comme si c'était la première fois / Comme si nous étions photosensibles et cette acuité renouvelée mène à des associations : Ce n'était pas un paysage / Qui se lisait sur l'étang // C'était un tableau de Magritte / Peint par un nuage qui passait, un regard qui va du dehors au dedans : On jette l'ancre puis on écoute / Les voix qui nous traversent dans une durée qui se trouve modifiée : Et voici que l'instant / S'est lentement dissous ou encore : La journée a eu lieu on ne sait trop comment / Mais elle a traversé l'immense et le peu // Comme si les heures n'existaient plus / Sinon pour le plaisir des seules horloges
Bien sûr, la nature est omniprésente (rappelons que le prétexte est une promenade autour de l'étang) et elle renvoie à notre incomplétude :
Après les pluies orageuses
Les arbres ont gonflé leur voilureOn se disait qu'ils réagissent mieux
Que nous aux éclats des intempériesLeur faconde interpelle le ciel
Et la confiance demeure leur viatiqueNous nous avons les bras coupés
Comme par une ombre nostalgique
J'aimerais conclure par ces trois vers qui, à mon sens, reflètent l'esprit du livre :
Peut-être ne faut-il plus rien dire
Ne rien penser ne rien écrireSimplement respirer respirer