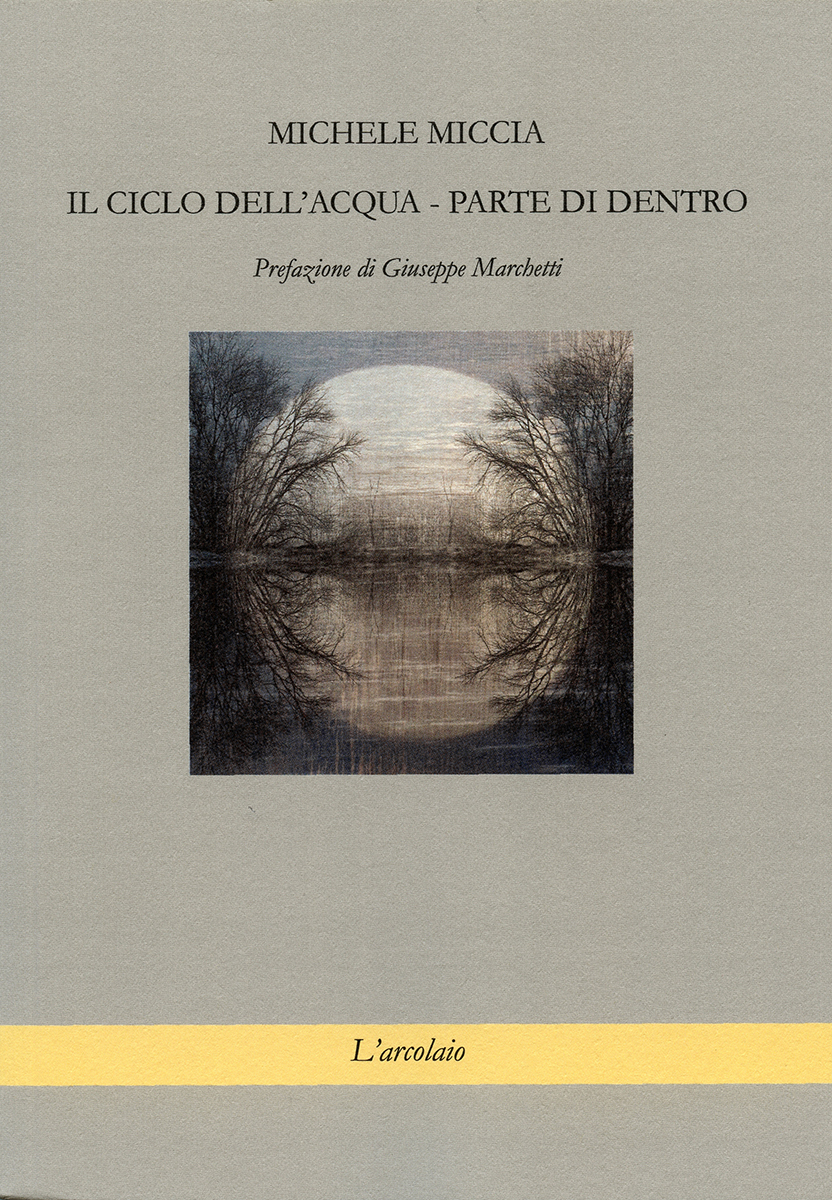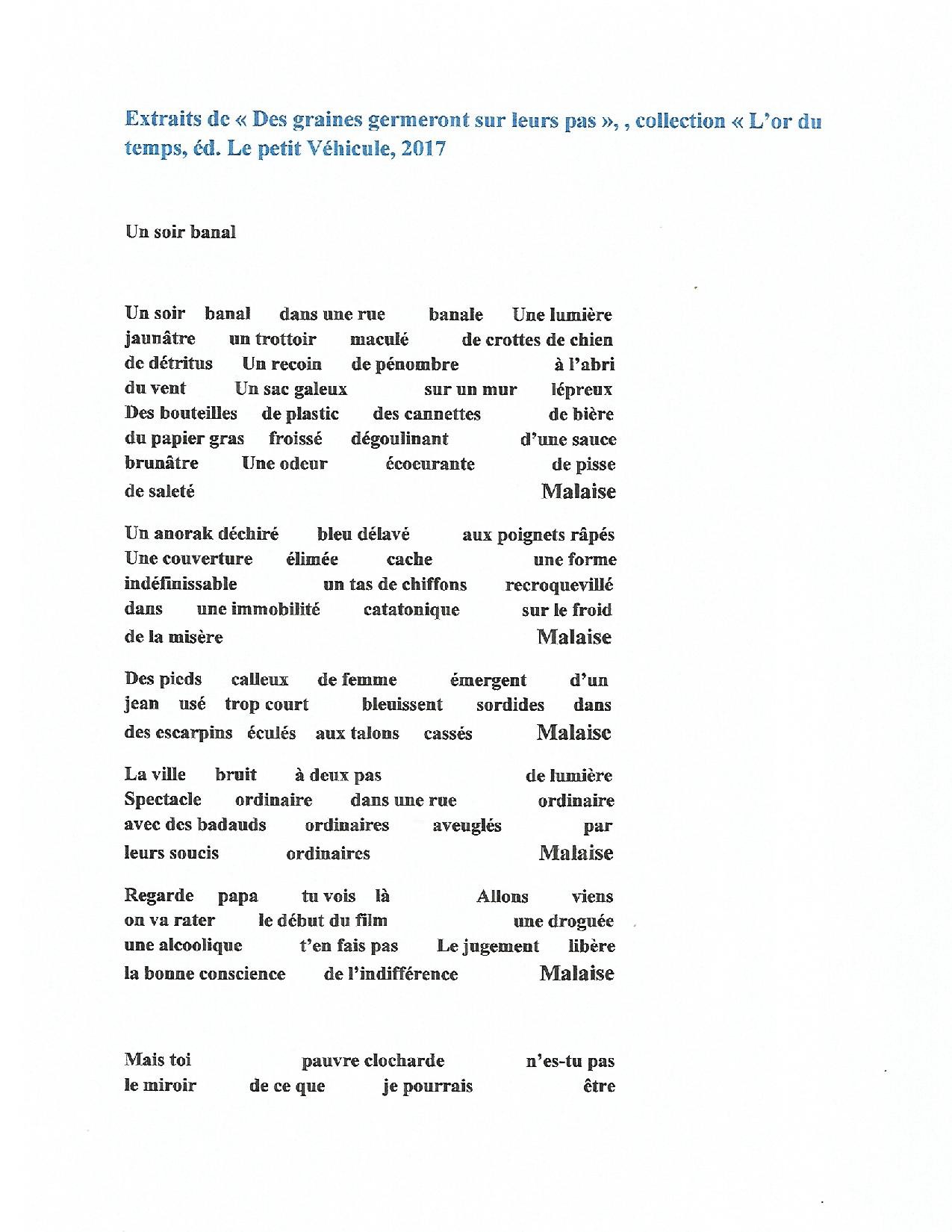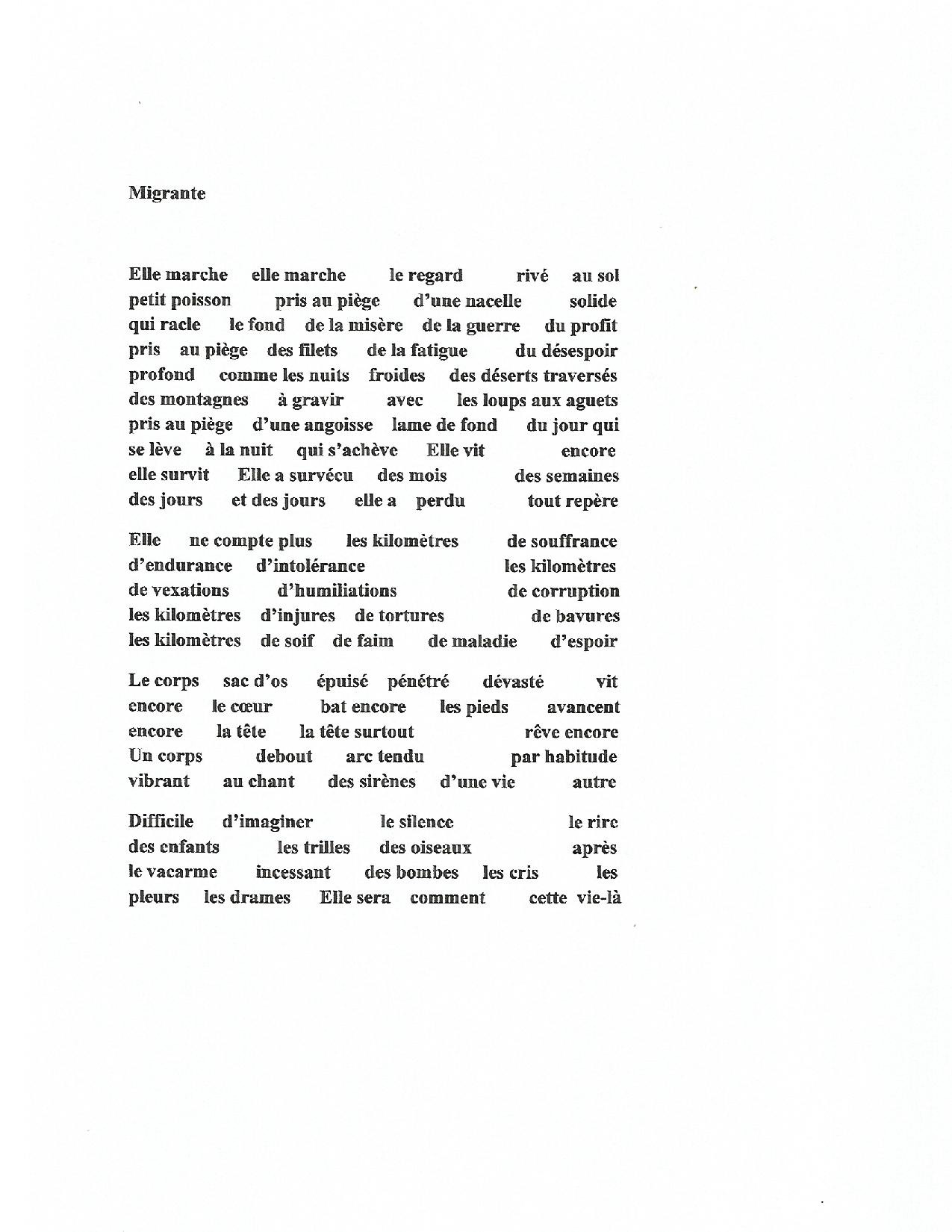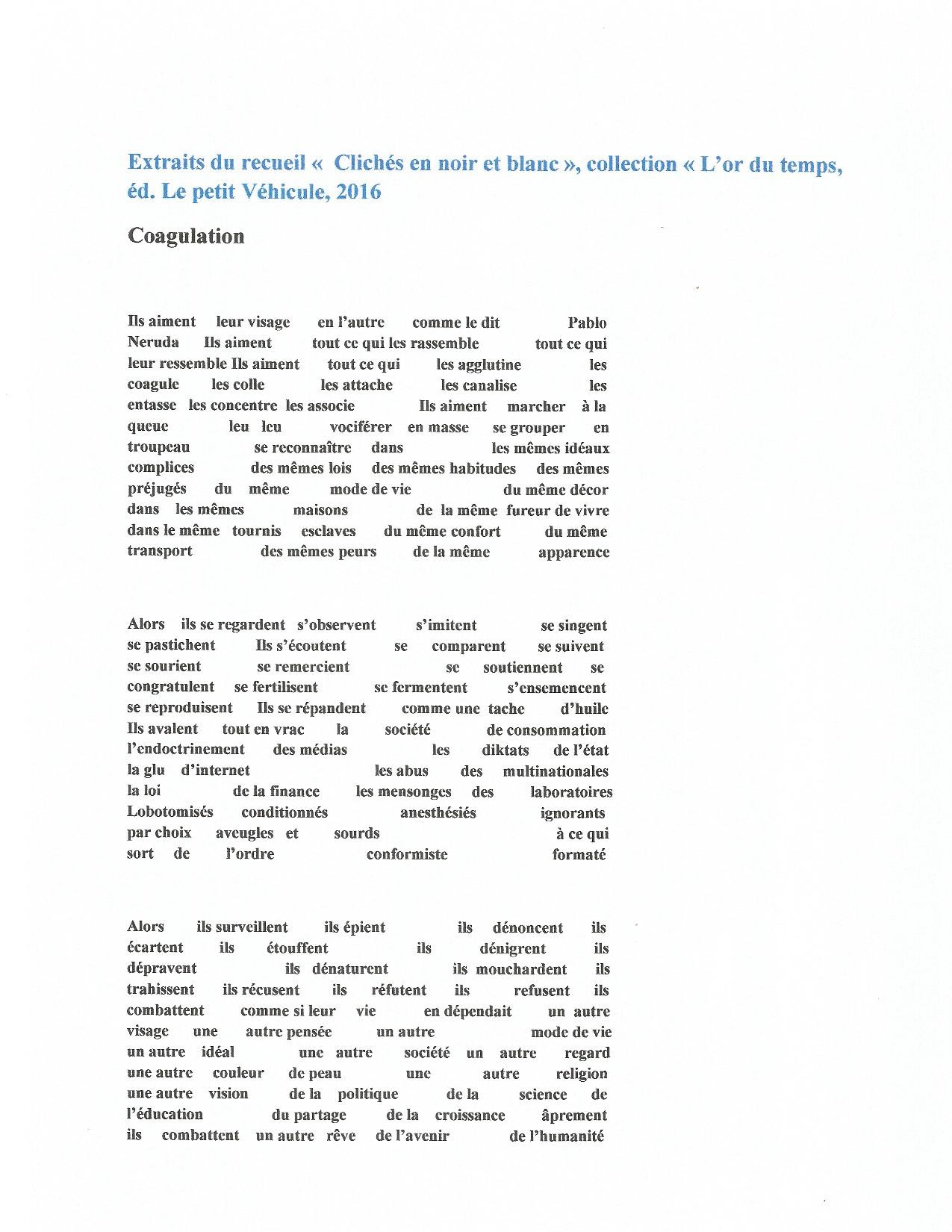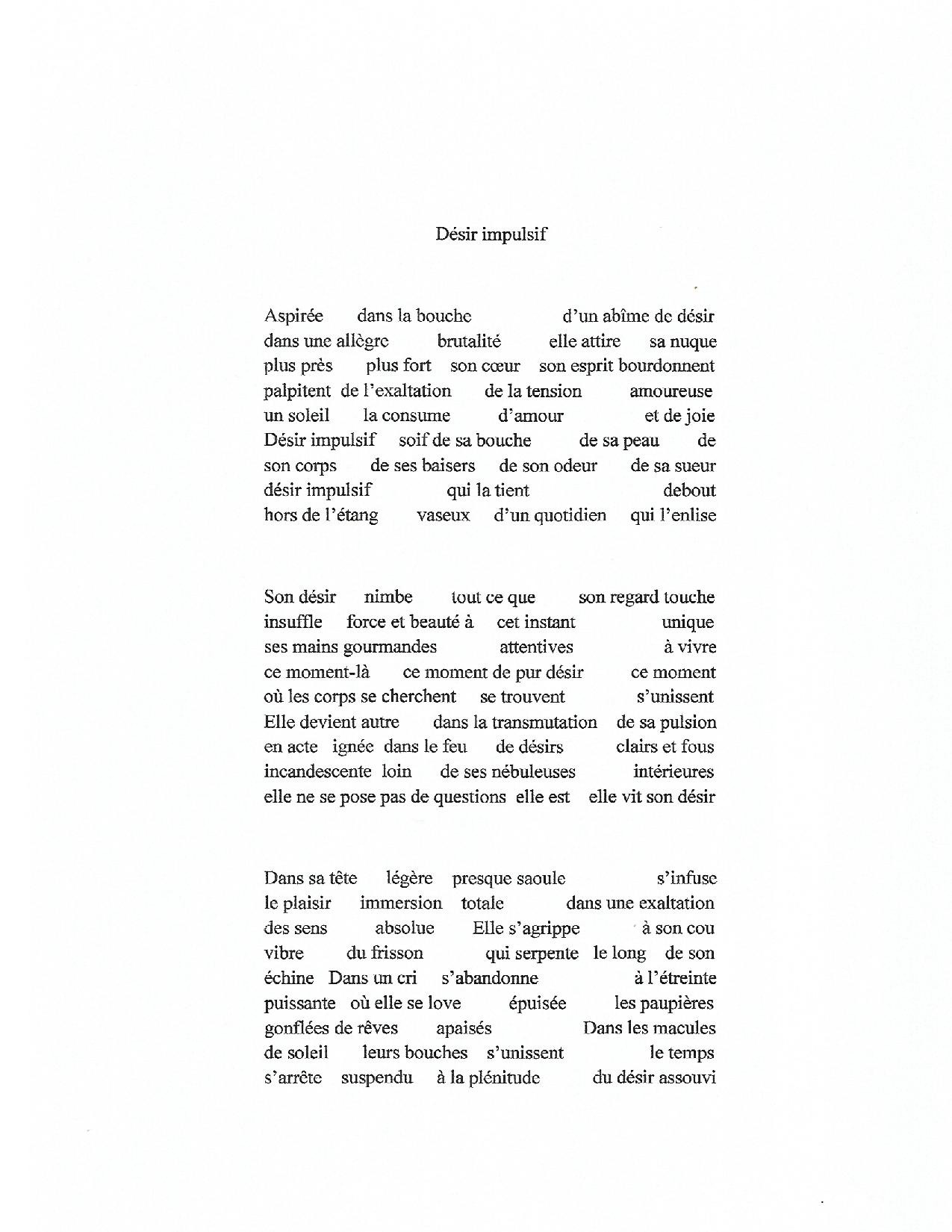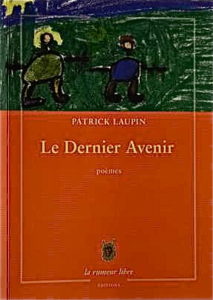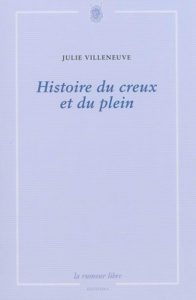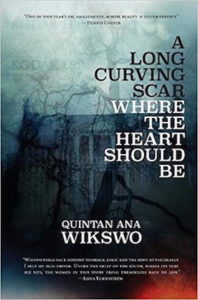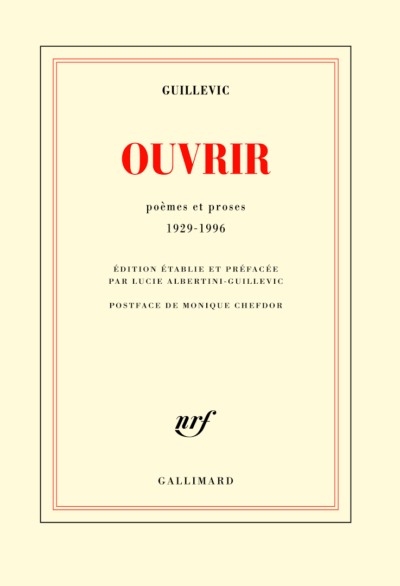Michele Miccia — Il Ciclo dell’acqua / Le Cycle de l’eau (extrait)
présenté et traduit par Marilyne Bertoncini
"Michele Miccia est né en 1959 à Bernalda, en province de Matera. Il vit à Parme depuis plus de 50 ans. Quand, finalement, il est mort, il a commencé à écrire, pour son propre malheur et celui des autres, même si personne ne s’en est aperçu.
Le Cycle de l’eau complet se compose de 9 parties. On ignore si les autres résisteront. Sans parler des centaines d’épigrammes qu’il devra publier en plusieurs volumes, quand il sera mort une seconde fois."

Ce que la biographie, confiée par le poète, ne dit pas, tant il est discret, c’est son parcours dans le monde, ce qui l’a amené à l’écriture. Est-ce parce que Miccia est un philosophe devenu ébéniste qu'il construit une oeuvre poétique comme on fabrique un meuble ? Est-ce, ainsi qu’il le déclare quand on parle avec lui, le désir de « donner un corps » à sa poésie, en lui procurant le cadre scientifique du cycle naturel de l’eau ? Je l'ignore – mais le "Cycle de l'eau" dont nous vous proposons un extrait est bien né tout armé, conçu comme un projet toujours en cours, qui comprendra 9 livres.
Le premier se penche sur le berceau de l'eau, encore fangeuse, prisonnière de la terre germinale, en-deçà de sa conscience d'eau. Au fil des volumes, elle acquiert le sens de son individualité matérielle, puis prend conscience des autres, interagit avec eux, poursuit son parcours et devient l'eau de nos canalisations, témoin de la vie quotidienne, puis fleuve tourné vers la mer (Michele habite dans la Valpadane, où coule le Pô et ses affluents : l’imaginaire de l’eau y a tout son sens), et sa conscience fluide s'élargit au monde… Dans les prochains volumes, en gestation, la vie de l’eau se perdra dans la mer, avant d'accomplir l'acte ultime/premier du cycle, et de s'évaporer.
Cet ensemble a été conçu par Michele Miccia comme "une cage" dit-il, pour donner un corps à ses poèmes. Ce beau corps liquide – dont les premiers livres ont été écrits de façon presque contemporaine, dans une forme contenue en "fragments" au nombre de 66 ou 90 - est soumis à une écriture dont l'apparente simplicité cache une redoutable construction, non dépourvue de la liberté de se créer des exceptions. Le poète s’y fait la voix de l'eau, et son regard (candide?) sur le monde, et ses contemporains : le point de vue scientifique adopté (le poète suit scrupuleusement le devenir de l'eau, et toutes les implications techniques qui sont liées à son emploi, domestique ou industriel, sa pollution, les méandres de son destin), se double ainsi d'une histoire plus personnelle, qui parle de l'humain, de son développement psychologique, du passage de l'inconscient à la conscience, des affects, amour ou haine – mais aussi des aspects plus physiologiques de l'existence - les maladies, le vieillir et diminuer, avant de disparaître …
Quoiqu'il s'en défende – un peu - le poète ouvre aussi au lecteur la porte vers une réflexion plus métaphysique : à travers l'eau, c'est un cycle de renaissances qui se dessine, une démarche vers une spiritualité toute matérielle – l'un des grands paradoxes de ce travail – dans laquelle l'assomption de l'eau vers son destin de nuage et de pluie fait scintiller un espoir de survie, sous d'autres formes – qu'accomplit peut-être cette suite du "Ciclo dell'acqua", écrite dans le sentiment de l'urgence procurée par la claire perception de ce qu'on porte en soi, et qu'on craint de n'avoir le temps de réaliser.
*
Moi aussi j'ai l'eau qui m'arrive à domicile après
qu'elle ait perdu la pudeur
de sa naissance et la prudence
du premier sillon à creuser
dans la terre plus docile,
canalisée sous
les rues elle répudie son charme et les rives qui s'y
mirent, le plaisir de creuser un fond
qui la repose,
chaque eau a un compteur
qui la mesure et porte
le nom de son usager.
Anch’io ho la mia acqua che arriva a domicilio dopo
aver perso il pudore della
nascita e la prudenza
del primo solco da scavare
tra la terra più docile,
incanalata sotto
le strade ripudia la sua avvenenza e le rive che vi si
specchiano dentro, il piacere di scavarsi un fondale
che la riposi,
ogni acqua ha un contatore
che la misura e assume
il nome del suo utente.
*
Maintenant je restaure le moi,
je lève le rideau quand je parle,
face au miroir je suis de nouveau un sujet, une
présence qui fait tendance, biodiverse,
centre et périphérie, toujours connectée, frontière
de moi-même,
je m'explique seule parce que
je suis juste, je m'auto-absous, la première à
tomber malade jusqu'à l'autodestruction en raison
de tant de sa vérité,
je suis tellement immergée dans mon
moi que je ne me semble pas moi.
Adesso ripristino l’io,
alzo il sipario quando parlo,
di fronte allo specchio sono di nuovo un soggetto, una
presenza che fa tendenza, biodiversa,
centro e periferia, sempre connessa, confine di me
stessa,
mi spiego da sola perché
io sono giusta, mi autoassolvo, la prima ad
ammalarsi fino all’autodistruzione per
tanta sua verità,
sono così immersa nel mio
io che non mi sembro io.
*
Je n'use pas la ponctuation
nul ne peut m'arrêter,
je ne veux pas être obscur
parce que je crois seulement
aux choses que je comprends, je ne suis
pas lyrique, ni même expérimental peut-être presque
normal ou bien tout ce que vous voulez
il suffit que je sois dans mon particulier, j'appartiens à la
race
des morts qui m'ont enseigné à voir d'en haut,
c'est la distance qui me reste de la confusion
du nous.
Non uso la punteggiatura
nessuno mi può fermare,
non voglio essere oscuro
perché credo soltanto
alle cose che capisco, non
sono lirico, nemmeno sperimentale forse quasi
normale oppure tutto ciò che vi pare
basta che stia nel mio particolare, appartengo alla
razza
dei morti che mi hanno insegnato a vedere dall’alto,
è la distanza che mi resta dalla confusione
del noi.

les poèmes traduits et présentés ici sont tous
extraits de ce volume.
*
Si je suis concave je n'ai
pas de concavité qui me contienne,
si lumière une ombre me baillonne, je n'ai
nul contraire qui me fasse concurrence
me limite ou m'augmente,
mon nom va pour moi
dans le détroit de son orbite
pour éviter la
fracture pour sortir
des rangs, échapper à l'affrontement.
Se sono concavo non ho
un incavo che mi contenga,
se luce un'ombrami imbavaglia, non ho
un contrario che mi faccia concorrenza
mi limiti o mi aumenti,
il mio nome va per
me nello stretto della sua orbita
ad evitare la
frattura per uscire
dai ranghi, sfuggire allo scontro.
*
J'adviens dans le présent, je n'entends pas ma
voix qui est déjà dans le futur
avec le regret du passé, je sui ici et maintenant et chaque
fait m'arrive délivré de son exotisme, sans
importation et franchissement des frontières ni déplacement de lieu
et d'espace, je ne suis pas épuisé par des marches forcées, par
des cols passés avec quarantaines imposées,
je suis à zéro kilomètre
de moi-même, vierge à jamais.
Avvengo nel tempo presente, non sento la mia
voce che sta già nel futuro
con il rimpianto del passato, sono qui e ora e ogni
fatto viene a me sgravato del suo esotico, senza
importazioni e sconfinamenti né spostamenti di luogo
e di spazio, non vengo sfibrata da marce forzate, da
valichi superati con quarantene imposte,
sono a zero chilometri
da me, per sempre vergine.
*
Je me pare, j'orne mon corps
de diamants que la chair a pêchés dans mon sang
plus vif , ma beauté est profonde
autant que ma peau, plus loin
elle est filtrée comme
une prédisposition au mensonge, je préfère la lumière
des astres qui se perd vers d'autres mondes pour
ne pas s'enamourer de la terre, ainsi chaque autre ciel
accroît l'ambre de mon corps où
mes amants voudraient se cacher.
Mi addobbo, allieto il corpo
con diamanti che la carne ha pescato nel mio sangue
più scaltro, la mia bellezza è profonda
quanto la mia pelle, oltre
viene filtrata come
una predisposizione a mentire, preferisco la luce
degli astri che si perde verso altri mondi per non
invaghirsi della terra, così ogni cielo in più
accresce l’ambra del mio corpo dove
i miei amanti vorrebbero annidarsi.