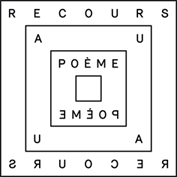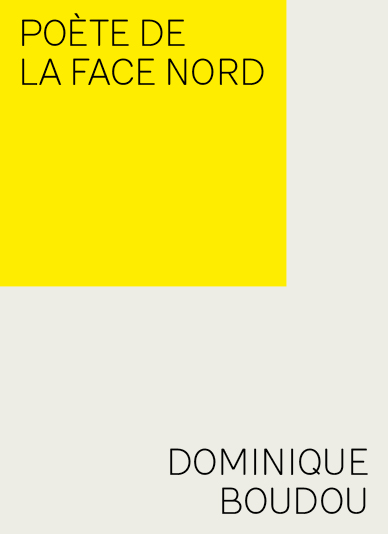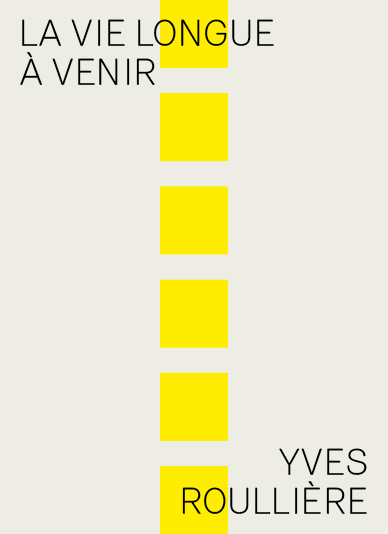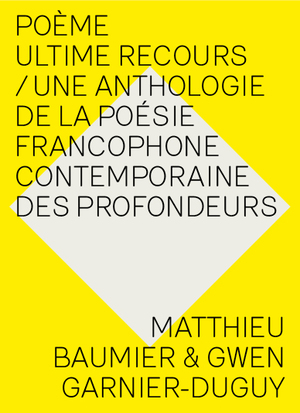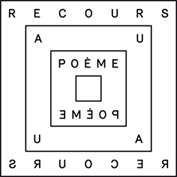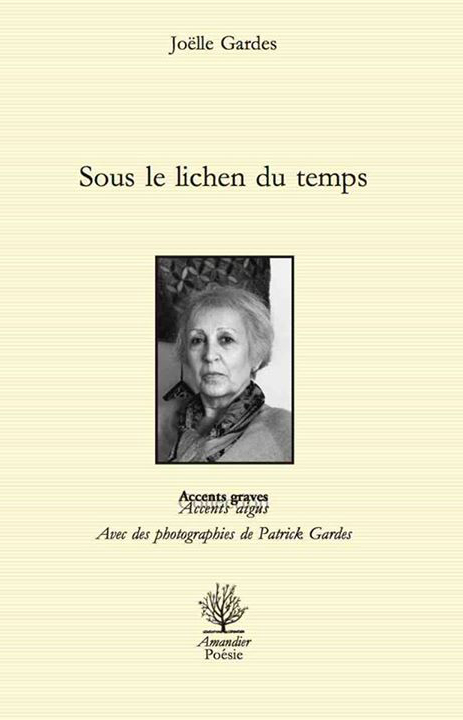Simon Ortiz (Pueblo Acoma),
figure clé de la poésie Native American
Après la renommée acquise de Norman Scott Momaday dans les années 1970, et avant l’ascension de Sherman Alexie dans les années 2000, Simon Ortiz dans les années 1980-2000 fut un des poètes Indiens le plus en vue aux Etats-Unis. Modèle pour certains jeunes auteurs, il est un parfait héritier de ses ancêtres et revendique puiser aux traditions orales de son peuple pour écrire. Il incarne dans sa poésie la manière dont les Indiens d’Amérique du nord considèrent la planète comme un organisme qui nourrit et fait naître toutes les formes vivantes. Ces peuples se sont vus imposés les valeurs de la culture dominante occidentale qui met en avant le dualisme, qui sépare les hommes des femmes, qui plaide la ségrégation blancs/non-blancs … Les Indiens d’Amérique ont subi un génocide, un processus d’acculturation violent. Afin de lutter contre le phénomène « d’invisibilité » comme il l’écrit, Simon Ortiz prend à cœur de présenter les récits et l’histoire depuis les témoignages Indiens, depuis ses valeurs tribales afin de contrer les mensonges et les dénis de la société dominante. L’aspect sociopolitique de son travail ne fait aucun doute. Il écrit :
“And so you tell stories.
You tell stories about your People’s birth and their growing.
You tell stories about your children’s birth and their growing.
You tell stories of their struggles. You tell that kind of history, and you pray and be humble.
With strength, it will continue that way. That is the only way. That is the only way.”
« Alors vous racontez des histoires.
Vous racontez des histoires à propos de la naissance et de la croissance de votre peuple.
Vous racontez des histoires à propos de la naissance et de la croissance de vos enfants.
Des histoires de leurs luttes. Vous racontez ce genre d’histoire, vous priez et êtes humble.
Avec force, c’est comme cela que ça continuera. C’est la seule manière. C’est le seul chemin. »
Champion de la survie, héritier et passeur des traditions de son peuple, Simon Ortiz dans chacun de ses livres est un modèle de fidélité, à sa culture comme à l’innovation. Son travail suit la trame du « storytelling ». C’est-à-dire une trame narrative importante qui se mêle aux mythes et récits de la création tout en dénonçant les injustices environnementales et les scandales tels que la confiscation de territoires Indiens pour ouvrir des mines d’uranium qui polluent la réserve. Sont aussi évoqués et dénoncés le génocide, le racisme, les oppressions sociales et sexistes. Son message est d’encourager les Indiens à prendre en main leurs destinées. Il faut bien reconnaître que les communautés Indiennes ont été les premières à souffrir dangereusement de la perte de l’équilibre de l’écosystème. Les problèmes écologiques causés par la culture Euro-américaine industrielle ont provoqué une crise culturelle dans les communautés Indiennes confinées sur les réserves. Mais au-delà de la terre et des éléments, Simon Ortiz veut attirer l’attention sur le formidable processus de survie et de maintien des cultures Indiennes, processus qui allié à la poésie, peut faire prendre conscience aux lecteurs de la relation de partage à ressentir, à vivre avec chaque chose et avec tout. Cette dimension de partage est fondamentale, elle est au cœur de la survie même. La relation au tout est fondamentale pour que l’homme sache sa possibilité de participation dans l’univers, sache et sa place, et sa mesure.
Simon Ortiz est Pueblo Acoma, il est né en mai 1941 à Albuquerque dans l’état du Nouveau-Mexique de parents dits de « sang pur » qui tous deux appartenaient au clan de l’aigle et qui avaient à cœur de transmettre les valeurs et la culture de leurs ancêtres. Comme de nombreux enfants Indiens de cette époque, le jeune Simon, après l’école primaire, fut envoyé dans un pensionnat pour Indiens dont la mission était d’assimiler et de faire en sorte que ces jeunes Indiens oublient, méprisent leurs origines et adoptent les valeurs occidentales. Il avoue avoir été très troublé par ces années au pensionnat et avoir trouvé refuge dans les livres. C’est dans cet univers qu’il commença à se confier par écrit, à mettre noir sur blanc des histoires, bien que ne considérant pas encore l’écriture comme une chose sérieuse. Souffrant de sa situation de pensionnaire, Simon Ortiz se fit transférer dans un autre établissement pour acquérir une formation manuelle et de commerce. Il entra dans la vie active en se faisant employer dans une usine nucléaire appartenant à la tristement célèbre firme Kerr-McGee (qui intenta mais perdit, après 8 ans de bataille juridique, son procès contre la réserve Navajo, en 1985). Il économisa de l’argent puis entra à l’université pour étudier la chimie. Après sa licence il s’engagea dans l’armée (alors mobilisée au Vietnam) pour une période de trois ans et en 1966 il réintégra l’université. C’est alors, au sein de l’université du nouveau Mexique qu’il prit conscience de l’émergence d’une littérature « Native American ». Il décida alors de se consacrer à l’écriture et gagna l’université de l’Iowa célèbre pour ses programmes d’écriture créative. C’est en 1969 que sa carrière de poète fut officiellement lancée. Il se joignit alors aux nouvelles voix qui signeront la « renaissance » Indienne. Actif, il réussit à montrer combien cette énergie puisée au cœur des cultures indiennes pouvait révolutionner la littérature, et comment les auteurs Indiens pouvaient se montrer pionniers en matière d’écriture poétique. Pour pleinement comprendre ce dont parle Simon Ortiz, il faut s’imaginer les villages Acoma Pueblo. Ils sont construits au sommet d’une mesa, forme de plateau juchée de falaises sur chaque côté … le village flotte en quelque sorte et est longtemps resté accessible uniquement par des escaliers taillés dans la falaise. Cette communauté Indienne a, pendant des siècles, continuellement habité ce lieu (au contraire d’autres tribus occupant selon leurs mouvements migratoires, divers territoires du continent nord-Américain). Le langage parlé est le Keres, que maîtrise Simon Ortiz. Ces villageois à l’origine, cultivaient la terre, faisaient du commerce avec les Aztèques et les Mayas, puis avec les peuples d’Amérique du nord quand les conquistadors envahirent le sud. Le catholicisme fut « intégré » aux pratiques religieuses locales, pour d’une part donner le change aux autorités colonisatrices, mais aussi parce que cette religion venue de l’Europe était considérée comme déjà inclue dans les principes plus vastes des religions Indiennes. Et les missionnaires fort adroitement instituaient des jours de fêtes qui coïncidaient avec des fêtes Pueblos pendant lesquelles des banquets étaient tenus.
L’un des poèmes connus de Simon Ortiz, intitulé Making Quiltwork, met en scène comment l’activité de récupération des tissus, puis de couture, évite aux habits et étoffes usagées de se retrouver intégralement à la poubelle. Ortiz établit ainsi une analogie avec les vies humaines qui elles aussi peuvent être rassemblées en une couverture d’existence humaine. Les couvertures sont les métaphores des vies Indiennes. Il dit : “Folks here live by the pretty quilts they make, more than make actually, more than pretty.” Les gens vivent auprès des jolies couvertures qu’ils fabriquent, plus que fabriquées en fait, plus que jolies.” L’idée étant que chaque jour est ajouté un morceau, un carré au patchwork de leur existence. Et l’image s’étend ensuite quand Ortiz explique ce que les couvertures sont pour les cultures Indiennes : “Indian people who have been scattered, sundered into odds and bits, determined to remake whole cloth.” « Les peuples Indiens qui ont été éparpillés, décimés et disséminés en des endroits improbables, sont déterminés à refaire l’habit tout entier. » Malgré les temps amers et difficiles les populations Indiennes redressent la tête, ne sont plus victimes, veulent reconstruire ce qu’elles avaient perdu et cherchent à préserver leurs cultures. Ortiz montre toute la force et l’optimisme des Indiens qui malgré les épreuves subies dans le passé, conservent une force de survie telle, que pour finir ils triompheront des tragédies, ce qui se fera par l’intermédiaire de l’art car ces peuples ont une tradition inégalée de créativité exercée au quotidien. A la fin du poème le narrateur demande au lecteur de regarder ces habits multicolores, ce qui est une façon d’attirer l’attention sur la beauté des différentes cultures Indiennes dont l’auteur est un membre actif, participant à la fabrication de cette grande couverture humaine.
Un autre poème est construit comme un entretien entre l’auteur lui-même et une femme dont on ne sait pas le nom. Le poème souligne la force des stéréotypes qui continuent d’être véhiculés à propos des Indiens d’Amérique. Le poème s’intitule A New Story (une nouvelle histoire).
A New Story
Several years ago,
I was a patient at the VA hospital
in Ft, Lyons, Colorado.
I got a message to call this woman,
so I called her up.
She said to me,
"I'm looking for an Indian.
Are you an Indian?"
"Yes," I said.
"Oh good," she said,
"I'll explain why I'm looking
for an Indian."
And she explained.
"Every year, we put on a parade
in town, a Frontier Day Parade.
It's exciting and important,
and we have a lot of participation."
"Yes," I said.
"Well," she said, "Our theme
is Frontier,
and we try to do it well.
In the past, we used to make up
paper mache
Indians, but that was years ago."
"Yes," I said.
"And then more recently,
we had some people
who dressed up as Indians
to make it more authentic,
you understand, real people."
"Yes," I said.
"Well," she said,
"that didn't seem right,
but we had a problem.
There was a lack of Indians."
"Yes," I said.
"This year, we wanted to do it right.
We have looked hard and high
for Indians but there didn't seem
to be any in this part of Colorado."
"Yes," I said.
"We want to make it real, you understand,
put a real Indian on a float,
not just a paper mache dummy
or an Anglo dressed as an Indian
but a real Indian with feathers and paint.
Maybe even a medicine man."
"Yes," I said.
"And then we learned the VA hospital
had an Indian here.
We were so happy,"
she said, happily.
"Yes," I said.
"there are several of us here."
"Oh good," she said.
Well, last Spring
I got another message
at the college where I worked.
I called the woman.
She was so happy
that I returned her call.
Then she explained
that Sir Francis Drake,
the English pirate
(she didn't say that, I did)
was going to land on the coast
of California in June, again.
And then she said
she was looking for Indians . . .
"No," I said.
Il y a quelques années
j’étais soigné à l’hôpital pour les vétérans de l’armée
à Ft, Lyons, Colorado.
J’ai reçu un message me disant d’appeler cette femme,
Ce que j’ai fait.
Elle me dit :
« Je cherche un Indien.
Etes-vous Indien ? »
“Oui” répondis-je.
« Oh très bien” dit-elle,
« je vous explique pourquoi je cherche
un Indien. »
Et elle expliqua.
« Chaque année, nous faisons défiler la parade
en ville, la parade du jour de la frontière.
C’est passionnant et c’est important,
cela demande une grosse part de participation. »
« Oui » dis-je.
« Voilà, » dit-elle, « notre thème
est la frontière,
et nous essayons de faire ça bien.
Dans le passé, nous fabriquions
des Indiens de papier-mâché,
mais il y a des années de cela. »
« Oui » dis-je.
« Et plus récemment,
nous avions des gens
habillés comme des Indiens
pour faire plus authentique,
vous voyez, des vraies personnes. »
« Oui » dis-je.
“Bon” dit-elle,
“cela ne semblait pas correct,
mais nous avions un problème :
Nous manquions d’Indiens. »
« Oui » dis-je.
« Cette année nous voulions faire bien les choses.
Nous avons cherché de fond en comble
mais il ne semble pas y avoir d’Indiens
dans le Colorado. »
« Oui » dis-je.
“Nous voulons que ce soit réel, vous comprenez,
nous voulons mettre un vrai Indien sur le char,
pas un mannequin de papier mâché
ou un blanc déguisé en Indien,
mais un Indien réel avec des plumes et des peintures.
Peut-être même un homme-médecine. »
« Oui » dis-je.
« Ensuite nous avons appris qu’à l’hôpital des vétérans
se trouvait un Indien.
Nous en étions heureux, »
dit-elle d’un ton réjoui.
« Oui » dis-je,
« nous sommes plusieurs ici. »
« Oh parfait, » dit-elle.
Bien, le printemps dernier
J’ai reçu un autre message
à l’université où j’enseignais.
J’appelais donc la femme.
Elle était si heureuse
que je donne suite à son appel.
Alors elle expliqua
que Sir Francis Drake,
le pirate Anglais
(elle ne le précisa pas, c’est moi qui le fit)
allait de nouveau débarquer sur la côte
Californienne en juin.
Puis elle dit
qu’elle cherchait des Indiens …
“Non”, dis-je.
Le poème souligne l’ignorance qu’ont les Anglo-américains de la diversité des différentes cultures, des différents peuples Indiens. Dans l’inconscient collectif seuls les Indiens des Plaines existent et représentent le tout des populations indigènes. Le manque d’Indien évoqué est le résultat du génocide et des traitements atroces subis par les Indiens au long de l’histoire de la colonisation.
Quant au pirate Francis Drake, il est resté célèbre pour avoir « exploré » l’Amérique après avoir fait un tour du monde. Il fut accueilli par des tribus locales qui le nourrirent et lui fournirent les stocks nécessaires pour continuer son périple. Il a été rapporté que ces Indiens le considéraient comme une divinité, qu’ils l’avaient même couronné, qu’ils lui vouaient une forme de culte puisque ces gens n’avaient jamais vu d’Européens auparavant. C’était donc insultant de demander à des Indiens contemporains de répéter cet épisode où ils se seraient trouvés en position humiliante, en train de vouer un culte à un Européen. Bien entendu Simon Ortiz refusa de cautionner et de participer à un tel mémorial. Il répond non, et c’est le premier non après une série de oui répliqués à la femme. Il est symbolique et marque l’attitude que les Indiens désormais adoptent, ils veulent garder leur dignité et ne se soumettront plus aux mascarades et fantaisies qui salissent leur image, qui dénient l’histoire dramatique qu’ont vécue leurs ancêtres, (comme par exemple l’avait fait le Wild West Show de Buffalo Bill.)
Simon Ortiz exprime souvent le mouvement de conscience et la vie humaine comme un voyage. Le langage serait "un mode de vie qui est chemin, un sentier, une piste que je suis pour rester conscient autant que possible de ce qui m’entoure et de la part que je suis et assume dans la vie". Le langage et donc l’écriture inscrivent un passage de connaissance et de connaissance de soi. Il permet à quelqu’un de trouver une route à suivre depuis l’individuel et l’intérieur vers l’extérieur et vice et versa. Deux exemples ci-dessous :
Blind Curse
You could drive blind
for those two seconds
and they would be forever.
I think that as a diesel truck
passes us eight miles east of Mission.
Churning through the storm, heedless
of the hill sliding away.
There isn’t much use to curse but I do.
Words fly away, tumbling invisibly
toward the unseen point where
the prairie and sky meet.
The road is like that in those seconds,
nothing but the blind white side
of creation.
You’re there somewhere,
a tiny struggling cell.
You just might be significant
but you might not be anything.
Forever is a space of split time
from which to recover after the mass passes.
My curse flies out there somewhere,
and then I send my prayer into the wake
of the diesel truck headed for Sioux Falls
one hundred and eighty miles through the storm.
Juron aveugle
Vous pourriez conduire aveuglé
pendant ces deux secondes
et elles seraient éternelles.
Je pense cela pendant qu’un camion diesel
nous double douze kilomètres à l’est de Mission.
Ballotté par la tempête, inconscient
du glissement de la colline.
Il n’y a pas grande utilité à jurer mais je le fais.
Les paroles volent au loin, trébuchant
invisibles en direction du point occulte où
prairie et ciel se rencontrent.
La route ressemble à ça pendant ces secondes,
rien d’autre que le côté blanc aveugle
de la création.
Vous êtes là, quelque part,
une minuscule cellule qui lutte.
Vous pourriez être seulement significatif
mais vous ne pourriez pas être n’importe quoi.
Toujours est un est espace de temps éclaté
à partir duquel récupérer après que la masse soit passée.
Mon juron s’envole là-bas quelque part,
et puis j’envoie ma prière dans le sillage
du camion diesel se dirigeant vers Sioux Falls
deux cent quatre-vingt-dix kilomètres dans la tempête.
Culture and the Universe
Two nights ago
in the canyon darkness,
only the half-moon and stars,
only mere men.
Prayer, faith, love,
existence.
We are measured
by vastness beyond ourselves.
Dark is light.
Stone is rising.
I don’t know
if humankind understands
culture: the act
of being human
is not easy knowledge.
With painted wooden sticks
and feathers, we journey
into the canyon toward stone,
a massive presence
in midwinter.
We stop.
Lean into me.
The universe
sings in quiet meditation.
We are wordless:
I am in you.
Without knowing why
culture needs our knowledge,
we are one self in the canyon.
And the stone wall
I lean upon spins me
wordless and silent
to the reach of stars
and to the heavens within.
It’s not humankind after all
nor is it culture
that limits us.
It is the vastness
we do not enter.
It is the stars
we do not let own us.
Culture et l’univers
Il y a deux nuits
dans l’obscurité du canyon,
seulement une demi-lune et des étoiles,
simplement des hommes.
Prière, foi, amour,
existence.
Nous sommes mesurés
à l’aune de la vastitude au-delà de nous.
Le noir est la lumière.
La pierre s’élève.
Je ne sais pas
si le genre humain comprend
la culture : l’acte
d’être humain
n’est pas un savoir aisé.
A l’aide de bâtons peints
et de plumes, nous voyageons
dans le canyon vers la pierre,
une présence massive
au milieu de l’hiver.
Nous nous arrêtons.
Penche toi sur moi.
chante l’univers
paisiblement dans sa méditation.
Nous restons muets :
Je suis en vous.
Sans savoir pourquoi
la culture a besoin de notre connaissance,
nous faisons un dans le canyon.
Et la paroi rocheuse
sur laquelle je me tiens me fait tournoyer
silencieux et muet
pour atteindre les étoiles
et les cieux qui vont avec.
Ce n’est pas le genre humain après tout
pas plus que la culture
qui nous limitent.
C’est la vastitude
que nous ne pénétrons pas.
Ces sont les étoiles
que nous ne laissons pas nous posséder.
Sources: After and Before the Lightning (University of Arizona Press, 1994) et Out There Somewhere (University of Arizona Press, 2002)
En guise de conclusion dire qu’en 1981, From Sand Creek: Rising In This Heart Which Is Our America, est un recueil remarqué qui reçut le prix pushcart de poésie ; il narrait le massacre des Cheyennes et Arapahos perpétré à Sand Creek le 29 novembre 1864. Mais les poèmes de Simon Ortiz ne sont pas uniquement centrés sur les traumatismes subis par les peuples Indiens non plus que sur la culture Acoma Pueblo, ils parlent avant tout de la condition humaine, ils observent, décrivent et nous instruisent en nous donnant la preuve que chaque vie peut être une œuvre d’art. Simon Ortiz ne se complait pas dans la narration des atrocités commises, il regarde lucidement l’histoire et nous éclaire en nous montrant que les Euro-Américains furent eux aussi les victimes de la colonisation : victimes de leurs propres ambitions, victimes de leurs aveuglements, leur ignorance, leurs conditionnements. Et si les « blancs » reconnaissaient cela, ce serait peut-être le premier pas vers la guérison, le premier pas vers l’apaisement des traumatismes car cela offrirait une base commune, à savoir une juste appréciation des responsabilités à partager désormais pour le futur de l’humanité et de la planète. Ce que nous montre Simon Ortiz, c’est la force de la culture des Indiens d’Amérique du nord qui demande à l’humain d’aimer, de respecter, d’être responsable de soi mais aussi des autres afin d’être transmise et de permettre non seulement la survie mais une vie en harmonie. Sa poésie témoigne de cette ambition et au-delà, le message qu’il fait passer dans ses poèmes est que l’état Américain, s’il veut lui aussi survivre, doit reconnaître la réalité des Indiens, la réalité de l’histoire de ce continent Indien. Le rôle des auteurs Indiens serait donc d’aider l’Amérique à aller au-delà des stéréotypes et des manipulations enregistrées par les politiques, par les écrits occidentaux et Euro-Américains, afin que la survie de la planète soit envisageable. C’est en passant par la reconnaissance des effets néfastes et destructeurs de l’exploitation coloniale et particulièrement sur les populations et cultures Indiennes, c’est en luttant contre cette mentalité de prédateur, que les Etats-Unis pourront construire une société plus juste et un environnement sain.
Pour aller plus loin : Vent sacré. Une anthologie de la poésie féminine amérindienne publiée il y a peu sous la direction de Béatrice Machet.