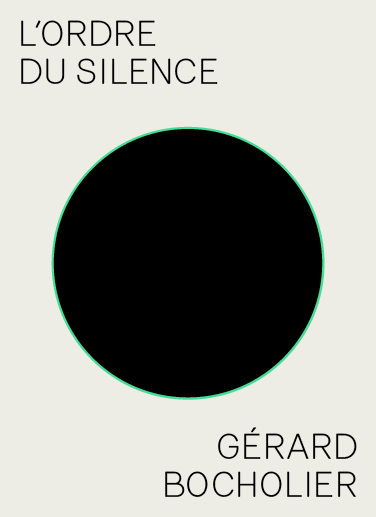LES TROIS REFUGES DE PABLO
Pablo Neruda avait trois maisons ; il les créa comme des poèmes, trois étonnants chefs d'œuvre que la dictature saccagea. Pinochet voulut rayer le poète mais c'est le nom du général qui fait grimacer l'histoire du Chili. Pablo s'appelait Neftali, il avait gardé dans les traits traces d'ancêtres araucans, la rage – non l'arrogance – envers toutes les cruautés, les injustices, les aliénations, il portait en lui abondance de mots, d'amour et de vie.
C'est une côte déchiquetée aux vagues puissantes que dominent des pins et des villas de rêve. Isla Negra, Île Noire, saura-t-on jamais pourquoi? Juste deux vers:
« Dans la noire, la noire solitude des îles,
c'est là, femme d'amour, que tes bras m'accueillirent. »
De ses trois maisons elle était sa préférée, elle était son « bateau ancré sur terre ». En attendant l'heure de la visite, vous pouvez vous attarder au « Coin du Poète », en sa présence, il est partout sur les murs, en casquette, devant la mer où les mêmes cormorans pêchent en piqué. Sur chaque table, un petit bouquet de statices bleus, de fines immortelles blanches et marguerites rouges, les couleurs du Chili dont il fut le consul, l'ambassadeur, le représentant partout dans le monde. Vous relisez son ode au vin sur le mur, « vin fils de la terre », vino hijo de la tierra et vous trinquez à la mémoire du poète mort de douleur.
C'est une maison où l'on embarque.
C'était un terrain accidenté, avec un abri de pêcheur en ruines qui peu à peu se releva, grandit, s'allongea, serpenta sur les conseils d'amis architectes et ce ne fut pas facile d'amener là les matériaux. Ces ajouts successifs en font une maison unique, une enfilade de petites habitations séparées par des escaliers minuscules, des sentiers, les pièces sont petites mais les vitres immenses. C'est une maison d'artiste, de granit, bois et verre, une forme de recueil où il rassembla des objets hétéroclites offerts ou ramenés de voyages.
Isla Negra ou l'art de redresser une ruine, de la retaper par étapes pour y faire vivre ses trésors. Il collectionnait les coquillages, les dents de cachalot, les morceaux de bois déposés par les vagues, il écrivait sur un présent de l'océan, une planche où trône Baudelaire. Il accumulait des flacons étranges et colorés, des lampes, des statuettes, des masques, des pipes, des bateaux en bouteille et d'imposantes figures de proue. Une pièce héberge un cheval grandeur nature, harnaché comme dans l'enfance, et il a choisi des toits de zinc pour entendre, comme dans l'enfance, les contes de la pluie. Il le disait lui-même, c'est un capharnaüm, « J'ai construit une maison comme un divertissement et je joue dedans du matin au soir »
Devant la maison, un bateau face au large. Pablo se sentait l'âme d'un capitaine et son premier livre il le publia anonymement sous le titre significatif : Les Vers du capitaine, Los Versos del capitán. Derrière, une locomotive lui rappelait son père, constructeur de voies ferrées, ces voies qui, pour la première fois, relièrent entre elles les villes du Nord au Sud de ce si long pays. À l'entrée, son emblème, le symbole nerudien, un poisson entre deux cercles de fer, deux armilles d'une sphère où le poisson remplace la terre, avec les lettres majuscules de son nom d'adoption comme d'improbables points cardinaux. Un poisson aux gros yeux d'océan posé sur une enclume. Emblème que nous retrouvons, jouet des vents, sur le toit.
Neruda souffrait d'un cancer, mais d'abord du cancer de l'injustice envers l'Homme poursuivi, exploité, nié. Le 11 septembre 1973 le submergea de désespoir et de rage rentrée. Il dut quitter Isla Negra, sous les injures des militaires, pour sa maison de Santiago où il mourut douze jours plus tard. Pablo Neruda est mort de douleur et les militaires confisquèrent Isla Negra. Ce n'est qu'en 1992 qu'il fut enterré là, selon ses souhaits, face au Pacifique. Il y eut les amours et il y eut l'amour ; Matilde l'a rejoint dans cette tombe simple, fleurie de fleurs sauvages. Les passants lisent leurs noms gravés, en silence sourient, saluent le poète qui « navigua en paroles». Pour Matilde il écrivit : Yo quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos, je veux réussir avec toi ce que le printemps réussit avec les cerisiers.
La nuit, dans les quarante-quatre collines, les chiens aboient, se répondent. Si vous leur parlez ils vous suivent, vous escortent quelques rues. Ils n'ont pas l'air en mauvaise santé mais sont nombreux à conserver une certaine liberté, à garder une notion d'errance collée aux pattes.
En 1959, las de Santiago qui l'agitait, le dispersait, Pablo se mit à rêver d'une maison à Valparaiso. Des amis furent chargés de lui en trouver une dans un quartier tranquille mais pas trop, indépendante mais pas isolée, avec des voisins invisibles si possible, ni grande ni petite et pas chère.
Fut dénichée, dans une colline, une maison pleine d'escaliers, à plusieurs étages, construite par un Espagnol prénommé Sebastián, inachevée et abandonnée depuis la mort du propriétaire, dix ans auparavant. Son extravagance plut au poète mais, trop grande, il n'acheta que la moitié. Un couple, dont la femme était sculptrice, opta pour le rez-de-chaussée, le patio et deux étages. Neruda garda les deux derniers, plus une sorte de tour avec terrasse et baptisa La Sebastiana cette maison excentrique qui le rapprochait des étoiles. Il était dans la lumière, il dominait toute la baie et même une terrasse où une femme, que jamais personne ne vit, prenait souvent le soleil, nue.
La Sebastiana est un autre capharnaüm où l'on retrouve l'inclination du poète pour les collections hétéroclites : vieilles photos du port, portulans et marines, flacons, bouteilles et verres de toutes les couleurs ; il était persuadé depuis l'enfance que la couleur donnait à l'eau meilleur goût. Sont là aussi, bien sages, les boîtes à musique et un cheval de manège pour dorloter ses souvenirs. Le bar occupe une place conséquente, il aimait concocter des cocktails et préparer le punch dans une vache fleurie en céramique. Gêne devant le lit des amours, ne pas regarder par le trou des serrures, préférer l'opacité de l'intimité. Préférer l'intense et paisible portrait de Walt Whitman, ce barbu chevelu dont Neruda appréciait la liberté sensuelle. À un ouvrier qui, au cours d'une restauration lui demanda si c'était son père, il répondit : « Oui, en poésie ». Son bureau, tout là-haut, inspire rien qu'en y pénétrant. Vous regardez, vous plongez, l'univers vous appartient, tout est dit, reste à l'écrire. Poète capitaine, homme de veille, vigie. Dans le port de Valparaiso, chaque 31 décembre a lieu un gigantesque feu d'artifice. Il y assista pendant douze ans. Il était là le 31 décembre 1972, là il vit jaillir l'année 73, l'année du 11 septembre, 11, le nombre des mauvais anges dit-on. La Sebastiana fut dévastée par les militaires.
En rentrant, sur une autre colline, à un autre balcon du rêve, un vieil homme dévore la nuit ; à ses pieds, un chat blanc a pris racine, oui, Pablo, « dans la nuit de l'univers ». Une lumière cruelle tombe d'un réverbère, rase nos rides et remet à sa place le passé....
1973, tôt le matin, le journal était glissé sous la porte et je vis son visage. Le poète Neruda venait de mourir, anéanti par l'humiliation et le désespoir. Fidèle à lui-même, à son besoin infini de repenser la vie, il avait survécu douze jours à la violence extrême qui ne faisait que commencer....
Matilde avait une abondante chevelure embroussaillée le matin et Pablo l'appelait affectueusement La Chascona, celle qui a les cheveux emmêlés, en bataille.
En 1953, dans le quartier agréable de Bellavista à Santiago, ils découvrent un terrain à vendre, en pente, avec des ronces et une source. Ils firent construire là leur première résidence et il l'appela La Chascona. Ce ne fut pas simple pour l'architecte : la colline regarde la ville et Neruda voulait voir les Andes. Comme dans ses deux autres demeures, entre ce qu'il souhaitait et ce qu'il ne voulait pas, il fallut additionner trois maisons qui se raccrochent et s'accrochent à la colline.
Dans cette maison-musée au jardin touffu, l'intimité est palpable. Vous retrouvez Pablo le collectionneur, objets d'art ou bâtons de marche, et les trois portraits de ses trois poètes inspirateurs, Baudelaire, Rimbaud et Whitman. Il écrivit ici l'essentiel de son œuvre. Dans la partie la plus haute, ouverte sur les Andes régnait la bibliothèque aux neuf mille volumes dont sept mille furent brûlés par les vandales imbéciles de la dictature dès l'annonce de sa mort. Matilde s'est battue ensuite pour faire renaître La Chascona mise à sac. C'est émouvant, c'est dérangeant, ces petits groupes qui attendent leur tour, non sans respect, non sans permettre que tout perdure puisque l'entrée est payante, mais je ne serai nulle part à l'aise en intruse curieuse ; surtout pas dans une chambre, fût-elle celle de l'amour.
Dans la rue qui grimpe jusqu'à l'entrée, sur des plaques de cuivre, toutes hélas rayées et oxydées, sont gravées quelques vers :
Je ne me suis jamais senti aussi sonore Nunca me sentí tan sonoro
Je n'ai jamais reçu autant de baisers. Nunca he tenido tantos besos.
Laissez-moi seul avec le jour Déjenme solo con el día
Je demande la permission de naître. Pido permiso para nacer.
La Chascona est toute de bleu et blanc, le bleu Pacifique du capitaine sur terre qui aima les proues, les promontoires, et le blanc des Andes neigeuses au loin depuis l'enfance.
C'est un quartier bohème. Les rues ne sont que bars, galeries d'art, musiciens, comédiens, hippies à colliers et bracelets, tout se mêle, tout le monde parle à tout le monde, on vous offre une bière, on vous baise la main, on repeint la planète, on ne repeint pas ses souvenirs mais on les tient en laisse....
extraits inédits de Ma Boussole chilienne, 2013.







.jpg)