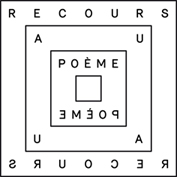Fence Posts
The ribbon of black snake (maybe 60 centimetres long) threads itself round some dry clumps of grass, moving across a rock, its head held high, jiggling around as if it’s in a cartoon. It’s young. It’s been hatched only a few days. It’s the puppy dog of snakes. I saw it from the kitchen window this morning and went out to watch as it moved through the centre of a grevillea and then, surprised by us, it turned back disappearing up the bank. It goes so fast it looks like the end of a piece of rope quickly pulled away. It moves faster than someone could run, panicked, trying to get distant from the house. Not a tree-snake, yet this little red-bellied black arches over the grevillea’s twigs like a miniature roller-coaster, dipping and climbing. How it did so momentarily took our breath away. I say “us” because you’d come down to see it, too. I’d thought (remembering a biblical curse, something about dust and heels) they mostly had to stick along the ground:
the snake
like a train in the mountains
in the shrub
why tell it?
why call to you
about its apparition?
why speak its
--
A rare kind of pleasure is the pleasure of realising that you’ve got over a shock. It’s similar to, in some ways more than, the sense of recovery from serious illness, though that too (like the end of shock) is a feeling that the horizon broadens like mist clearing from a tree-covered hillside and of increasing immersion, day after day, in lightness. in easy movement and pleasure. As if some new bright fluid inhabits the air, as if sharpness returns in things. I remember looking out once through a fifth floor hospital window at the darkness of the street’s plane-trees down through a wet winter dusk in Sydney and thinking that I’d never seen anything as darkly sad as that, as gloomy and depressed as the waves of darkness in their branches and the blocked miserableness of the stone wall behind them. I knew, at the same time, that these bleak feelings were also an effect of the slowness of recovery. The very fact I could measure my response to the trees was a sign, in other words, that things were turning for the better. The darkness, the empty wet night, the scatter of golden leaves on the pavement, the unusual “inner city” concentration of plane-trees and high sandstone wall: these all acted as a net in which I caught the effects of my still very shallow energy, the unbearable muscular weakness I felt, the numbing effects of drugs and painkillers. Even so I remember realising half-consciously (“somewhere,” so to speak, in a half-worked out way) that for any human being to have died in that state of mind would have required that he or she acknowledge so much unaccounted for unhappiness that the sick person would do anything to keep alive, to move through. To sort out unhappiness. The legacy of sadness (strange, weak, powerful word) is too difficult for others to cope with, for friends and family. I kept having that involuntary thought, again and again. Perhaps it was a realisation, and a fear: how would it feel to think you would never rejoin the daylight
Each poem’s an event, moment by moment. That’s why it’s ultimately pointless to compare poetry with music. Poetry has its own event-structure and, despite the poets’ arguments, music is a precise language, precise in ways in which vocal language is not. Of course I’m muttering this because it’s obvious and there’s no point in keeping these old arguments alive. But a poet and a philosophy teacher I had lunch with yesterday after driving into town went on about it together and I didn’t say what I wanted to - namely, I don’t want all pleasures collapsed into one. I like the way colour, tone, reference can be picked out, chosen again, changed, placed here and there, in a piece of music: with precision and meaning way beyond words. How blackness of trees and snakes lightens into light on water, into light in dark. And no, those words aren’t literal. And yes, that doesn’t mean that things don’t exist or that we anti-literalists don’t care for things, for objects, for natural worlds. Have either of them ever played a note? I suppose not. It’s part and parcel of the struggle with the shape of a future poem where even transparency’s a wall. And it’s why, walking back along the dirt road to the house, I was thinking about the transformation of places in memory, how objects are under attack. The mind dissolves and loses them. You can climb right through at any place. More than just tracing the immediacy of sense in a phrase like “the lightness of dust and a storm’s passing rain,” some deep structure has to come forward in case we lose the object. It could just be a shimmer, a mark. A silver shimmer, for instance, on old wood. Or dry cropped grass, stained with green after rains have come at last. Or the array of boundaries. Their rusted, taut wires. Or the rough-cut humaneness of those fence posts
Poteaux de Clôture
Le ruban de serpent noir (peut-être long de 60 cm ) passait tel un fil autour de quelques touffes d'herbe sèche, traversant un rocher, la tête haute, se trémoussant comme dans un dessin animé. Il est jeune. Eclos depuis peu de jurs. C'est le bébé chiot des serpents. Je l'ai vu de la fenêtre de la cuisine ce matin et je suis sorti pour le regarder tandis qu'il bougeait au coeur d'un grevillea et soudain, surpris par nous, il a disparu en remontant la pente. Il va si vite qu'il semble l'extrémité d'une corde brusquement tirée. Il bouge plus vite qu'on ne pourrait courir, paniqué, e, ssaya,t de s'éloigner de la maison. Pas un serpent arboricole, même si cette petite couleuvre à ventre rouge se cambre ur les branches du grevillea comme un grand huit minuscule, plongeant et grimpant. Comme il nous a coupé le souffle brusquement. Je dis “nous” parce que tu es descendu pour le voir, toi aussi. J'avais pensé (souvenir d'une malédiction biblique, quelque chose à propos de poussière et d'anguilles) qu'il devait en général ramper au sol :
le serpent
comme un train dans les montagnes
dans le buisson
pourquoi le dire?
Pourquoi en appeler à toi
à propos de son apparition?
Pourquoi dire son
...
C'est une espèce de plaisir rare que de réaliser que vous avez surmonté un choc. Cela ressemble, et même parfois plus, à la sensation de guérison d'une grave maladie, bien que ce soit également (comme la fin du choc) le sentiment que l'horizon s'élargit comme la brume quitte une colline boisée, tandis qu'on plonge de plus en plus, jour après jour, dans la légéreté, les mouvements faciles et le plaisir. Comme si quelque fluide neuf et brillant habitait l'air, comme si l'acuité revenait aux choses. Je me souviens avoir regardé une fois, d'une fenêtre au cinquième étage de l'hôpital, l'obscurité des platanes de la rue à travers le crépuscule d'un hiver humide à Sidney et d'avoir pensé que je n'avais jamais rien vu de plus sombrement triste que ça, aussi lugubre et déprimé que les vagues d'obscurité dans leurs branches et la muraille misérable de pierres derrière eux. Je savais, en même temps, que ces sentiments désolés étaient aussi une conséquence de la lente guérison. Le fait même que je puisse mesurer ma réponse aux arbres était un signe, en d'autre termes, que les choses s'amélioraient. L'obscurité, le vide humide de la nuit, l'or des feuilles éparses sur le sol, l'inhabituelle concentration “en centre ville” de platanes et de hauts murs de pierre : tout ceci fonctionnait comme un filet dans lequel je capturais les retombées de mon énergie encore bien fragile, l'insupportable faiblesse musculaire que je ressentais, l'engourdissement dû aux médicaments et aux antidouleurs. Même ainsi je me souviens d'avoir réalisé à demi-consciemment (“quelque part”, pour ainsi dire, d'une façon à demi- exprimée) que pour tout être humain, mourir dans cet état d'esprit
aurait exigé qu'il ou elle reconnaisse une telle part d'inexpliqué à son chagrin que la personne malade aurait fait n'importe quoi pour rester vivante, s'en sortir. Eliminer le chagrin. L'héritage de la tristesse(étrange mot, faible, puissant) est trop dur à assumer pour les autres, les amis, la famille. Je ne cessais d'avoir cette pensée involontaire, encore et encore. C'était peut-être une prise de conscience, et une peur : qu'éprouverait-on à penser qu'on ne rejoindrait jamais le jour
Chaque poème est un évènement, à chaque instant. C'est pourquoi il est finalement tellement inutile de comparer poésie et musique. La poésie a sa propre structure événementielle et, malgré les arguments du poète, la musique est un langage précis, précis dans des cas pour lesquels le langage vocal ne l'est pas. Bien sûr, je bredouille ceci parce qu'il c'est évident et qu'il n'y a nulle raison de continuer à faire vivre ces vieux débats. Mais un poète et professeur de philosophie avec qui je déjeunais hier après avoir traversé la ville en voiture le reprit, et je n'ai pas dit ce que je voulais – c'est à dire, je ne veux pas que tous les plaisirs s'effacent en un sul. J'aime la façon dont les couleurs, les tonalités, les références peuvent être cueillies, choisies de nouveau, changées, placées ici et là, dans un morceau de musique : avec une précision et un sens bien au-delà des mots. Comme la noirceur des arbres et des serpents s'éclairent en lumière sur l'eau, en lumière dans l'obscurité. Et non, ces mots n'ont pas un sens littéral. Et oui, ceci ne signifie pas que les choses n'existent pas ou que nous, anti-littéralistes, ne soyions pas attentifs aux choses. Est-ce que l'un d'entre eux a jamais joué une note? Je suppose que non. Cela fait partie de la lutte avec la forme d'un futur poème, où même la transparence est un mur. Et c'est pourquoi, remontant le chemin de terre vers la maison, je pensais à la transformation des lieux dans la mémoire, à la façon dont les objets sont attaqués. L'esprit les dissoud et les perd. Vous pouvez grimper directement n'importe où. Plutôt que se contenter de chercher le sens immédiat d' une phrase telle que“la légèreté de la poussière et la pluie passagère d'un orage”, il faut qu'une structure profonde apparaisse au cas où nous perdions l'objet. Ce pourrait n'être qu'un reflet, une marque. Un reflet d'argent, par exemple, sur un vieux bois. Ou de l'herbe coupée qui sèche, tachée de vert après que les pluies soient finalement arrivées. Ou le déploiement des limites. Leurs fils rouillés tendus. Ou l'ébauche d'humanité de ces poteaux de clôture
Rainbow Snake
The blue vase keeps winking at me.
Painted blueness does that to the eye.
Its blueness is a wilder sea, obscured
by curves and sheen. Blueness back of the surf,
with a gull hovering on water's moody heave.
Past sunset streaks, the vase gapes into air,
all ear to what might drown in it,
now turning sapphire in the shifting reds
which race across this gathering dark.
Now it gleams with lamp-light like a snake
camouflaged in the glitter of midday heat.
It takes the passing wings of flickering steps.
The vase stands there, shining, on the table.
Parts are like islands in a shadowy wash.
The body's razor-bright in changing dusk.
Sunset behind it deepens with a mallee glow.
Re-fired by skylines, it comes from the earth,
a bulb, taut, marked, sinuous. Each side's
again that snake. It bends time. Until about to soar,
pure thing, burnished as desert, it builds rock-towers.
Serpent arc-en-ciel
Le vase bleu me cligne de l'oeil avec insistance.
Peint, le bleu crée cet effet optique.
Son bleu est une mer plus sauvage, assombrie
de courbes luisantes. Dos bleu des vagues,
une mouette planant sur la houle maussade.
Dans les derniers rayons du crépuscule, le vase baye aux corneilles,
tout ouïe à ce qui pourrait se noyer en lui,
devenant de saphir dans la course des rouges changeants
contre le noir qui s'amoncelle.
Maintenant, il luit à la lumière électrique, comme un serpent
camouflé dans l'éclatante chaleur de midi.
Ephémère, un pas dansant s'y reflète comme une aile.
Le vase est là, luisant, sur la table.
Semblable par endroits à des îles badigeonnées d'ombre.
D'un brillant de rasoir dans le crépuscule changeant.
Derrière lui, l'ombre s'épaissit avec une lueur de mallee.
Flamboyant sur l'horizon en feu, montant de la terre,
le gonflement précis, sinueux, d'un bulbe. De chaque côté,
le serpent. Il incurve le temps. Avant de prendre son vol,
pur, comme un désert bruni, dressant une tour de rochers.
Martin Harrison - traduction Marilyne Bertoncini
Lire d’autres textes du poète dans Recours au Poème : ici